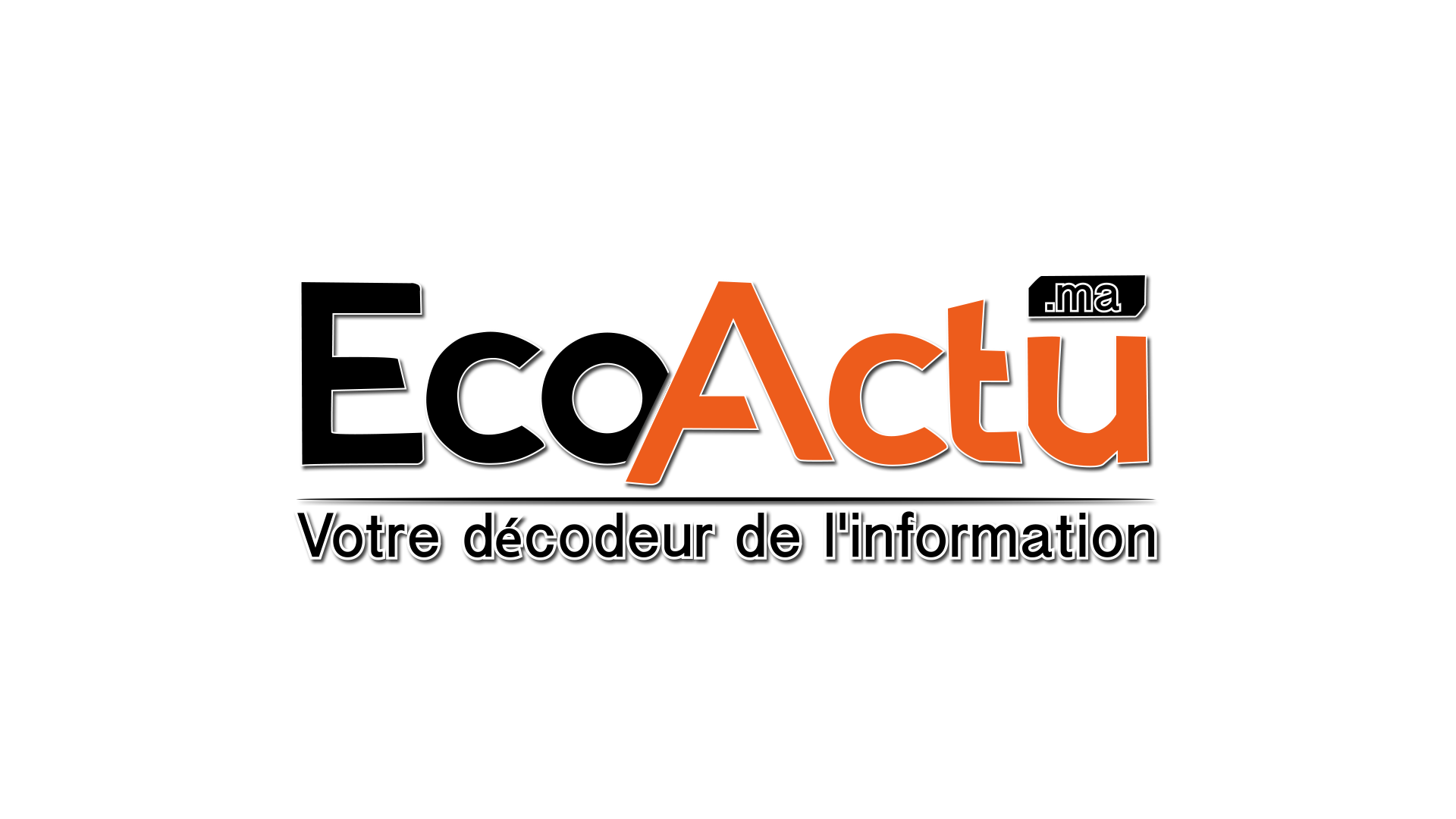1.2 Inégalités socio-économiques : catalyseurs de transformation territoriale et leviers de développement
La centralité de l’humain et l’interaction entre citoyens et territoires, telles qu’analysées dans la section précédente, illustrent que le développement territorial repose essentiellement sur la participation active des citoyens et sur l’ancrage territorial. Toutefois, cette co-construction s’inscrit dans des contextes sociaux et économiques souvent marqués par des tensions, des déséquilibres et des inégalités, qui conditionnent la capacité des territoires à se développer de manière inclusive et durable.
Ces tensions socio-économiques qu’il s’agisse d’inégalités d’accès aux ressources, de vulnérabilités sociales ou d’incivilités urbaines et numériques constituent des déterminants essentiels influençant la cohésion territoriale. Loin d’être de simples entraves, elles peuvent être considérées comme des leviers de transformation territoriale, révélant les besoins réels des citoyens et mettant en lumière les dysfonctionnements des modes de gestion.
Dans le contexte marocain, marqué par des politiques publiques orientées vers la justice sociale et le développement territorial intégré, ces tensions constituent des indicateurs stratégiques permettant d’adapter les stratégies de planification territoriale et de stimuler l’innovation sociale et territoriale. Lorsqu’elles sont analysées et intégrées de manière proactive, ces tensions deviennent de véritables catalyseurs de transformation.
Elles encouragent la réorganisation des modes d’action, le renforcement des mécanismes de solidarité et la conception de projets inclusifs, durables et porteurs de cohésion sociale. Par exemple, des initiatives locales de valorisation d’espaces publics dégradés, des programmes d’éducation civique et numérique, ainsi que des partenariats entre acteurs institutionnels et société civile, démontrent comment les tensions peuvent être converties en opportunités de progrès territorial.
Au-delà de leur rôle comme obstacles ou catalyseurs, ces inégalités socio-économiques constituent également un outil analytique pour comprendre la structure et les dynamiques territoriales. Elles permettent un ciblage temporel, spatial et comportemental, en identifiant les zones et les acteurs concernés, ainsi qu’en repérant les interactions et dynamiques à risque liées aux tensions socioéconomiques et environnementales.
Dans ce cadre, le territoire, envisagé comme un espace matériel, symbolique et expérientiel, devient à la fois support et produit de ces interactions, où les citoyens participent activement à sa transformation et à son développement. Premièrement, le ciblage temporel7 consiste à analyser la dimension chronologique des tensions socio-économiques. Cette approche permet de détecter les périodes critiques (crises sanitaires, catastrophes naturelles ou crises économiques saisonnières affectant l’agriculture) et de planifier des interventions proactives en infrastructures, services publics et dispositifs de solidarité.
En parallèle, des phénomènes sociaux ponctuels, tels que les migrations ou les mobilisations collectives, accentuent ces tensions temporelles. Deuxièmement, le ciblage spatial8 met en évidence la répartition géographique des inégalités et tensions. Certaines zones urbaines périphériques, quartiers, douars ruraux concentrent des populations précaires et souffrent d’un déficit d’infrastructures et de services essentiels.
Les tensions spatiales se concrétisent par la dégradation urbaine des espaces publics, l’accumulation de déchets ou la précarité des équipements collectifs. Cette approche permet d’identifier les zones prioritaires pour l’action publique, de planifier des aménagements intégrés et de restaurer le lien social, tout en orientant les politiques de développement territorial intégré. Troisièmement, le ciblage comportemental9 analyse les pratiques individuelles et collectives. Il distingue les comportements constructifs (participation citoyenne, engagement civique, innovation sociale) et des comportements perturbateurs (violence, incivilités numériques ou polarisation sociale, ensauvagement urbain10). A cet égard, l’étude menée par le Centre marocain pour la citoyenneté11 révèle que ces dynamiques traduisent à la fois des changements de mentalité et la frustration engendrée par les inégalités, tout en soulignant des politiques publiques sur la régulation sociale.
D’après cette étude, l’analyse comportementale constitue un mécanisme essentiel pour identifier les leviers favorisant la coopération citoyenne et, par conséquent, de renforcer la résilience territoriale.
Ces trois dimensions ; temporelle, spatiale et comportementale sont complémentaires, Ainsi, la dimension temporelle permet d’appréhender l’évolution des dynamiques sociales, économiques et environnementale, parallèlement, la dimension spatiale éclaire la distribution et l’organisation des ressources, infrastructures et pratiques ; enfin, la dimension comportementale révèle les choix, interactions et stratégies des acteurs impliqués.
La coordination de ces trois dimensions engendre l’émergence de synergies dans lesquelles les interventions publiques, les initiatives privées et les mobilisations citoyennes convergent pour transformer les défis socio-économiques en leviers de progrès territorial. Ces synergies renforcent directement la résilience et la durabilité des écosystèmes locaux.
En outre, ces effets se traduisent concrètement dans les trois sphères sociale, économique et environnementale qui structurent les dynamiques de développement territorial. La section suivante analysera ces sphères afin de démontrer leur interaction et leur articulation dans la mise en œuvre opérationnelle du développement territorial intégré.
1.2 Sphères sociale, économique et environnementale : structuration et articulation des dynamiques territoriales Les sphères sociale, économique et environnementale constituent le socle des dynamiques territoriales, sur lequel repose tout processus de développement. Leur articulation permet de dépasser les approches classiques et sectorielles pour instaurer un écosystème intégré, centré sur l’humain et aligné avec les Orientations Royales en faveur d’un Etat social résilient. Cette conception s’inscrit dans la continuité des théories contemporaines du développement territorial, qui mettent en lumière la nécessité d’intégrer simultanément ces trois dimensions pour produire des dynamiques cohérentes, innovantes et durables12 .
Primo : la sphère sociale
La sphère sociale constitue le fondement du développement territorial. Elle englobe non seulement les services essentiels tels que l’éducation, la santé et la protection sociale, mais également l’analyse des comportements civiques, des réseaux de solidarité et des mécanismes de mobilisation citoyenne13. Cette perspective, éclairée par les travaux d’Amartya Sen sur le développement humain et la liberté14, met en évidence que le bien-être et l’inclusion sociale ne peuvent être dissociés de la participation citoyenne effective.
Autrement dit, la cohésion sociale et la résilience territoriale reposent sur la capacité des individus à agir collectivement et à s’engager dans la construction de leur avenir commun. Dans l’espace réel, la sphère sociale se traduit par la participation aux instances locales, l’engagement associatif, le développement de projets communautaires et la valorisation des espaces publics. Ces interactions incarnées permettent aux citoyens de se sentir acteurs de leur territoire, renforçant le lien social et la cohésion territoriale. En effet, le capital social, constitué des réseaux de confiance et de coopération, est un déterminant majeur de la réussite des politiques publiques et de la résilience des communautés15.
Toutefois, certaines fragilités persistent : marginalisation, repli communautaire ou inégalités d’accès aux services essentiels, nécessitant des dispositifs inclusifs et adaptatifs. Dans l’espace numérique, la sphère sociale s’étend à de nouvelles formes de participation et de construction citoyenne. Dans l’espace numérique, la sphère sociale s’étend à de nouvelles formes de participation et de construction citoyenne.
Les réseaux sociaux et les plateformes collaboratives favorisent la participation communautaire à des projets territoriaux, à des campagnes de sensibilisation à l’environnement, ainsi qu’à des dispositifs de formation à distance. Néanmoins, ces plateformes numériques risquent également d’amplifier des phénomènes négatifs tels que la désinformation, la polarisation ou les comportements antisociaux, comme en témoignent les débats autour des fake news et des mouvements de contestation en ligne.
Ces dérives mettent en évidence la nécessité d’une éducation citoyenne adaptée aux usages numériques, afin de garantir que l’engagement virtuel se traduise par des effets positifs sur le territoire et la cohésion sociale. L’interaction entre espace réel et numérique structure aujourd’hui la citoyenneté contemporaine. A cet effet, les initiatives positives en ligne peuvent catalyser des actions concrètes sur le terrain, Alors que, les tensions numériques peuvent se répercuter dans la réalité sociale. Par conséquent, la complémentarité des deux dimensions devient un facteur déterminant pour la cohésion socio-territoriale et la durabilité des projets sociaux16 . Les situations critiques qu’elles soient sanitaires, climatiques ou économiques ont démontré que la résilience des territoires repose sur la coopération des institutions avec et pour les citoyens, ainsi que sur l’intégration de solutions inclusives et participatives. De fait, l’engagement actif des citoyens et la responsabilité des institutions, tant sur le terrain que via les plateformes numériques, constituent un levier essentiel pour anticiper les crises et renforcer la confiance envers les institutions17 .
Globalement, la sphère sociale associant services essentiels, participation citoyenne et capital social, souligne la nécessité de dispositifs inclusifs et adaptatifs. De plus, la complémentarité entre interactions concrètes et numériques s’avère déterminante pour co-construire des programmes capables de s’adapter aux défis contemporains.
Secundo : la sphère économique
La sphère économique s’impose comme un vecteur stratégique du développement territorial, en générant non seulement les ressources et infrastructures nécessaires, mais également les opportunités qui soutiennent les initiatives locales et renforcent la cohésion et l’équité territoriale. Notamment, elle ne se limite pas à la production de richesses ; elle englobe un ensemble de secteurs interconnectés, incluant l’économie du savoir, de la culture, de la santé, de la protection sociale, du sport et l’économie circulaire. Cette pluralité sectorielle permet de créer des opportunités durables et d’accroître la productivité des territoires, tout en consolidant leur résilience face aux aléas sociaux et environnementaux.
Par ailleurs, les composantes de cette sphère se caractérisent par une interdépendance structurelle. La compétitivité territoriale favorise la valorisation des ressources locales et l’attractivité des investissements, tandis que l’entrepreneuriat constitue un catalyseur d’innovation et de création d’emplois. De surcroît, le développement des chaînes de valeur locales intègre les acteurs économiques à différents niveaux, renforçant ainsi la capacité des territoires à absorber les fluctuations des marchés. L’intégration coordonnée des secteurs stratégiques contribue à la stimulation des dynamiques locales et à la consolidation de l’identité territoriale.
A ce propos, l’économie de la santé, de la protection sociale et du sport agit directement sur la productivité et le bien-être collectif. Parallèlement, les initiatives d’économie sociale et solidaire établissent des liens fonctionnels entre les actions locales et les projets structurants à grande échelle.
En somme, l’articulation de la sphère économique avec les sphères sociale et environnementale engendre un cercle vertueux : la croissance économique soutient les initiatives sociales et écologiques, lesquelles renforcent à leur tour la cohésion territoriale, la durabilité et l’équité. Ainsi, l’investissement dans des infrastructures vertes, des centres culturels ou des projets agro-industriels durables illustre concrètement cette interdépendance et souligne la nécessité d’une approche intégrée et systémique du développement territorial
Tertio : la sphère environnementale
La sphère environnementale constitue le pilier de la durabilité et de la résilience écologique.
Elle suppose une gestion rationnelle et proactive des ressources naturelles, en particulier de l’eau, afin de faire face au stress hydrique et au changement climatique. Elle englobe la préservation de la biodiversité, la lutte contre la dégradation des sols et la régulation des pollutions, garantissant ainsi la durabilité des écosystèmes locaux18 . Dans ce cadre, la gestion durable de l’eau revêt une importance stratégique pour l’agriculture, l’industrie et les usages domestiques19 . L’intégration de pratiques écologiques dans les projets territoriaux constitue non seulement une nécessité environnementale, mais également un facteur de résilience socio-économique.
D’autre part, les comportements citoyens représentent un facteur déterminant dans l’efficacité des politiques écologiques : la réduction de la consommation d’eau, le recyclage, la protection des espaces verts et la participation à des initiatives collectives renforcent simultanément la cohésion sociale et la durabilité environnementale. Ainsi, la sphère environnementale conditionne la pérennité des initiatives économiques et sociales, établissant un cercle vertueux où chaque sphère contribue au développement intégré des territoires.
De plus, l’interaction des trois sphères met en lumière une logique systémique : d’une part, la sphère sociale assure la cohésion indispensable aux investissements ; d’autre part, la sphère économique génère les ressources qui soutiennent les initiatives sociales et environnementales ; en outre, la sphère environnementale garantit la durabilité des ressources et la résilience des territoires. Par conséquent, ce modèle transforme les citoyens de simples bénéficiaires en acteurs engagés, créateurs de valeur et partenaires actifs dans la reconstruction territoriale. Pour clore cette section, la déclinaison opérationnelle de ce modèle sera présentée dans le chapitre suivant, démontrant ainsi comment ces dynamiques se traduisent concrètement en programmes et en écosystèmes intégrés.
Écrit par Ibtissam El Rhali,
Docteur en Droit public et Sciences politiques
Chercheur en développement humain et auteur de nombreux articles en matière de lutte contre la pauvreté
7 Beyer, C., & Royoux, D. (2015). L’aménagement temporel territorial : repenser les territoires en conjuguant espace et rythmes: https://journals.openedition.org/metropoles/5193
8 Santamaria, F. (1999). Le Schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC) : application défaillante ou élaboration problématique ?: https://journals.openedition.org/cybergeo/22354
9 Ouakrat, A. (2012). Le ciblage comportemental, une perte de contrôle des éditeurs sur les données de l’audience.: https://journals.openedition.org/ticetsociete/1251
10 L’ensauvagement urbain se réfère au processus par lequel les espaces publics se dégradent et deviennent perçus comme hostiles ou peu sécurisés, en raison de comportements antisociaux, de délinquance, de violence, de l’abandon des infrastructures ou de lacunes dans la gestion institutionnelle, https://dante.univ-tlse2.fr/s/fr/item/13979
11https://lematin.ma/nation/le-civisme-en-crise-une-urgence-nationale-a-lapproche-du-mondial2030/282259
12 Kotler, P., & Keller, K. L. (2022). Marketing Management. Paris : Pearson
13 Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
14 Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf
15 Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster
16 Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
17 Banque mondiale. (2021). Rapport sur la résilience territoriale et la participation citoyenne
18 Rapport national sur la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles, Ministère de l’Environnement, 2023
19 Stratégie nationale de l’eau au Maroc : enjeux et perspectives, Office National de l’Eau Potable, 2022.