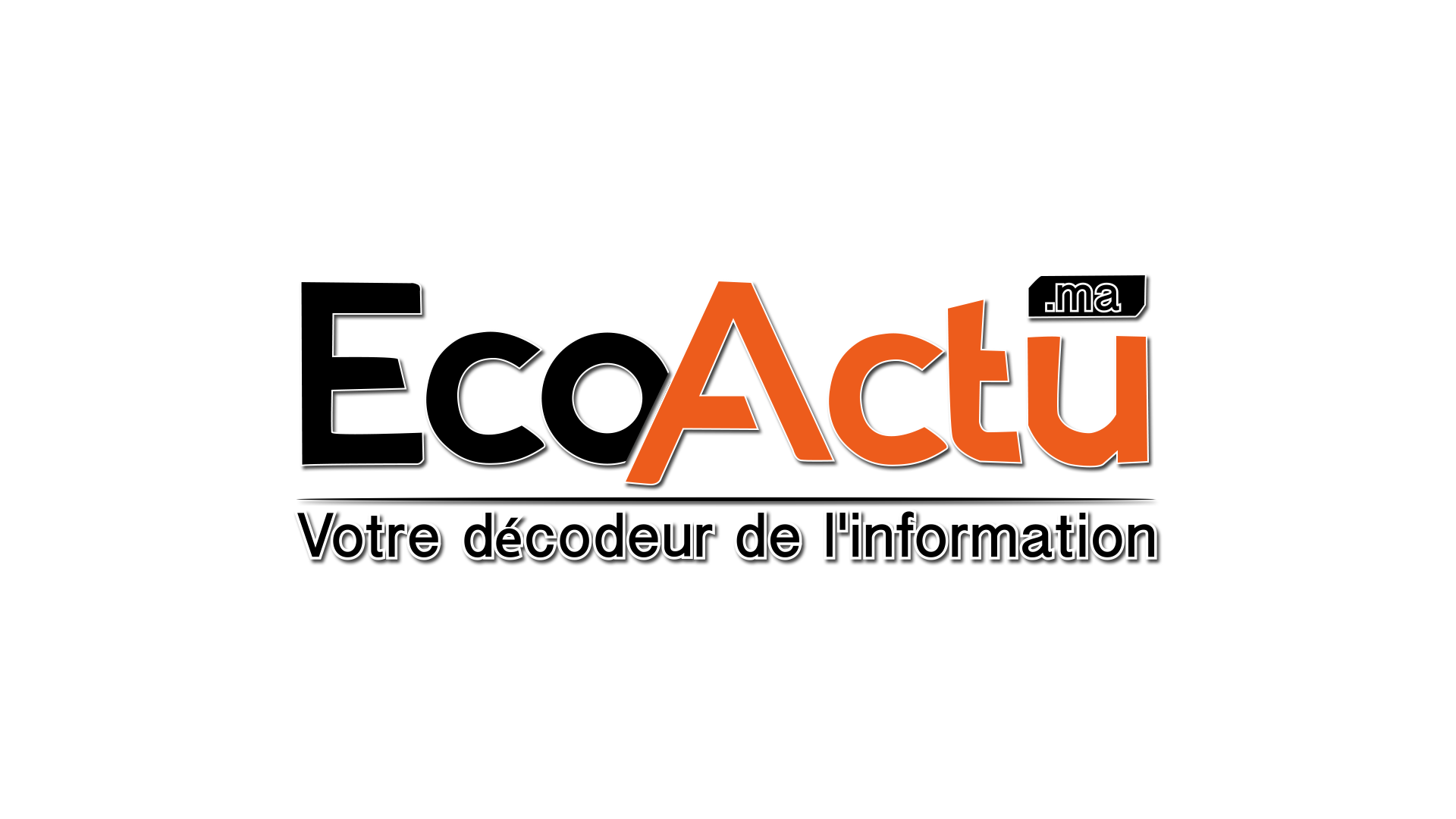Traditionnellement axée sur l’exécution budgétaire, avec une logique d’encaissement et de décaissement (comptabilité de caisse), la comptabilité publique migre progressivement, un peu partout dans le monde, vers une approche patrimoniale et de performance (comptabilité d’exercice et comptabilité analytique), c’est en ces termes qu’a ouvert Noureddine Bensouda, le Trésorier Général du Royaume, la conférence sur le thème « Rôle et enjeux de la comptabilité dans le secteur public». Les détails.
Dans un monde globalisé et des économies de marchés, les enjeux de la gestion financière publique sont énormes particulièrement le rôle de la comptabilité pour le secteur public. Pour les pays eux-mêmes d’abord, dans la mesure où la comptabilité évolue d’un simple instrument à un outil qui établit les ressources financières d’un gouvernement, des obligations, de la performance, et de l’impact économique de ses actions et aussi parce qu’elle devient un outil précieux d’aide pour une meilleure prise de décision concernant l’allocation des ressources, la budgétisation, et la politique fiscale.
Sans oublier un rôle tout aussi important, celui d’assurer une transparence du résultat économique des actions publics.
Au niveau international, la convergence des pratiques comptables représente une grille de comparabilité avec les autres pays et fournit une information financière fidèle aux institutions internationales.
Ce qui met la comptabilité au cœur de la dynamique de performance d’un Etat et dans ce sillage son évolution comme un impératif. Plus facile à dire qu’à faire et c’est ce qui ressort de la conférence organisée par le ministère de l’Économie et des Finances, la TGR et Fondafip, ce 22 novembre, sur le thème « Rôle et enjeux de la comptabilité dans le secteur public».
Comme l’explique Noureddine Bensouda, Trésorier Général du Royaume, la comptabilité publique tend à fournir une image fidèle du patrimoine et des engagements de l’Etat, y compris les dettes assimilées et les passifs latents, comme les engagements de retraite par exemple. Elle donne aussi une idée précise du coût réel des politiques publiques. Il a rappelé dans son allocution d’ouverture de la conférence que l’objectif est de mettre en lumière cette évolution, loin d’être anodine, à travers le développement de trois axes majeurs autour desquels se focalisent les discussions sur la comptabilité dans le secteur public, notamment, son rôle comme outil d’aide à la décision, les défis que représentent l’harmonisation des normes internationales et nationales et, enfin, sa place dans les stratégies de développement durable.
« En ce qui concerne la pertinence et la performance des actions de l’Etat, le passage à la comptabilité d’exercice (IPSAS ou standards nationaux équivalents) conduit à enregistrer les charges et les produits au moment où ils sont engagés ou réalisés, et non plus au moment du décaissement ou de l’encaissement. De cette manière, la comptabilité révèle trois perspectives essentielles pour la décision », soutient Noureddine Bensouda.
D’abord, la comptabilité assure une connaissance précise de la valeur et de la composition du patrimoine public (biens immobiliers, infrastructures, participations financières, etc.) permet de mieux le mobiliser et d’optimiser son usage par des arbitrages judicieux entre cession, réaffectation ou investissement dans de nouveaux actifs.
Aussi, la prise en compte des passifs latents (dettes financières, dettes assimilées, engagements hors bilan, etc.) permet-elle un meilleur pilotage budgétaire et une meilleure viabilité à long terme des finances publiques.
« La décision n’est plus limitée à l’année en cours, mais sur l’impact pluriannuel et sur la vision à moyen et long termes, donnant ainsi au gouvernement les moyens de mieux planifier la soutenabilité à long terme de ses politiques. Au Maroc, la réforme de la Loi organique relative à la loi de finances de 2015 a constitué une véritable rupture dans le modèle de gestion des finances publiques. Elle a combiné la réforme budgétaire à la réforme comptable qui a consacré, entre autres, la comptabilité générale (comptabilité patrimoniale et d’exercice) », explique N. Bensouda.
Enfin, la comptabilité générale apporte les éléments pour la détermination du « Coût intégral des services », notamment, en faisant ressortir des informations relatives à l’amortissement des immobilisations et à l’évolution des stocks et des provisions. Les décideurs publics peuvent, ainsi, connaître, par exemple, le coût réel, et non seulement budgétaire, de la construction et de l’exploitation d’une école, d’un hôpital ou d’une route.
En ce qui concerne la reddition des comptes (accountability), N. Bensouda estime que la comptabilité permet de connaître les ressources consommées par rapport aux résultats obtenus et fournit, ainsi, une base objective pour le débat public. Ainsi, en mettant à disposition une information pertinente, le système comptable rend compte des réalisations dans le respect du principe de l’image fidèle, et garantit l’imputabilité (responsabilité) de la gestion et de la décision.
« Dans les systèmes démocratiques, l’accès à une information financière complète, fiable et comparable est un gage de transparence et une condition sine qua non de la confiance publique », souligne-t-il.
La comptabilité entre enjeux nationaux et internationaux
Abordant le deuxième axe de la conférence consacré aux enjeux des normes et des standards comptables, Noureddine Bensouda souligne que l’adoption de normes comptables soulève des enjeux complexes aussi bien au niveau international que national.
« Parmi ces enjeux, nous pouvons citer d’un côté, l’harmonisation au niveau international et, de l’autre, l’articulation entre l’échelon international et l’échelon national. Nul besoin de rappeler que la globalisation des échanges et le besoin de comparabilité entre pays, ainsi qu’entre différents niveaux d’administration d’un même pays, ont conduit à l’émergence de standards comptables internationaux pour le secteur public, notamment les « International Public Sector Accounting Standards » (IPSAS) ».
Pour le Trésorier Général du Royaume, cette harmonisation à marche forcée des normes comptables pour le secteur public n’est pas un processus neutre, car elle véhicule une certaine vision de l’État et de sa gestion.
La prééminence des IPSAS, promues par l’International Federation of Accountants (IFAC), consacre en réalité le modèle de la Nouvelle Gestion Publique (New Public Management) qui tend à transposer au secteur public des mécanismes d’évaluation et de gestion du secteur privé.
« L’objectif est de voir l’État non seulement comme un régulateur, mais, également, comme un prestataire de services, dont la performance doit être mesurée à travers un compte de résultat et un bilan. En calquant les IPSAS sur les IFRS (International Financial Reporting Standards), l’objectif escompté est de rendre les finances publiques plus lisibles pour la communauté financière internationale », explique-t-il.
Il s’agit, de ce point de vue, de rassurer les créanciers en vue de faciliter l’accès aux marchés de capitaux et de procéder, le cas échéant, à la privatisation ou encore à la gestion des concessions.
De même, en fournissant une information fidèle sur la dette, les infrastructures et les engagements hors bilan, l’application des normes IPSAS facilite la surveillance des finances publiques par les institutions et organismes internationaux (FMI, Banque mondiale, Agences de notation, Commission Européenne).
Le deuxième enjeu est celui de l’articulation entre l’échelon international et l’échelon national. Comme l’explique Bensouda, à la base, l’adoption de normes comptables internationales vise à créer un langage comptable commun, permettant la comparabilité, améliorant la transparence globale et facilitant l’analyse économique.
« L’application des normes IPSAS, par exemple, présente des avantages certains, car elle contribue, notamment, à harmoniser les pratiques d’évaluation des actifs et des passifs, et à structurer la présentation des états financiers. Cependant, l’adoption de ces normes demeure, en soi, un défi majeur. Elle exige non seulement de nouvelles compétences en comptabilité, de la formation et une refonte des systèmes d’information, mais surtout, une adaptation culturelle profonde. Les coûts de transition sont élevés et la résistance au changement est souvent inévitable », poursuit le conférencier.
De plus, les IPSAS doivent souvent être adaptées aux spécificités de chaque pays (le périmètre adressé, le système fiscal, les institutions présentant des particularités comme la défense, etc.).
Une convergence progressive est privilégiée pour une meilleure soutenabilité politique et technique
Le choix d’une convergence progressive vers des normes internationales est souvent la voie privilégiée, qui garantit la soutenabilité politique et technique de cette transition, estime Noureddine Bensouda.
Et d’assurer que le plus délicat dans cet exercice est d’assurer la coexistence ou la convergence, selon les cas, entre les standards IPSAS et les normes comptables nationales. Dans certains pays, les IPSAS servent de cadre de référence pour moderniser les normes nationales sans être adoptées telles quelles. Cette hybridation permet de prendre en compte les spécificités liées à l’histoire institutionnelle et au droit administratif du pays, tout en tirant parti des avantages qui découlent de l’adoption de ces normes.
Selon lui, il s’agit de trouver un point d’équilibre entre la volonté d’harmonisation, pour la crédibilité internationale, et la nécessité d’un ancrage local, pour l’efficacité de la gestion interne. Le troisième axe porte sur la place de la comptabilité dans le développement durable. L’urgence de l’action climatique et sociale a placé le développement durable au cœur des politiques publiques. Par conséquent, la comptabilité dans le secteur public se trouve interpelée sur l’intégration des externalités environnementales et sociales.
« Il s’agit, dorénavant, d’ajouter à la comptabilité « financière » une comptabilité intégrant les coûts des impacts environnementaux et sociaux. Dans cette optique, la comptabilité doit être en mesure de quantifier les coûts de la dégradation de l’environnement et les efforts déployés pour sa sauvegarde. En somme, il s’agit de capter l’empreinte environnementale de l’action publique, au sens large ».
Mais la mesure et la fiabilité des données non-financières (environnementales et sociales) demeurent un sujet de préoccupation principal car, contrairement aux données financières, les indicateurs de performance sociale et environnementale sont souvent hétérogènes et subjectifs, soutient le Trésorier Général du Royaume.
A ce titre, la comptabilité constitue un outil de traçabilité des « fonds verts » pour éviter les dérives, comme le « greenwashing » ou écoblanchiment public qui vise uniquement à se donner une image plus écologique. Elle peut constituer, ainsi, un outil de pilotage des politiques de durabilité et de leur alignement par rapport aux engagements internationaux du pays, notamment les Objectifs de Développement Durable (ODD). En intégrant le développement durable, la comptabilité dans le secteur public devient un levier essentiel pour transformer les intentions politiques en actions mesurables et imputables.
« Il faudrait garder à l’esprit que l’un des rôles les plus importants de la comptabilité est de soutenir la légitimité démocratique à travers la promotion de la transparence et de la reddition des comptes. Ce faisant, elle contribue à asseoir et à renforcer le rôle des institutions », insiste Noureddine Bensouda.