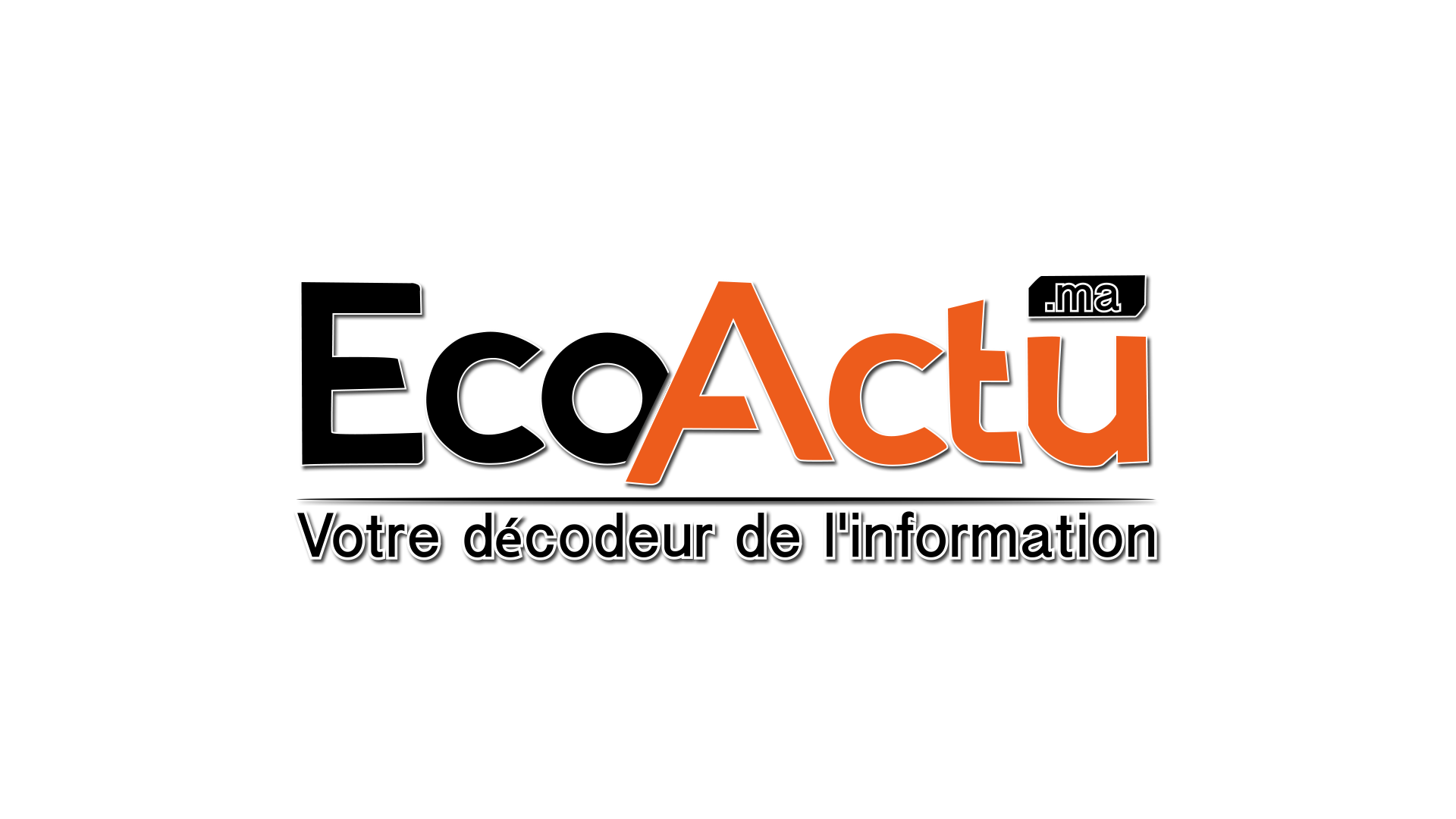À la clôture de la dernière campagne de l’haricot vert, l’analyse fait apparaître une filière qui garde des atouts logistiques et agronomiques mais qui se heurte à des fluctuations de marché et à une compétition internationale intense.
Le premier constat porte sur les volumes et la valeur échangée. Les statistiques européennes du premier trimestre 2025 montrent un fléchissement des importations de haricots verts en provenance du Maroc : les volumes importés par l’Union européenne se sont établis à 27 990 tonnes, soit une baisse de 16 % en volume, pour une valeur de 68 millions d’euros, soit −11 % en valeur comparé à la même période l’année précédente. Ce repli traduit des mouvements d’offre et de demande saisonniers et des ajustements tarifaires sur les marchés européens.
Pour le Maroc, la campagne horticole 2024/2025 confirme que les légumes d’export restent une dynamique forte pour la balance commerciale agricole. Selon les bilans nationaux agrégés, les légumes exportés ont représenté plusieurs centaines de milliers de tonnes sur la campagne, avec le haricot vert figurant parmi les principales cultures derrière le poivron et la tomate. AgriMaroc mentionne, pour la campagne la plus récente, un ordre de grandeur autour de 100 000 tonnes pour les haricots verts, ce qui confirme l’importance de la filière dans le portefeuille d’exportation du pays.
Géographiquement, le flux vers l’Espagne demeure déterminant. L’Espagne reste non seulement un marché de transit mais aussi un client direct de premier plan pour les haricots verts marocains. Dans le sillage de la reprise générale des échanges, les importations espagnoles de produits marocains connaissent des hausses sur plusieurs segments, et les haricots verts figurent parmi les produits les plus exportés vers la péninsule, même si les volumes peuvent varier sensiblement d’un trimestre à l’autre selon la concurrence de la production locale et des autres pays fournisseurs.
« La compétition internationale pèse fortement sur les prix. Les marchés européens sont structurés autour d’une offre abondante venue d’Espagne, des pays riverains de la Méditerranée et d’outre-mer selon les saisons », explique AgriMaroc. Et d’enchaîner : » Cette densité d’offre provoque des cycles de prix souvent serrés, et les opérateurs marocains l’ont bien intégré : la stratégie adoptée depuis quelques campagnes consiste à diversifier l’offre, viser des créneaux premium et renforcer la certification qualité pour réduire la vulnérabilité aux variations de prix liées au volume. La crise des prix pousse ainsi nombre d’exportateurs à travailler des segments « niche » — conditionnement premium, calibres spécifiques, productions sous label — plutôt qu’un positionnement exclusivement volumique ».
Sur le plan agronomique, le haricot vert marocain bénéficie d’un savoir local adapté aux cultures sous abri et à la conduite de récolte successive, ce qui permet d’étaler l’offre dans la campagne et d’atténuer les pics de surproduction. Les régions atlantiques et certaines plaines du nord fournissent les volumes les plus importants. Cette maîtrise technique est un atout pour l’accès aux marchés exigeants, mais elle exige également des investissements continus en intrants, protection phytosanitaire maîtrisée et gestion post-récolte. Les exploitations performantes sont celles qui parviennent à combiner productivité et conformité aux exigences sanitaires des importateurs européens.
Les enjeux logistiques demeurent un point de tension récurrent. La proximité du marché européen est un avantage compétitif mais ne dispense pas des besoins en infrastructures : stations de conditionnement performantes, chambres froides, chaînes de transport optimisées et calendriers d’expédition respectés. Les acheteurs européens sont exigeants sur la fraîcheur, l’homogénéité du calibre et la tenue à la conservation. À défaut d’un conditionnement et d’un transport irréprochables, des lots peuvent voir leur valeur dépréciée à l’arrivée, voire être refusés. Le renforcement des capacités de conditionnement et la réduction des pertes post-récolte restent donc des priorités pour améliorer la marge des producteurs et exportateurs.
La question de la durabilité et des normes sanitaires est devenue centrale. Les circuits premium exigent aujourd’hui des teneurs en résidus très basses et une traçabilité complète. Plusieurs exportateurs marocains se sont engagés dans des certifications comme GlobalGAP ou des démarches « résidu zéro » pour accéder aux segments les mieux rémunérateurs. Ces certifications impliquent des investissements en formation, matériel et suivi analytique, mais elles ouvrent la porte à des prix supérieurs et à une plus grande résilience commerciale. La transition vers ces standards est donc une voie privilégiée pour sécuriser des revenus stables et limités en volatilité.
Le marché intérieur n’est pas à négliger. Pour nombre d’exploitants, la dualité entre vente à l’export et approvisionnement du marché national permet de lisser les risques. En période de surproduction ou de prix faibles à l’export, une partie des volumes peut être écoulée sur le marché local, contribuant ainsi à l’offre nationale et stabilisant partiellement les revenus des producteurs. Cette flexibilité demeure une pièce importante de la stratégie commerciale des opérateurs marocains.
Sur le plan de la politique sectorielle, la filière bénéficie indirectement des programmes de soutien à l’horticulture et aux infrastructures agricoles. L’amélioration de l’accès aux semences adaptées, le soutien à la modernisation des stations de conditionnement, et les aides pour la structuration des coopératives renforcent la capacité de la filière à répondre aux exigences de l’export. Cependant, la transition vers des modèles plus durables et à plus forte valeur ajoutée nécessite encore un effort concerté entre acteurs publics, exportateurs et coopératives. Il s’agit notamment de soutenir les investissements en irrigation efficiente, en protection phytosanitaire raisonnée et en conditionnement. (Avec Agrimaroc)