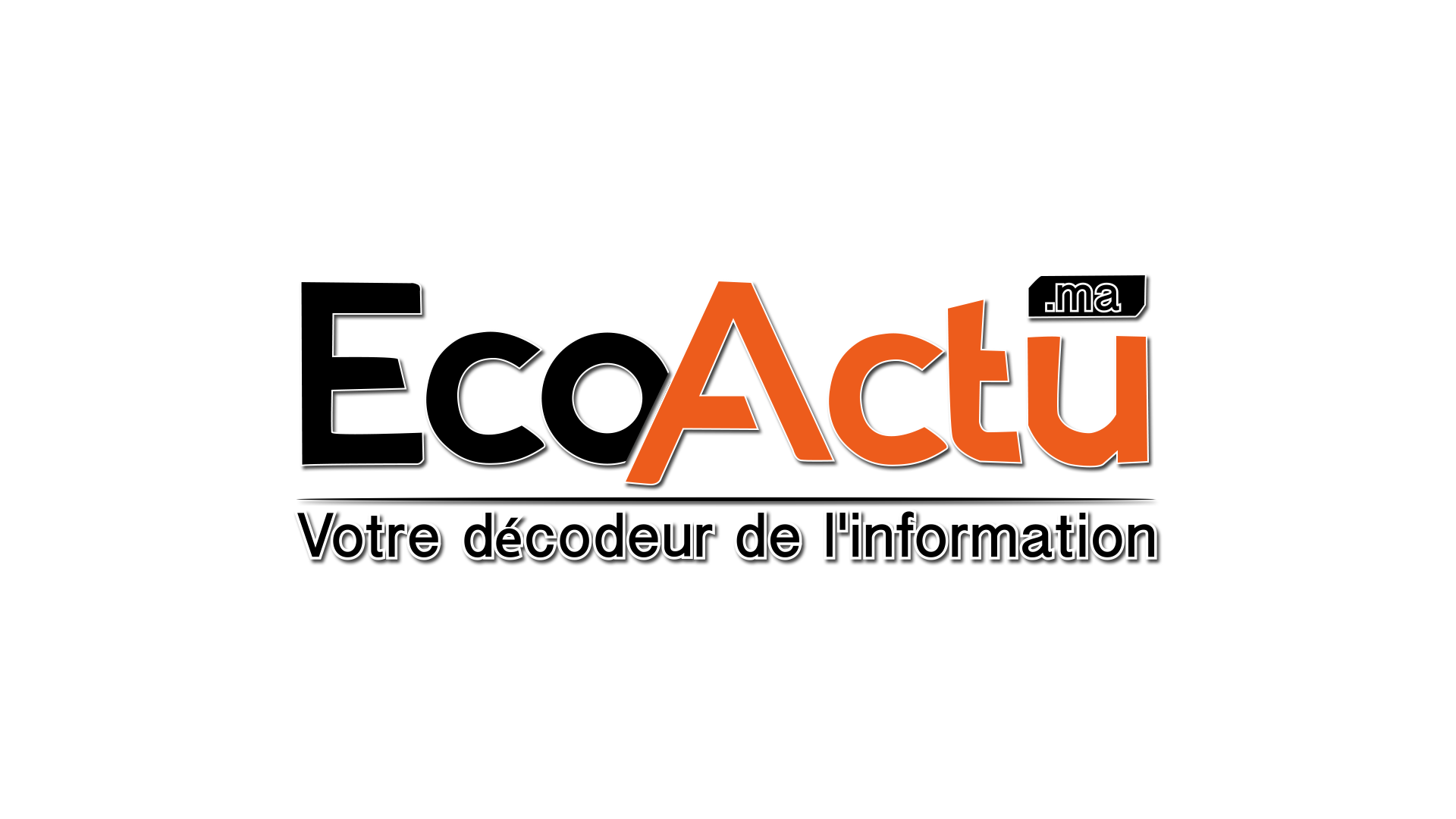Chapitre 2 : Déclinaison opérationnelle du développement territorial intégré.
Ce chapitre s’inscrit dans la continuité opérationnelle de la section précédente, qui a posé les fondements conceptuels du développement territorial intégré.
Il propose désormais une déclinaison concrète de ces dynamiques, en mettant en lumière les mécanismes permettant de transformer les approches en programmes intégrés et résilients, tout en illustrant comment la condition humaine devient un levier de la transformation socio-territoriale et de l’écosystème citoyen, en s’appuyant sur l’expérience modeste mais significative de la province de Khouribga.
Celle-ci a placé la condition humaine au cœur du processus de développement social, faisant du citoyen non seulement un bénéficiaire, mais également un acteur déterminant de la transformation socio-territoriale.
Le chapitre suivant mettra en évidence l’ossature opérationnelle de ce processus, en soulignant les modes de gestion qui ont permis de faire de la condition humaine le socle d’un écosystème inclusif.
Il révèle également la capacité de cette expérience à produire des solutions pratiques et réalistes, répondant aux problèmes locaux des citoyens et satisfaisant leurs besoins légitimes et attentes raisonnables en matière de protection sociale, de santé, d’éducation et d’insertion socio-économique.
L’expérience de la province de Khouribga s’articule autour de trois axes principaux, étroitement liés et complémentaires. Le premier concerne la gouvernance co-constructive, fondée sur une architecture triptyque « Accueil, Incubation, Inclusion », qui établit le fondement d’une dynamique collective et participative. Ce cadre structurant prépare le terrain pour la mise en œuvre de la gestion proactive.
Le deuxième axe concerne la gestion proactive, qui s’appuie sur la gouvernance coconstructive et agit comme facilitateur, accélérateur et catalyseur, le rôle des acteurs locaux pivots y étant central, avec des modèles de gestion intégrative. Cette démarche transforme les espaces administratifs en lieux d’échange et d’innovation, instaurant un management constructif qui assure la pertinence et l’efficacité des programmes.
Le troisième axe, le passage du citoyen bénéficiaire au citoyen producteur, constitue l’aboutissement logique des deux premiers axes. Grâce à une gouvernance co-constructive et à une administration proactive, les citoyens deviennent des acteurs productifs et responsables au sein d’un écosystème inclusif et durable, renforçant ainsi la résilience territoriale.
Ainsi, ces trois axes ne fonctionnent pas isolément, mais se renforcent mutuellement : la gouvernance co-constructive établit le cadre, la gestion proactive le met en œuvre, et le citoyen producteur en est le résultat tangible. En conséquence, les sections suivantes détailleront ces axes en profondeur, en révélant les bonnes pratiques qui ont permis de traduire les dynamiques socio-territoriales en un écosystème opérationnel inclusif et résilient.
2.1 Gouvernance co-constructive : Repenser l’action territoriale
Dans un contexte territorial en profonde mutation, où les défis économiques, sociaux et environnementaux se croisent et s’amplifient, les territoires se trouvent confrontés à des problématiques inédites.
Les approches classiques de gouvernance montrent leurs limites face à l’exigence croissante de solutions inclusives et adaptées aux réalités locales, rendant nécessaire le dépassement d’une gouvernance verticale au profit d’un modèle où la co-création de solutions avec les citoyens devient centrale, mobilisant écoute, coopération et intelligence partagée, et favorisant la construction collective de réponses adaptées et durables.
Dans cette perspective, la gouvernance co-constructive s’affirme comme une approche intégrative, centrée sur l’humain, ses besoins et son potentiel, transformant les défis en leviers d’action et les contraintes en opportunités de développement. Cette approche place l’action locale au cœur du processus décisionnel, renforçant la résilience territoriale et la capacité d’adaptation face aux mutations et aux changements multiples.
Sous cet angle, le modèle de la province de Khouribga témoigne de la capacité des territoires à transformer les tensions socio-économiques en leviers de progrès. Elle illustre concrètement comment les principes du développement intégré peuvent se traduire en actions et programmes concrets, renforçant l’Etat social et favorisant un développement inclusif et durable.
Corrélativement, cette démarche se concentre sur une conception de solutions pratiques et réalisables aux problèmes réels des citoyens, en apportant des réponses adaptées à leurs besoins et attentes légitimes en matière de protection sociale, de santé, d’éducation ou d’emploi.
Cette initiative s’inscrit dans les Orientations définies par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, telles qu’énoncées dans son Discours Royal à l’occasion de la fête du trône, le dimanche 29 juillet 2018: « Cher peuple, la question sociale retient toute Mon attention et M’interpelle vivement, à la fois en tant que Roi et en tant qu’homme. Depuis Mon accession au Trône, J’ai toujours été à l’écoute de la société et prompt à cerner ses attentes légitimes. Constamment à l’œuvre, Je porte l’espoir inaltérable d’améliorer les conditions de vie des citoyens ».
Conformément aux Hautes Orientations Royales, l’Autorité Gubernatoriale a mis en place un arsenal de mécanismes pour élaborer un projet inclusif en faveur de la société, dans une convergence étroite et encadrée. Elle implique une large panoplie d’acteurs de l’ingénierie sociale, présents dans chaque commune, quartier et douar, afin de participer à un processus de co-construction avec les citoyens.
Ce projet fonctionne comme un écosystème social inclusif, où l’accueil des citoyens dépasse la simple formalité administrative pour devenir un processus vivant et interactif, favorisant l’expression des idées de chacun ainsi que de leurs besoins et attentes légitimes.
2-1-1-Vigilance sociale : Agir Ensemble Autrement
Le projet de Vigilance Sociale20 a été lancé dans le cadre de l’INDH, le 5 octobre 2021, en étroite collaboration avec l’association provinciale, le parquet général, la sûreté nationale, la gendarmerie royale, la protection civile, ainsi que les services sectoriels de l’éducation, de la santé, de la jeunesse, de la culture et du sport.
Ce dispositif implique les associations locales intervenant dans les domaines de la protection sociale, de la santé, de l’insertion socioéducative et socio-économique, afin de créer un écosystème social inclusif et coordonné, au service des populations précaires : femmes en situation difficile, enfants abandonnés, personnes âgées isolées, sans-abri, mineurs non scolarisés, jeunes NEET (Not in Education, Employment, or Training) indépendamment de leur origine ou de leur nationalité.
De surcroît, la vigilance sociale dépasse la simple gestion de l’urgence. Elle repose sur un diagnostic social rigoureux, l’écoute active, l’orientation et la mise en place de réponses adaptées, transformant les tensions en leviers de résilience sociale.
Cette approche se distingue par son anticipation et son adaptabilité, permettant non seulement d’identifier et de prévenir les situations critiques, mais aussi de générer des solutions innovantes et adaptées à chaque situation.
L’ossature du dispositif s’articule autour de cinq pôles complémentaires : accueil et hébergement, pôle médical, pôle juridique, pôle socio-éducatif et pôle socioéconomique, constituant ainsi un continuum d’accompagnement intégré. Depuis Octobre 2021 jusqu’à mai 202521, plus de soixante mille interventions ont été effectuées, bénéficiant tant aux populations locales en situation de précarité qu’aux personnes provenant d’autres villes ou d’autres nationalités, notamment aux passagers requérant un accompagnement dans des situations critiques. Ainsi, ces actions ont contribué de manière significative au renforcement de la cohésion sociale, démontrant de manière concrète le lien entre efficacité opérationnelle, créativité et impact humain.
En outre, ces interventions feront l’objet d’un futur livret qui racontera les récits de transformation des vies, des liens et des lieux, permettant ainsi de découvrir les changements profonds qu’elles ont engendrés.
Par ailleurs, ce dispositif fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, selon un processus structuré : réception des signalements sur le terrain ou via les réseaux sociaux, collecte et analyse des données, diagnostic social, identification des mécanismes d’intervention, coordination avec les parties prenantes, puis orientation vers des prises en charge adaptées.
Cette organisation illustre parfaitement que proactivité et réactivité peuvent coexister afin de produire une inclusion durable, qu’elle soit médicale, socio-économique, éducative, juridique ou psychologique.
De l’urgence à l’inclusion
Chaque cas identifié, qu’il soit signalé par un appel téléphonique, relayé sur les réseaux sociaux ou constaté directement sur le terrain mobilise immédiatement la Cellule de Vigilance Sociale. Que la situation concerne une femme en difficulté, une personne atteinte de troubles mentaux, un enfant abandonné, un sans-abri, une personne âgée isolée, une jeune fille non scolarisée ou un jeune NEET en errance, la réponse se veut rapide, adaptée et créative, respectant les besoins spécifiques de chaque situation qui fait l’objet d’interventions spécifiques : prise en charge médicale d’urgence, assistance sociale, hébergement temporaire, orientation éducative, réinsertion professionnelle, accompagnement socio-éducatif, regroupement familial ou formation professionnelle.
Dès le premier contact, des actions concrètes sont déclenchées : transfert à l’hôpital (soins médicaux ou chirurgicaux), douche, nettoyage du domicile, changement de vêtements, repas, accompagnement psychologique, orientation juridique, insertion socio-économique et consolidation du capital humain.
Ces interventions sont coordonnées de manière collaborative par la Cellule, en synergie étroite et structurée avec le parquet général, la sûreté nationale, la gendarmerie royale, les autorités locales ainsi que les services de santé et les associations partenaires assurant la continuité de l’accompagnement, renforçant ainsi le réseau de soutien territorial et la cohésion sociale.
En définitive, l’objectif du dispositif est de passer de l’urgence à l’inclusion, en construisant avec chaque bénéficiaire son projet de vie, transformant les problèmes et les crises en leviers d’opportunité. La mission ne se limite pas à la gestion de crises ponctuelles, mais consiste à co-construire avec le citoyen des solutions collectives, durables et génératrices de cohésion sociale.
2-1-2-Architecture Triptyque : Accueil-Incubation-Inclusion
La gouvernance co-constructive s’affirme comme une réponse innovante aux limites des approches classiques de développement, plaçant l’humain, ses besoins et son potentiel au cœur des processus décisionnels, tout en combinant une approche territoriale intégrée incarnée par l’architecture triptyque « Accueil, Incubation, Inclusion » qui permet de transformer les besoins, tensions et vulnérabilités en opportunités de développement, tout en créant des synergies opérationnelles entre acteurs publics, associatifs et citoyens.
Accueil : instaurer la confiance et prévenir les tensions
Le processus débute par l’accueil, phase essentielle qui dépasse la simple réception des citoyens. Il constitue un mécanisme structurant d’écoute active, de reconnaissance et de valorisation des expériences, nécessaire pour instaurer un climat de confiance. Dans le cadre de la Cellule de vigilance sociale, chaque signalement, qu’il provienne du téléphone, des réseaux sociaux ou d’observations directes sur le terrain, déclenche un processus de traitement immédiat, illustrant concrètement l’efficacité de cette démarche.
Par ailleurs, l’accueil permet de légitimer les doléances et de prévenir les tensions sociales, tout en identifiant les besoins spécifiques et en préparant les actions d’incubation. Dans une perspective d’ingénierie sociale, cette phase agit comme un capteur territorial, transformant perceptions, frustrations et aspirations des citoyens en données exploitables pour la conception de solutions adaptées. Ainsi, l’accueil se révèle être un espace d’hospitalité citoyenne où la parole devient une ressource et la condition humaine un socle fondamental de tout processus, programme ou projet.
Incubation : transformation des besoins légitimes en actions concrètes
L’incubation traduit les informations collectées, attentes légitimes et besoins identifiés en projets concrets, innovants et viables. Cette étape mobilise les fondements de l’ingénierie sociale22 afin de transformer les tensions en opportunités de développement participatif et cocréatif.
Concrètement, au sein du processus de vigilance sociale, l’incubation prend forme par la mise en œuvre de programmes d’initiatives locales, portés par la collaboration entre acteurs publics, associatifs et citoyens : la prise en charge socio-médicale des personnes âgées, des enfants abandonnés, l’accompagnement des jeunes non scolarisés vers la formation et l’emploi, la réinsertion socio-économique des femmes en situation difficile, ou la mobilisation d’incubateurs pour des projets agricoles et entrepreneuriaux.
L’incubation suit une logique systémique : les initiatives sont testées, ajustées et reproduites dès que leur impact social est confirmé. Cette approche permet de générer une valeur ajoutée tangible, en transformant la vulnérabilité en potentiel et en consolidant les liens entre acteurs locaux, institutions et communautés.
Inclusion : autonomisation et intégration socio-économique
L’inclusion représente la phase d’accomplissement du processus triptyque, en reliant l’accompagnement social à l’autonomisation et à l’intégration durable des bénéficiaires dans le tissu socio-économique. Elle va au-delà du simple appui ponctuel pour renforcer les capacités, favoriser l’insertion socio-professionnelle et garantir l’accès équitable aux services éducatifs, sanitaires et économiques.
Par ailleurs, elle agit comme un levier de cohésion sociale, en intégrant les personnes en situation de précarité dans la dynamique de transformation territoriale. En valorisant les talents locaux et en stimulant les initiatives collectives, l’inclusion devient ainsi un moteur de solidarité et de durabilité, fondé sur la synergie entre acteurs publics, associatifs et citoyens.
En somme, l’architecture « Accueil – Incubation – Inclusion » représente la structure fondamentale de la gouvernance co-constructive dans la transformation des situations critiques en opportunités de développement, tout en consolidant la participation et la cohésion sociale. Cette approche intégrée ouvre la voie à la gestion proactive, dont les principes et mécanismes seront traités dans la section suivante.
2.2 Gestion proactive : Proagir ensemble
Si la gouvernance co-constructive définit le cadre structurant du processus de vigilance sociale basé sur l’Accueil, l’Incubation et l’Inclusion, la gestion proactive assure à la fois la mise en œuvre et la cohérence opérationnelle des interventions, des actions, des initiatives inclusives et aussi des programmes élaborés dans la province de Khouribga.
Cet écosystème n’est pas figé : il se vit, s’expérimente et s’incarne au quotidien, à travers le contact direct avec les citoyens et l’organisation des équipes. Il ne se limite pas aux bureaux : il se déplace vers les citoyens pour écouter leurs besoins, comprendre leurs difficultés et co-construire des solutions adaptées.
Cette démarche managériale s’inscrit pleinement dans la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, qui a insisté sur la modernisation des méthodes de travail et l’ardeur créative dans la gestion de la chose publique. « D’ailleurs, j’ai d’ores et déjà appelé à la nécessité de moderniser les méthodes de travail, de faire preuve d’ardeur créative et d’innovation dans la gestion de la chose publique. »23 .
Dans ce contexte, la gestion proactive devient un levier reliant politiques, programmes et projets aux besoins et attentes légitimes des citoyens. Elle irrigue le fonctionnement interne et externe et transforme les équipes administratives en collectifs dynamiques, où confiance, cohésion et créativité renforcent la performance et l’impact des actions.
Lors des réunions régulières, briefings et débriefings, les rôles et responsabilités sont systématiquement clarifiés, en précisant qui agit, quand, où, comment et avec qui. Ce processus commence par la posture symbolique « Qui accroche la cloche », prononcée par le responsable au lancement de chaque rencontre.
Cette pratique incarne la cohésion, la coordination et l’engagement collectif, tout en rappelant à chaque membre de l’équipe son rôle actif, tant dans la dynamique du groupe que dans la réussite des projets territoriaux. Ainsi, chaque fonctionnaire prend conscience de sa double fonction : celle de gestionnaire administratif et celle de citoyen engagé.
Au-delà de l’exécution des tâches, cette méthode favorise l’écoute active, l’échange réflexif et la co-construction de solutions, établissant un réseau de cohésion managériale où les rôles de facilitateur, catalyseur, accélérateur, pivot se complètent et se renforcent mutuellement.
Cette approche de gestion s’appuie sur les directives royales définies par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie dans son discours du Trône, le 29 juillet 2017, visant à moderniser l’Administration et à renforcer l’efficacité au service des citoyens. « il appartient donc au gouverneur et au caïd, au directeur et au fonctionnaire, ainsi qu’au responsable communal, etc., d’adopter les méthodes actives de travail et les objectifs ambitieux des cadres du secteur privé. Mus par le sens des responsabilités, ils doivent faire honneur à l’Administration, et aboutir à des résultats concrets. Car, en définitive, leur responsabilité est de veiller sur les intérêts des gens ».
A la lumière de cette orientation, les réunions prennent une dimension essentielle, elles structurent un écosystème collaboratif, transformant les bureaux en laboratoires d’innovation sociale. Grâce aux outils de Design Thinking24, de prototypage25 et surtout de co-décision, chaque problématique sociale, sanitaire, éducative ou économique devient une opportunité d’action collective et d’innovation partagée.
En effet, l’enjeu dépasse largement la simple formation et relève d’un véritable changement de mentalités collectives, qui se traduit par la co-existence et l’interaction du fonctionnairecitoyen et du citoyen-fonctionnaire.
« Le fonctionnaire-citoyen » est avant tout un citoyen, qui agit depuis sa position administrative avec conscience de ses responsabilités professionnelles tout en respectant les droits, les besoins et les attentes légitimes des citoyens. Il ne se limite pas à appliquer des procédures : il devient un acteur intégrant de manière systémique la dimension civique à son action et favorisant ainsi une gouvernance éthique, participative et proche des citoyens.
Parallèlement, le citoyen-fonctionnaire sur le terrain adopte une posture active et engagée, contribuant à la co-construction des politiques publiques et à la transformation des signaux sociaux en données d’action concrètes.
Cette dynamique crée un écosystème de gouvernance intégrée, où l’interaction continue entre fonctionnaires et citoyens devient un levier de résilience, d’innovation sociale et de renforcement de la confiance, fondée sur la reconnaissance que tout fonctionnaire est d’abord un citoyen engagé.
Cette synergie s’incarne pleinement dans l’expérience de Vigilance Sociale26, qui met en scène l’articulation vivante entre le terrain et l’administration. Le terrain ne se limite plus à un simple espace d’intervention pour devenir un véritable bureau de rencontre, un lieu où s’expriment les besoins, les attentes et les initiatives citoyennes.
Quant à l’administration, elle dépasse sa fonction de gestion ou de décision pour se redéfinir en espace de rencontre, d’écoute et de co-construction. La coordination s’opère aussi au sein du comité régional et des comités locaux chargés de la prise en charge des femmes et enfants victimes de violence27, où le parquet général, la sûreté nationale, la gendarmerie royale, les autorités locales et les services d’éducation, de santé, de jeunesse, de sport, de culture, des affaires islamiques, l’Union Nationale des Femmes du Maroc et la société civile collaborent profondément.
Ces interventions intégrées visent à renforcer la cohésion socio-familiale, éducative et l’inclusion économique, tout en assurant orientation et sensibilisation proactive des bénéficiaires. Elles reposent sur la convergence immédiate des membres des comités à travers des réunions régulières et des groupes de travail thématiques, garantissant l’efficacité, la réactivité et la cohérence des interventions, et transformant les situations critiques en opportunités de développement inclusif et de renforcement du tissu social local.
Cette approche de gouvernance se complète avec le marketing relationnel et le marketing social.
D’une part, le marketing relationnel favorise la confiance entre l’administration et les citoyens, transformant ces derniers en acteurs de la gouvernance. D’autre part, le marketing social dépasse la relation individuelle pour modifier les comportements collectifs, avec la sensibilisation, l’éducation et la communication communautaire comme leviers pour encourager des pratiques conformes à l’intérêt général, telles que la protection de l’environnement, la prévention sanitaire, l’inclusion sociale et la participation civique.
Ces modes de gouvernance intégrative et collaborative instaurent un dialogue permanent, où adaptation et co-construction deviennent la norme. Chaque fonctionnaire, avant tout citoyen, entretient une relation vivante et responsable avec la société, transformant les besoins, les attentes légitimes et les défis en initiatives collectives et consolidant la résilience territoriale.
En définitive, gouverner consiste avant tout à écouter, accompagner, incuber, servir et inspirer : transformer les défis en opportunités, les besoins en projets et les initiatives en un futur commun. C’est dans cette optique que s’inscrit le troisième axe, consacré à la transformation du citoyen bénéficiaire en citoyen producteur, véritable clé de l’écosystème local et garant d’un développement inclusif et durable.
Écrit par Ibtissam El Rhali,
Docteur en Droit public et Sciences politiques
Chercheur en développement humain et auteur de nombreux articles en matière de lutte contre la pauvreté
Lire également : Architecture du développement territorial intégré (1e Partie)
Lire également : Architecture du développement territorial intégré (2e Partie)
20 https://web.facebook.com/photo/?fbid=122099090612157175&set=a.122099089730157175
22 L’ingénierie sociale : approche visant à comprendre et influencer les comportements humains pour renforcer la cohésion sociale et le bien‑être collectif. Ses principes clés incluent :
– Analyse des comportements sociaux : étudier les interactions, normes et valeurs qui structurent la société.
– Participation et engagement : mobiliser les citoyens pour renforcer l’efficacité des actions sociales.
– Planification stratégique : concevoir des interventions basées sur des données et des objectifs précis.
– Adaptabilité et résilience : ajuster les actions selon les dynamiques sociales et contextuelles.
– Communication et mobilisation : coordonner et sensibiliser les acteurs autour d’objectifs communs.
23 Extrait du Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste à la Nation à l’occasion du 18-ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres 29/07/2017
24 Design Thinking : une méthode centrée sur l’utilisateur (humain) et tournée vers l’innovation. Quel que soit le domaine d’application, l’empathie, la créativité, la co-création, l’itération et le droit à l’erreur sont au cœur de cette méthodologie d’innovation. L’objectif est de s’approprier les outils du design pour gérer des projets innovants et résoudre des problèmes, passés ou à venir. Cela permet de concevoir des produits et services innovants pour les utilisateurs, collaborateurs, consommateurs ou usagers. https://usabilis.com/quest-ce-que-le-design-thinking/
25 Le prototypage est un outil de travail collaboratif tangible, d’étude et d’aide à la prise de décision. Il concerne les produits, mais aussi un processus de production, un service réel ou virtuel, l’intégration de plusieurs éléments https://shs.cairn.info/pro-en-marketing–9782311622317-page-190?lang=fr
26 https://web.facebook.com/photo/?fbid=122099090612157175&set=a.122099089730157175
27 Décret n° 2.18.856 du 10 avril 2019 portant application de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants, ce décret définit la composition de la cellule centrale ainsi que des cellules décentralisées chargées de la prise en charge des femmes victimes de violence. Ces cellules sont créées au sein des tribunaux de première instance et des cours d’appel, ainsi qu’au sein des services centraux et déconcentrés des départements chargés de la justice, de la santé, de la jeunesse et de la femme, de même qu’au sein de la Direction générale de la Sûreté Nationale et du Haut commandement de la Gendarmerie Royale.