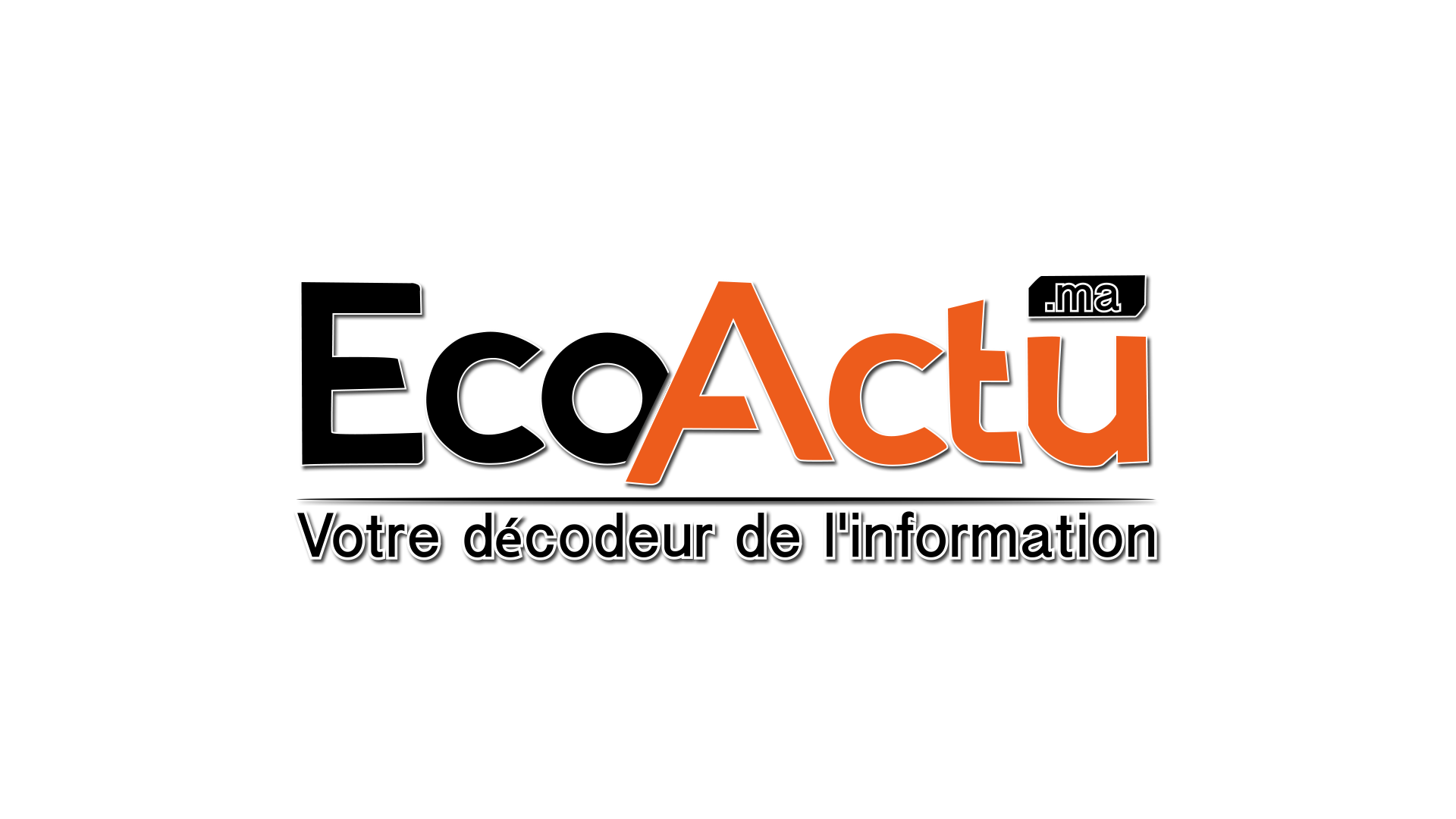Dans la région MENA (l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient), le secteur de l’eau est marqué par une tendance accélérée à l’amenuisement des ressources hydriques avec des périodes de sécheresse de plus en plus avérées et des besoins en croissance soutenue.
« D’ici la fin de cette décennie, la quantité d’eau disponible tombera sous le seuil absolu de pénurie, fixée à 500 mètres cubes par personne et par an » , apprend-on dans le nouveau rapport de la Banque mondiale (BM) intitulé « Aspects économiques de la pénurie d’eau au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : solutions institutionnelles ». D’ici 2050, y est-il indiqué, 25 milliards de mètres cubes supplémentaires d’eau seront nécessaires chaque année pour répondre aux besoins de la région. Est-ce vraiment un problème d’offre ?
Pour faire face au problème de pénurie d’eau qui menace les populations, la plupart des pays de la région investissent massivement dans les infrastructures qui permettent de mobiliser de nouvelles ressources d’eau non conventionnelles, comme le dessalement d’eau de mer et dans une moindre mesure dans la réutilisation des eaux usées dans le mais de répondre aux besoins, actuels et futurs, en eau pour de multiples usages (industriel, touristique, agricole et adduction en eau potable). Ces solutions sont surtout adaptées vers l’augmentation de l’offre en eau et progresseront la mobilisation de sources de financement conséquentes pour mettre en place les systèmes d’approvisionnement, d’acheminement de l’eau vers les centres de demande et son exploitation par des réseaux d’alimentation à grande échelle.
Les différents pays de la région continuent de réformer le secteur de l’eau en misant sur l’augmentation de l’offre par le recours aux eaux non conventionnelles, et s’inscrivent dans la continuité d’un schéma d’investissement centré sur la mise en place de nouvelles infrastructures comme les barrages plutôt que sur la gestion de la demande en eau.
Au fil des années, cette orientation a conforté une perception assez généralisée chez les décideurs selon laquelle le problème de pénurie d’eau serait surtout dû aux contraintes liées à l’offre et a conduit les usagers à ne pas apprécier la ressource à sa juste valeur et les services publics ne sont pas suffisamment nécessaires à l’investissement dans des mesures de réduction des pertes d’eau et d’autres mesures d’efficience.
Dans ce sens, il ressort du rapport de la BM que plus de 30 % de l’eau distribuée par les prestataires de services publics de l’eau dans la région MENA n’est pas facturée aux usagers en raison des effets combinés des pertes physiques et autres. D’autre part, les pays de la région ont depuis longtemps compté sur l’importation de l’eau virtuelle par l’importation de produits agricoles et sur les prélèvements non durables des eaux souterraines pour étendre les superficies irriguées et soutenir une économie de subsistance dans le milieu agricole.
Dans ces conditions, la production agricole a été renforcée et l’accès aux services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans le milieu urbain ont été améliorés mais cette approche a désormais atteint ses limites et une concurrence intersectorielle sur l’eau commence à apparaitre.
Besoin de changement d’approche et de solutions alternatives
Maintenant que la pénurie d’eau se profile dans la région, il est important de reconnaître que l’augmentation de l’offre en eau en ayant recours aux eaux non conventionnelles ne devrait pas être l’unique et ultime solution. Le rapport de la Banque mondiale insiste sur la gravité de la situation et appelle à choisir un autre raisonnement fondé sur des solutions d’ordre institutionnel et en relation avec les outils de l’économie publique en proposant des idées sur les modes d’organisation des organismes publics chargés d’assurer la gestion et l’attribution de l’eau.
Il souligne l’importance de déléguer plus de pouvoirs aux autorités locales en matière de répartition de l’eau, de mettre en place des institutions capables d’obtenir le respect volontaire des lois et des ordonnances publiques sur les questions tarifaires de redistribution,
Les solutions alternatives pour résoudre le problème de pénurie d’eau proposées dans le rapport de la Banque mondiale vont au-delà des aspects purement technicistes. Elles mettent en avant des concepts comme la confiance et la légitimité qui sont représentées sous forme d’institutions »informelles » à prendre en compte dans la conception d’une politique publique autour de l’eau.
Ces concepts peuvent paraître »théoriques » ou abstraits, pourtant tout défaut de confiance et de légitimité entraîne des impacts bien réels et nuisibles à la gestion de la ressource. Ils doivent donc constituer le fondement même des réformes à envisager, pour insuffler un esprit de coopération entre des consommateurs susceptibles d’appréhender et d’adhérer aux révisions tarifaires qu’ils peuvent être assujettis et prêts à payer les redevances dues qui correspondent aux services d’eau utilisés.
Cela permettra aux entreprises de gestion et de distribution de l’eau d’améliorer leur rentabilité économique, de réaliser leur solvabilité financière et de drainer les capitaux du marché international pour financer des infrastructures hydrauliques durables dont la région a tant besoin.
Dans la lignée des solutions proposées, le rôle des collectivités locales est crucial dans la gestion des services de l’eau et peut être mandatée à réaffecter la ressource entre des utilisations concurrentes dans le cadre d’un schéma d’allocation défini au niveau national. Elles peuvent même jouir de »droits de propriété » sur les ressources hydriques locales de telle sorte que chaque collectivité dispose de compétences sur ses ressources propres en eau et sur le financement à long terme du secteur. À l’image des Émirats arabes unis, l’application du principe de « plafonnement et d’échange » peut être répliquée dans d’autres pays de la région MENA.
Le « plafonnement » étant l’obligation de gérer et d’affecter l’eau selon les moyens disponibles en fixant une limite maximale fondée sur des données scientifiques et qui correspondrait aux volumes d’eau pouvant être consommés, prélevés et pollués. De plus, chaque collectivité est appelée à considérer l’eau comme un »bien échangeable » dans la mesure où en cas de pénurie, une collectivité excédentaire en eau peut transférer la ressource à une autre collectivité déficitaire par un protocole d’accord.
Le succès des réformes institutionnelles reste tributaire de l’adoption d’une stratégie de communication claire entre les différents agents concernant la rareté de l’eau et les raisons sous-jacentes à certaines décisions prises par les autorités locales pour rétablir la confiance entre l’ ensemble d’acteurs.
*Ahmed Ouhnini
* Ahmed Ouhnini est économiste au Policy Center for the New South. Son domaine de recherche couvre l’économie agricole, le développement humain et social. Auparavant, il a travaillé comme chercheur à l’École d’économie de Paris (PSE) et a également travaillé dans des services de conseil au Maroc. Ahmed est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en agriculture et développement rural de l’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès et d’un Master en Droit, Economie et Gestion de l’Institut de Développement Paris 1 Panthéon Sorbonne.