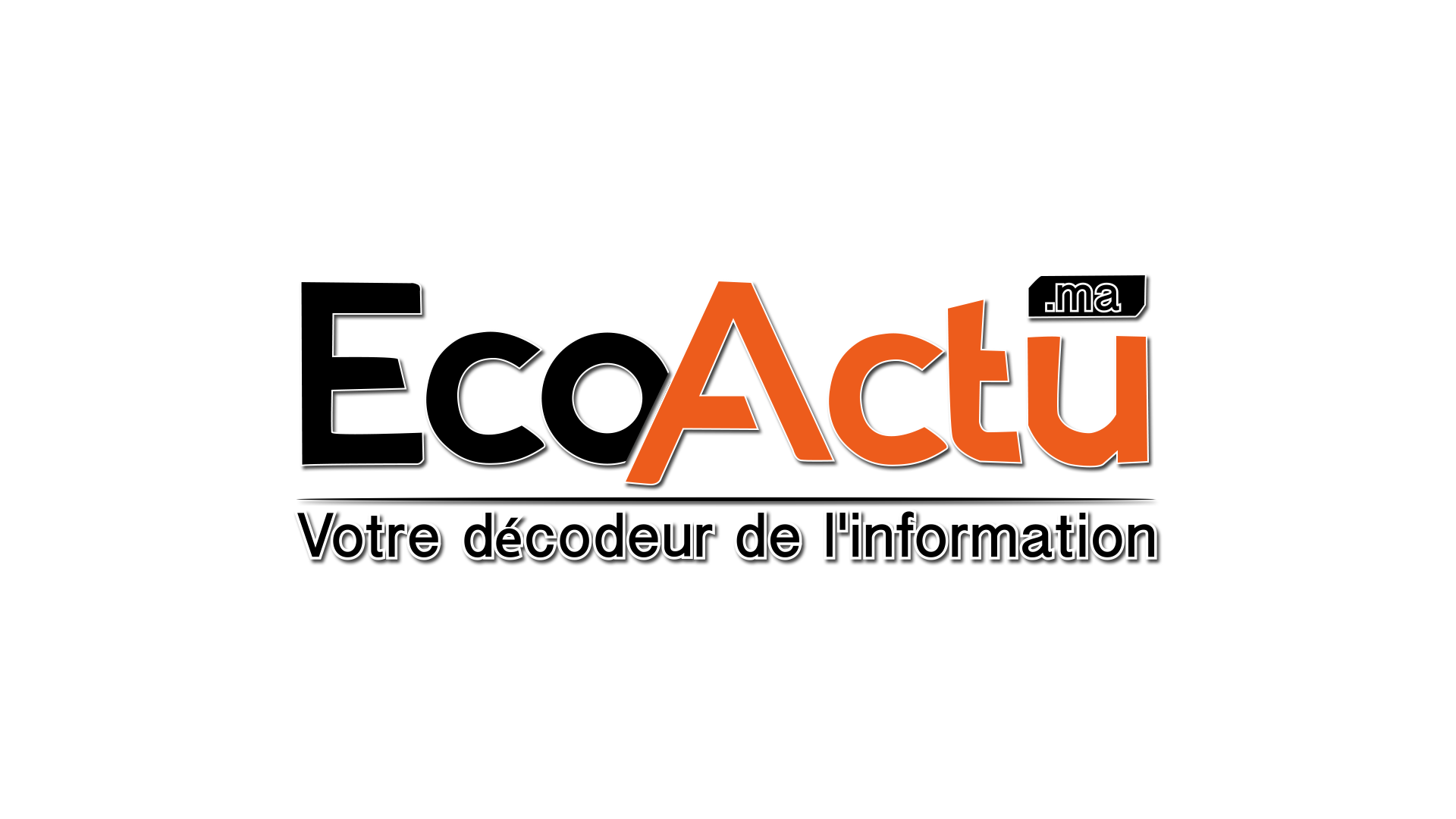La réforme du système de la justice est aujourd’hui un impératif incontournable pour l’Etat de droit qui cherche à garantir une justice efficace, accessible et adaptée aux évolutions technologiques et sociétales. En effet, face aux enjeux croissants de la complexité du contentieux judiciaire et de la demande accrue de rapidité et de transparence, la réforme des procédures judiciaires s’impose comme un levier essentiel pour renforcer la confiance des citoyens à la justice et assurer le respect des droits fondamentaux des justiciables.
Le Maroc, conscient de ces défis, s’est engagé depuis plus d’une décennie dans un processus continu de réforme du secteur de la justice, visant à améliorer la qualité du service public de la justice, à accélérer le traitement des affaires et à intégrer les outils numériques dans la gestion judiciaire.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la récente réforme du Code de procédure civile, visant à moderniser les règles de procédure et à introduire des mécanismes novateurs. Cette réforme traduit la volonté du législateur d’aligner ce code sur les standards internationaux contemporains et de tirer parti des avancées technologiques pour accroître son efficacité.
Cependant, malgré ses objectifs raisonnables, cette réforme a suscité des réserves quant à certaines dispositions qui, à première vue, pourraient compromettre les principes fondamentaux de l’État de droit.
En effet , le président de la Chambre des représentants, conformément à l’article 132 de la Constitution, a saisi la Cour constitutionnelle pour examiner la conformité du projet du Code de procédure civile à la Constitution.
Dans sa décision n° 25/2025 rendue le 4 août 2025, la Cour constitutionnelle a prononcé une censure partielle mais lourde de signification, en affirmant les lignes rouges à ne pas franchir, conformément à son rôle de gardienne de la Constitution. Cette décision, loin d’être un simple acte de forme, s’inscrit dans une jurisprudence désormais solide où la Cour affirme sa détermination à préserver l’équilibre entre réforme et respect des droits fondamentaux des justiciables. Elle a ainsi censuré plusieurs dispositions jugées contraires à des principes consacrés par la Constitution de 2011.
Avant d’entamer l’analyse de cette décision imminente de la Cour constitutionnelle, il convient, dans un premier temps, de présenter les dispositions ayant fait l’objet de la censure par cette juridiction.
I . Les dispositions censurées par la Cour constitutionnelle : révélateurs d’exigences constitutionnelles accrues
La décision n° 25/2025 rendue par la Cour constitutionnelle marque une étape décisive et déterminante dans l’encadrement de l’action du législateur dans le cadre de la réforme du Code de procédure civile. La Cour a posé les jalons d’un contrôle exigeant, fondé sur la protection des Principes constitutionnels fondamentaux.
En premier lieu, la Cour a censuré l’article 17 (alinéa premier), qui autorisait le ministère public à introduire une demande en nullité d’un jugement définitif pour atteinte à l’ordre public, dans un délai de cinq ans. Cette possibilité, dérogatoire, a été jugée excessive, car elle portait atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée, à la sécurité judiciaire et au droit au procès équitable.
En deuxième lieu, les dispositions liées à la procédure de notification prévues dans l’article 84 (quatrième alinéa) du projet, permettaient à l’agent de notification de remettre des convocations à des tiers mineurs d’apparence (seize ans) ou au lien familial mal défini , sont jugés incompatibles à la Constitution. La Cour a prononcé que cette formulation trop vague, incompatible avec les exigences de sécurité procédurale et de clarté prévues par l’article 6 de la Constitution.
Troisièmement, la disposition relative à la participation aux audiences par visioconférence, prévue dans l’article 90 (dernier alinéa), a été censurée en raison de l’absence de garanties claires assurant le respect des droits de la défense. En effet, cet article ne précise ni les conditions, ni les modalités, ni les garanties encadrant cette participation à distance. La Cour a ainsi rappelé que le recours aux outils numériques dans le déroulement des procès ne saurait se faire au détriment des droits fondamentaux des justiciables.
D’autre part, la Cour a mis en lumière une atteinte au principe du contradictoire à travers les articles 107 et 364, en ce qu’ils interdisent aux parties de répliquer aux conclusions du commissaire royal. Cette interdiction a été jugée contraire à l’article 120 de la Constitution, car elle constituait un déséquilibre procédural inacceptable.
Plus encore, l’article 339 (alinéa 2) a été censuré pour avoir prévu l’absence de motivation en cas d’acceptation d’une demande de récusation, en contradiction avec l’article 125 de la Constitution qui exige la motivation des jugements.
S’agissant des garanties institutionnelles, les articles 408 (premier alinéa) et 410 (premier alinéa) ont été jugés inconstitutionnels en ce qu’ils permettaient au ministre de la Justice de saisir la Cour de cassation pour excès de pouvoir des juges. Une telle prérogative, conférée à un membre de l’exécutif, portait atteinte à la séparation des pouvoirs (article 107 de la Constitution).
De même, les articles 624 (deuxième alinéa) et 628 (troisième et dernier alinéas) ont été censurés pour avoir confié la gestion des systèmes numériques et les bases de donnés y afférents, concernant les affaires judiciaires, au Ministère de la justice, ce qui constituait une intrusion manifeste dans l’administration judiciaire relevant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
II . Analyse – Entre ambitions modernisatrices et interrogations sur les garanties procédurales
L’examen du projet du Code de procédure civile met en lumière un double constat : d’une part, la volonté affirmée du Ministère de la justice de moderniser et d’optimiser le fonctionnement de la justice ; d’autre part, les inquiétudes suscitées par certaines dispositions jugées susceptibles de violer les droits procéduraux des justiciables et les principes de la Constitution. La préservation des garanties constitutionnelles fondamentales constitue le fil conducteur de l’analyse qui suit.
A . Une réforme procédurale aux dérives inquiétantes
Le projet du Code de procédure civile s’inscrivait dans une dynamique globale de modernisation de la justice au Maroc, amorcée depuis plus d’une décennie. Il visait principalement à accélérer la gestion des affaires judiciaires, introduire la numérisation à grande échelle, réduire les délais de traitement des litiges, et harmoniser les procédures contentieuses afin d’en améliorer l’efficacité. Ces objectifs répondent aux exigences formulées par les justiciables, les professionnels du droit, et les partenaires institutionnels du secteur de la justice, dans le cadre du dialogue national sur la réforme de la Justice. Ils reprennent également les orientations de la Charte de la réforme de la justice de 2013, qui plaçait au cœur de ses priorités une justice « accessible, efficiente, crédible et indépendante » (Commission nationale de la réforme de la justice, 2013).
Du point de vue technique , les innovations proposées par le projet s’alignaient sur les standards internationaux en matière de justice numérique. L’instauration de procédures dématérialisées, la notification électronique des actes judiciaires, ou encore l’automatisation de certaines tâches de greffe visaient à désengorger les juridictions, tout en renforçant la transparence des processus. Toutefois, l’approche normative adoptée par le législateur a suscité de nombreuses réserves, en raison d’un certain déséquilibre entre les impératifs d’efficacité administrative et les garanties constitutionnelles.
B. Des limites constitutionnelles à ne pas franchir
La décision de la Cour constitutionnelle dans l’affaire n° 25/2025 illustre avec précision les frontières infranchissables que le législateur ne peut outrepasser lorsqu’il entreprend une réforme de grande ampleur du système judiciaire. Si la réforme du Code de procédure civile visait à moderniser et à rendre plus efficace la justice marocaine, elle ne pouvait en aucun cas se faire au détriment des garanties fondamentales inscrites dans la Constitution. En opérant une censure partielle mais ciblée, la Cour manifeste sa volonté de protéger l’équilibre institutionnel, en rappelant que certaines atteintes, même motivées par des objectifs d’efficacité, constituent des violations graves des principes constitutionnels. Cette section analyse les principales dispositions censurées et les raisons juridiques qui justifient leur incompatibilité avec la Loi fondamentale, soulignant ainsi les limites impératives à respecter dans toute réforme procédurale.
1. L’atteinte aux principes de la sécurité judiciaire et de l’autorité de la chose jugée
Parmi les dispositions censurées par la Cour constitutionnelle dans sa décision n° 25/2025 figure une mesure particulièrement problématique du point de vue des principes de l’État de droit : le premier alinéa de l’article 17 du projet de loi, qui autorisait le ministère public à demander la nullité de décisions judiciaires ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Ce dispositif, sans encadrement procédural précis, permettait de réexaminer des jugements définitifs au nom de la protection de l’ordre public, en dehors des voies de recours ordinaires ou extraordinaires prévues par le code de procédure civile, telles que l’appel ou le pourvoi en cassation, bien définies par la loi .
Or, un tel mécanisme portait une atteinte manifeste au principe de sécurité judiciaire, garanti par les articles 117 et 126 de la Constitution . En effet, le respect de l’autorité de la chose jugée constitue l’un des fondements du droit à un procès équitable, dans la mesure où il consacre la stabilité des rapports juridiques et protège les justiciables contre l’arbitraire et l’insécurité.
C’est ainsi que la Cour constitutionnelle a souligné que la remise en cause des décisions judiciaires définitives, instaurant un régime d’instabilité judiciaire, est incompatible avec les exigences de l’État de droit. Cette position s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence internationale en la matière, notamment celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie (CEDH, 28 octobre 1999), la Cour a condamné l’État roumain pour avoir autorisé l’annulation arbitraire d’un jugement définitif, estimant qu’une telle pratique portait atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne.
L’autorité de la chose jugée ne peut être traitée comme une simple formalité ni comme un acte réversible à l’envi de l’administration ou du parquet. Elle constitue au contraire une pierre angulaire de la confiance des citoyens dans la justice et une condition de la légitimité du pouvoir judiciaire.
2. La procédure de notification : entre modernisation procédurale et protection des droits des justiciables
La Cour constitutionnelle, dans sa décision n° 25/2025, a censuré le dernier alinéa de l’article 84 du projet, ainsi que plusieurs dispositions qui y faisaient renvoi (notamment les articles 97, 101, 103, 105, 123 et autres), au motif que ces textes reposaient sur des critères subjectifs et imprécis pour déterminer la validité des notifications. Cette imprécision est apparue contraire à l’exigence de clarté et de lisibilité de la norme juridique, énoncée à l’article 120 de la Constitution , qui garantit les droits de défense. Plus fondamentalement, la Cour a jugé que l’absence de mécanisme fiable de confirmation de réception par le destinataire portait atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, protégés par l’article 120 de la Constitution.
En effet, la notification d’un acte de procédure n’a de valeur juridique qu’à la condition que le justiciable concerné en ait effectivement pris connaissance. À défaut, le procès devient inéquitable, puisque la personne peut être jugée sans avoir eu la possibilité de présenter ses moyens de défense. Cette lecture s’inscrit dans une perspective convergente avec la jurisprudence européenne, notamment l’arrêt Sejdovic c. Italie (CEDH, 2006), qui impose une information effective du justiciable comme condition du procès équitable.
3. L’exigence de garanties procédurales dans les audiences à distance
L’essor de la numérisation dans le domaine judiciaire, bien que porteur de promesses en matière d’efficacité et d’accessibilité, ne saurait se faire au détriment des garanties fondamentales du procès équitable. Dans ce cadre, la Cour constitutionnelle a censuré le dernier paragraphe de l’article 90 du projet, qui autorisait la participation aux audiences par visioconférence. La censure a été motivée par l’absence de précisions relatives aux conditions permettant d’assurer, d’une part, le respect des droits de la défense, et d’autre part, le principe de la publicité des débats, tous deux consacrés respectivement par les articles 120 et 123 de la Constitution.
La Cour a rappelé que si l’usage des technologies numériques peut contribuer à la modernisation du service public de la justice, il ne doit en aucun cas porter atteinte à des droits procéduraux essentiels. Toute dématérialisation de la procédure doit donc s’accompagner de garanties claires, explicites et effectives. L’indétermination des conditions d’application, telle qu’observée dans le texte censuré, ouvre la voie à une mise en œuvre arbitraire, contraire aux exigences de sécurité juridique et de prévisibilité constitutionnelle.
4. Le principe du contradictoire : une garantie procédurale fondamentale à l’épreuve des réformes
L’un des points les plus significatifs de la décision n° 25/2025 de la Cour constitutionnelle réside dans la censure des articles 107 et 364 du projet du Code de procédure civile, qui interdisent aux parties de répondre aux conclusions du commissaire royal de la loi et du droit. En jugeant ces dispositions incompatibles à l’article 120 de la Constitution, la Cour a fermement réaffirmé le caractère intangible du principe du contradictoire, pierre angulaire du droit à un procès équitable. C’est un principe essentiel des droits fondamentaux des justiciables.
Le principe du contradictoire, en tant qu’exigence procédurale essentielle, impose que toute partie à un litige soit mise en mesure de connaître les prétentions et arguments avancés contre elle, et de les discuter dans des conditions équitables. Ce principe garantit l’égalité des arguments entre les parties et constitue un socle incontournable de la justice démocratique ,permettant aux parties de répondre à toute intervention, même émanant d’un organe non partie au litige, dès lors que celle-ci est susceptible d’influencer le jugement.
En effet, la Cour constitutionnelle a souligné que les conclusions du commissaire royal peuvent orienter l’analyse du juge et affecter indirectement les droits substantiels des parties. Il en résulte que leur discussion contradictoire constitue une garantie essentielle d’un procès loyal. L’interdiction générale et absolue d’y répondre instaurait une rupture d’équilibre procédural, contraire aux dispositions constitutionnelles, mais également aux standards internationaux, notamment ceux prévus dans l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Maroc a ratifié.
5 . Obligation de motivation des décisions judiciaires: un principe à portée générale
La Cour constitutionnelle a censuré l’article 339 (deuxième alinéa ) qui dispensait de motivation les décisions acceptant une demande de récusation. Cette disposition a été jugée contraire à l’article 125 de la Constitution, lequel énonce de manière générale que les jugements doivent être motivés. En droit constitutionnel, la motivation des décisions judiciaires constitue une garantie essentielle de transparence et de respect du droit à un procès équitable.
La motivation permet aux parties de comprendre les raisons ayant conduit le juge à trancher dans un sens donné, et assure un cadre à l’exercice de voies de recours. En privant certains actes juridictionnels de cette exigence, le texte introduit une rupture d’égalité entre les justiciables et une violation de la légitimité de la décision judiciaire.
6 . La gestion des affaires judiciaires par l’exécutif : une atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire
La décision n° 25/2025 de la Cour constitutionnelle a mis en lumière l’inconstitutionnalité de plusieurs dispositions du projet du Code de procédure civile qui consacraient une forme d’ingérence de l’exécutif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Parmi elles, les articles 408 ( premier alinéa ) et 410 ( premier alinéa ) ont été explicitement censurés en raison de la compétence qu’ils accordent au ministre de la Justice pour saisir la Cour de cassation dans des cas d’excès de pouvoir ou de suspicion légitime, empiétant ainsi sur des prérogatives réservées au pouvoir judiciaire.
Plus largement, une disposition très controversée prévoyait la mise en place d’une plateforme numérique, placée sous la tutelle directe du Ministère de la justice, destinée à gérer une plate- forme numérique au sein des juridictions. Cette mesure, présentée comme un levier de modernisation et de rationalisation du service public de la justice, a été jugée contraire au principe d’indépendance du pouvoir judiciaire, tel que garanti par l’article 107 de la Constitution. En effet, ce dernier affirme de manière catégorique que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif », et interdit toute forme d’influence de l’un sur l’autre.
La Cour constitutionnelle a estimé que confier au ministère de la Justice — autorité relevant du pouvoir exécutif — un rôle direct dans l’organisation interne du travail juridictionnel revient à rompre l’équilibre des pouvoirs établi par la Constitution. Ce transfert de compétence porte atteinte à l’autonomie fonctionnelle et organisationnelle des juridictions, lesquelles relèvent exclusivement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ). La gestion des outils numériques judiciaires constitue un acte éminemment juridictionnel, qui ne peut être exercé que par l’autorité judiciaire indépendante, afin de garantir l’impartialité, la transparence et l’égalité devant la justice.
Par cette décision, la Cour constitutionnelle a consacré l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis le pouvoir exécutif. Elle implique concrètement que les magistrats doivent être mis à l’abri de toute ingérence politique ou administrative dans l’exercice de leurs fonctions, y compris dans les opérations internes de gestion des affaires liées aux systèmes numériques. Elle a également rappelé que le recours à des outils numériques dans le champ judiciaire, s’il est souhaitable, doit être strictement encadré, afin d’éviter tout détournement de leur finalité par des logiques de contrôle administrative du pouvoir exécutif.
Ce faisant, la Cour a consolidé le principe fondamental de séparation des pouvoirs, garant indispensable de l’État de droit, condition essentielle de la confiance des citoyens dans l’équité et l’impartialité de la justice.
III. Trois principes constitutionnels réaffirmés : une leçon de droit constitutionnel à retenir
La décision de la Cour constitutionnelle n° 25/2025 ne se limite pas à censurer certaines dispositions du projet du Code de procédure civile. Elle en profite pour réaffirmer avec une grande clarté trois principes fondamentaux inscrits au cœur de la Constitution marocaine de 2011, qui doivent guider toute réforme judiciaire: la sécurité judiciaire, l’indépendance du pouvoir judiciaire, et le droit à un procès équitable. Leur application rigoureuse constitue un rempart indispensable face aux dérives potentielles d’une réforme menée sans garde-fous constitutionnels.
A . La sécurité judiciaire : un pilier de l’État de droit
En consacrant l’inviolabilité de la chose jugée et le caractère certain des notifications, la Cour constitutionnelle réaffirme avec vigueur le principe fondamental de sécurité judiciaire, pilier de tout État de droit. Ce principe est mentionné dans le texte de la Constitution de 2011, notamment dans son article 117. La sécurité judiciaire implique que les règles de droit soient accessibles, claires, stables, et que leur application par les juridictions soit prévisible. Elle exige également que les citoyens puissent se fier aux décisions de justice rendues, lesquelles doivent être définitives, exécutoires et non arbitrairement remises en cause.
Dans sa décision n° 25/2025, la Cour a censuré une disposition législative tendant à relativiser les effets de la chose jugée, en ouvrant excessivement la voie à une remise en cause de jugements définitifs. En rappelant que l’autorité de la chose jugée garantit la stabilité des situations juridiques, elle souligne qu’un tel mécanisme, s’il n’est pas strictement encadré, risque d’installer un climat d’insécurité juridique et d’éroder la confiance des justiciables dans le système judiciaire. La Cour insiste sur le fait que la justice ne peut être un processus sans fin, où les décisions seraient perpétuellement fragiles ou conditionnelles. Une telle incertitude serait préjudiciable non seulement aux individus, mais aussi aux opérateurs économiques, aux investisseurs, et à l’ensemble des acteurs sociaux.
Il est à rappeler que la Cour Constitutionnelle, dans sa décision n° 70/2018, avait consacré, de manière implicite mais claire, le droit à l’exécution des décisions de justice, considérant qu’il s’agit là d’un prolongement nécessaire du droit à un procès équitable.
Par sa décision n°25/2025, la Cour considère la sécurité judiciaire comme une garantie constitutionnelle, non seulement pour protéger les justiciables, mais aussi pour assurer la crédibilité, l’efficacité et la stabilité du système judiciaire marocain.
B. L’indépendance du pouvoir judiciaire : une exigence constitutionnelle
La séparation des pouvoirs constitue une véritable garantie constitutionnelle, pierre angulaire de toute démocratie moderne. La Constitution marocaine de 2011 consacre explicitement ce principe à travers l’article 107, qui stipule que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ». Cette disposition revêt une portée contraignante, imposant aux pouvoirs législatif et exécutif de respecter scrupuleusement cette indépendance dans l’exercice de ses prérogatives. L’autonomie judiciaire ne saurait se réduire à l’indépendance des juges dans leurs fonctions : elle englobe également une indépendance organisationnelle, administrative et fonctionnelle.
Cependant, la décision n° 25/2025 illustre avec une grande rigueur cette règle constitutionnelle, sachant que l’indépendance du pouvoir judiciaire constitue une garantie démocratique indispensable pour protéger les droits fondamentaux et assurer l’équilibre institutionnel et la crédibilité du système judiciaire dans sa globalité.
A vrai dire, l’intervention de l’exécutif dans les fonctions du pouvoir judiciaire constitue une menace directe à l’impartialité des juges, ouvrant la voie à des pressions politiques ou à une instrumentalisation de la justice. L’indépendance des juges est la condition essentielle de la légitimité des décisions judiciaires. Elle garantit aux citoyens que la justice sera rendue en toute impartialité, sans influence politique ni contrainte hiérarchique extérieure.
C . Le droit à un procès équitable : socle des garanties de la procédure civile
La décision n° 25/2025 de la Cour constitutionnelle rendue le 4 août 2025 incarne une application dynamique et substantielle du principe du procès équitable, tel qu’il est consacré tant par la Constitution marocaine de 2011 que par les engagements internationaux du Royaume. En censurant plusieurs dispositions du projet du Code de procédure civile, la Cour rappelle que toute réforme des procédures judiciaires ne saurait se faire au détriment des droits procéduraux fondamentaux des justiciables.
Le droit à un procès équitable est un concept juridique composite qui englobe plusieurs garanties indissociables : le droit d’être entendu, le respect du contradictoire, le droit d’accès à un tribunal impartial et indépendant, et la possibilité de présenter ses moyens de défense dans des conditions d’égalité. Ces exigences sont explicitement reconnues par l’article 120 de la Constitution, qui énonce que « toute personne a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable » et par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par le Maroc en 1979.
En outre, la décision de la Cour constitutionnelle s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Internationale, notamment celle de la Cour européenne des droits de l’homme, comme nous avons cité précédemment.
En somme, la décision du 4 août 2025 ne se limite pas à une lecture formelle du droit ; elle adopte une vision matérielle et protectrice du procès équitable, veillant à ce que chaque étape procédurale renforce la confiance des citoyens dans une justice transparente, équilibrée et respectueuse des droits de la défense. Elle rappelle que l’efficacité procédurale ne doit jamais supplanter les garanties fondamentales du justiciable.
Conclusion :
La décision n° 25/2025 de la Cour constitutionnelle relative au projet du Code de procédure civile marque un tournant majeur dans le contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires au Maroc. Elle consacre une jurisprudence audacieuse et rigoureuse, dans laquelle la Cour ne se contente plus d’un contrôle formel de conformité, mais s’engage dans une lecture substantielle des principes constitutionnels, au premier rang desquels figurent la séparation des pouvoirs, la sécurité judiciaire, et les garanties des droits fondamentaux des justiciables.
En censurant plusieurs articles du projet, la Cour rappelle que toute réforme judiciaire, aussi ambitieuse soit-elle, doit se déployer dans le strict respect des dispositions constitutionnelles. Elle réaffirme la suprématie de la Constitution comme norme de référence, et établit une ligne rouge à ne pas franchir par le pouvoir exécutif.
Par son éminente décision, la Cour constitutionnelle a consacré la consolidation de l’État de droit au Maroc, où le juge constitutionnel devient progressivement un acteur central dans la préservation des équilibres entre les institutions.
Par Khalid Cherkaoui Semmouni,
Professeur de droit constitutionnel
Membre de l’Association française du droit constitutionnel
Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.