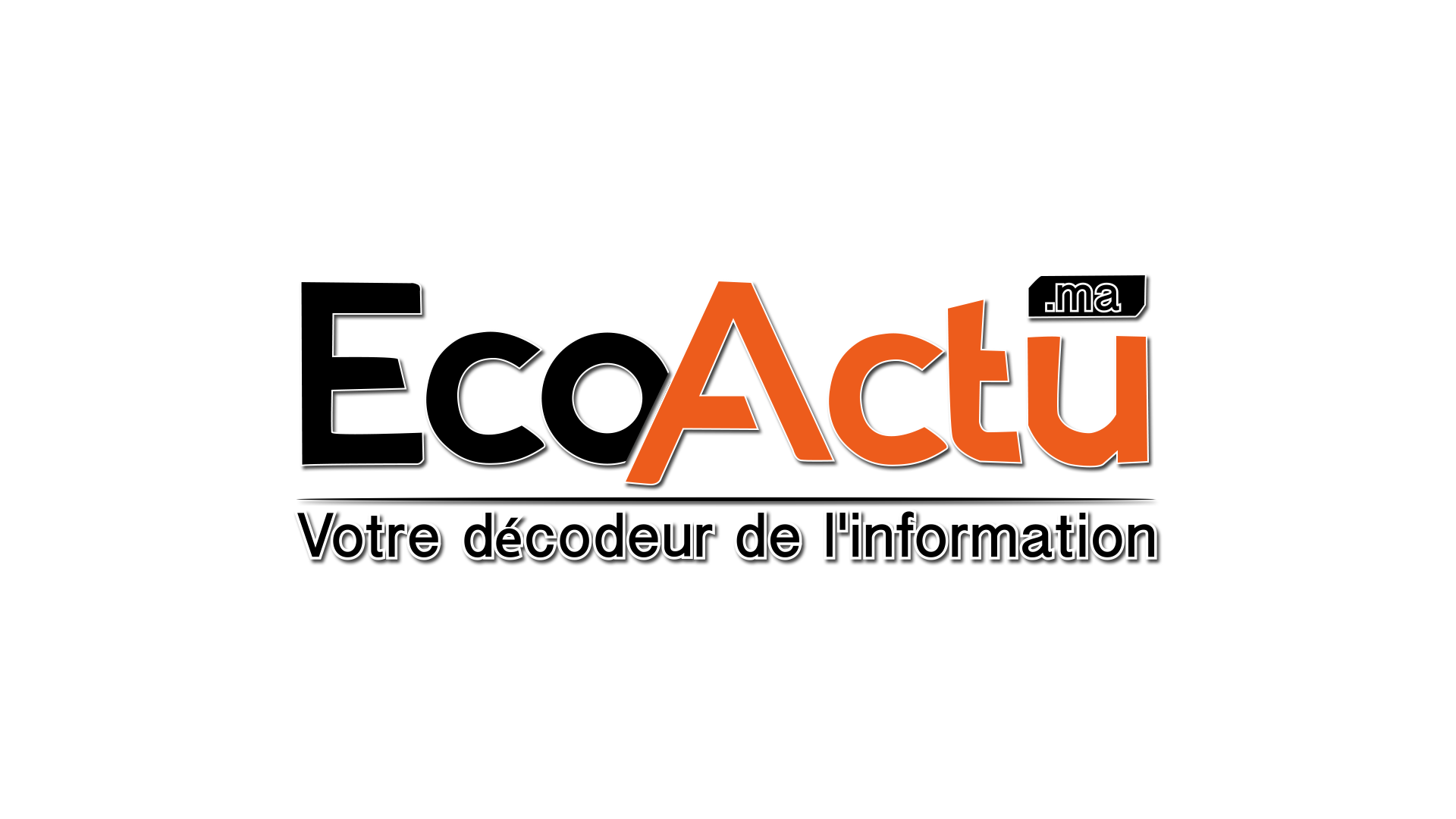Au moment où les concertations avec les forces politiques sont en cours pour la préparation des prochaines législatives de septembre 2026, nous voudrions contribuer à ce débat national en nous interrogeant sur le mode de scrutin qui nous parait le mieux approprié pour notre pays et pour notre jeune démocratie.
Le mode de scrutin ne se réduit pas à un problème technique, mais il revêt une dimension politique de taille. Et ce n’est pas un hasard qu’il fasse l’objet de controverses non seulement entre forces politiques, mais également entre constitutionnalistes et professeurs de droit.
Bien sûr, il n’y a pas de solution miracle et de voie royale toute tracée. En théorie, chaque mode de scrutin comporte des avantages et des inconvénients.
Rappelons que les différents modes de scrutin sont principalement au nombre de trois grands types : le scrutin majoritaire, le scrutin proportionnel, et le scrutin mixte.
Le scrutin majoritaire attribue les sièges aux candidats ou listes ayant obtenu le plus de voix. Il peut être uninominal (un seul élu par circonscription) ou plurinominal (plusieurs élus par circonscription), et à un ou deux tours. Ce mode favorise souvent les partis ou candidats arrivés en tête, avec une majorité relative ou absolue, ce qui peut amplifier la victoire de certains partis au détriment des plus petits.
En revanche, le scrutin proportionnel répartit les sièges au sein d’une assemblée en fonction du pourcentage des voix obtenues par chaque parti. Il vise à une représentation plus équitable des différentes forces politiques, mettant peu l’accent sur les individus au profit des listes politiques.
Le scrutin mixte combine des éléments des deux systèmes précédents, cherchant à cumuler les avantages du scrutin majoritaire et du scrutin proportionnel et limiter leurs inconvénients.
Toutefois, ces modes varient selon les pays, les types d’élections, et les contextes politiques, offrant des mécanismes divers pour traduire les suffrages en mandats élus. Chacun des systèmes a ses avantages et ses inconvénients.
Les scrutins proportionnels conduisent souvent à une instabilité du système politique ; ils favorisent le multipartisme et donnent un rôle important aux petits partis charnières, souvent partenaires indispensables des majorités.
Les scrutins majoritaires conduisent le plus souvent à l’apparition de majorités stables, fondées sur un affrontement avec l’opposition (la coalition qui l’emporte gouverne seule) et au prix d’une certaine injustice dans la représentation.
Le scrutin majoritaire à deux tours incite plus de partis à conclure des alliances pour le second tour et constitue un gage de stabilité politique. Mais il est coûteux en temps et en argent
Ces principes constituent la base des modes de scrutin dans les démocraties contemporaines.
Le Maroc a adopté depuis les premières élections jusqu’en 2002 le mode de scrutin uninominal à un tour. Ce système a montré progressivement ses limites : il favorise l’élection des notables et la corruption électorale ; il génère des mécontentements des candidats ayant échoué pour quelques voix de moins par rapport au candidat élu, souvent à une majorité toute relative ; il marginalise la présence des partis politiques dans la mesure où le vote est plus personnel surtout durant les premières législatures quand des candidats, désignés à tort indépendants, pouvaient se présenter sans étiquette politique. Ce sont ces « Indépendants » qui ont été rassemblés dans un parti qui est majoritaire aujourd’hui.
De « moul chkara » …
Ce système a fait l’objet de critiques et de remises en cause, notamment de la part des partis progressistes de gauche. Ce qui a conduit à l’adoption d’un scrutin de liste lors des élections de 2002 au niveau des provinces et préfectures avec un nombre de sièges variant entre 2 et 6 en fonction du nombre d’électeurs. L’attribution des sièges se fait selon le quotient électoral avec le plus fort reste. Il s’est avéré, dans la pratique, que ce système ne diffère pas sensiblement du précédent, voire il encourage plus les forces de l’argent. C’est toujours la « tête de liste » qui est mis en scène et les partis demeurent marginalisés. Leur rôle se limite à la recherche de « l’oiseau rare » qui n’est autre que « moul chkara ». La contribution du militant consiste à distribuer les tracts et à amuser la galerie. La configuration de l’actuel parlement en dit long à ce sujet. Il faut souligner une certaine amélioration de ce système avec l’adoption d’une liste de jeunes et de femmes, d’abord au niveau national avant d’être ramenée au niveau des régions.
…A l’élu de la Nation.
Si notre pays voulait effectivement donner un coup de pouce à son processus démocratique, il n’aurait d’autre choix que d’adopter le scrutin de liste proportionnel avec le plus fort reste. La nature du régime politique, « une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. » (Selon l’article premier de la constitution), plaide dans ce sens. C’est ce scrutin qui convient le mieux à notre pays. Les avantages l’emportent largement sur les inconvénients. En intégrant dans le jeu politique l’ensemble des sensibilités et des expressions, on assure plus de stabilité à notre pays et plus de cohésion à notre nation. En associant l’ensemble des citoyens à l’effort de construction du Maroc de demain, on facilitera sûrement les transitons, on évitera les chocs générationnels et les frustrations sociales qui risqueraient de faire mal au pays.
On critique souvent les partis politiques et leur faible présence sur le terrain. Encore faut-il leur donner l’occasion réelle d’exister en assurant l’égalité des chances et en permettant aux cadres aguerris dans les affaires politiques de siéger au parlement pour lui faire jouer effectivement son rôle constitutionnel : bien légiférer en produisant des lois avancées, contrôler le gouvernement et le sanctionner le cas échéant, offrir une image positive du Maroc à l’international en portant haut et fort sa voix. Un député, c’est d’abord un élu de la Nation.
Pour une parité parfaite
En outre, le multipartisme connaitra une existence réelle y compris au niveau de la formation des majorités gouvernementales. De toutes les façons, quel que soit le gouvernement en place, il demeure toujours le « gouvernement de Sa Majesté ». C’est le Roi, de par la Constitution, qui définit et arrête les choix stratégiques et les grandes orientations du pays.
Il reste à définir le champ d’application de cette proportionnelle. L’idéal serait de constituer des listes nationales. Mais on pourrait opter d’une façon transitoire pour des listes régionales en retenant une seule liste pour chaque région composée de deux sexes avec 6 têtes de listes femmes et 6 autres hommes tout en respectant l’ordre homme femme et l’inverse. On aura ainsi fait d’une pierre deux coups : réhabiliter le politique et appliquer une parfaite parité. Le Maroc ne doit pas rester à la traine sur ce sujet. Il faut oser. Le gain pour notre pays est assuré. Y compris au niveau du Mondial 2030.