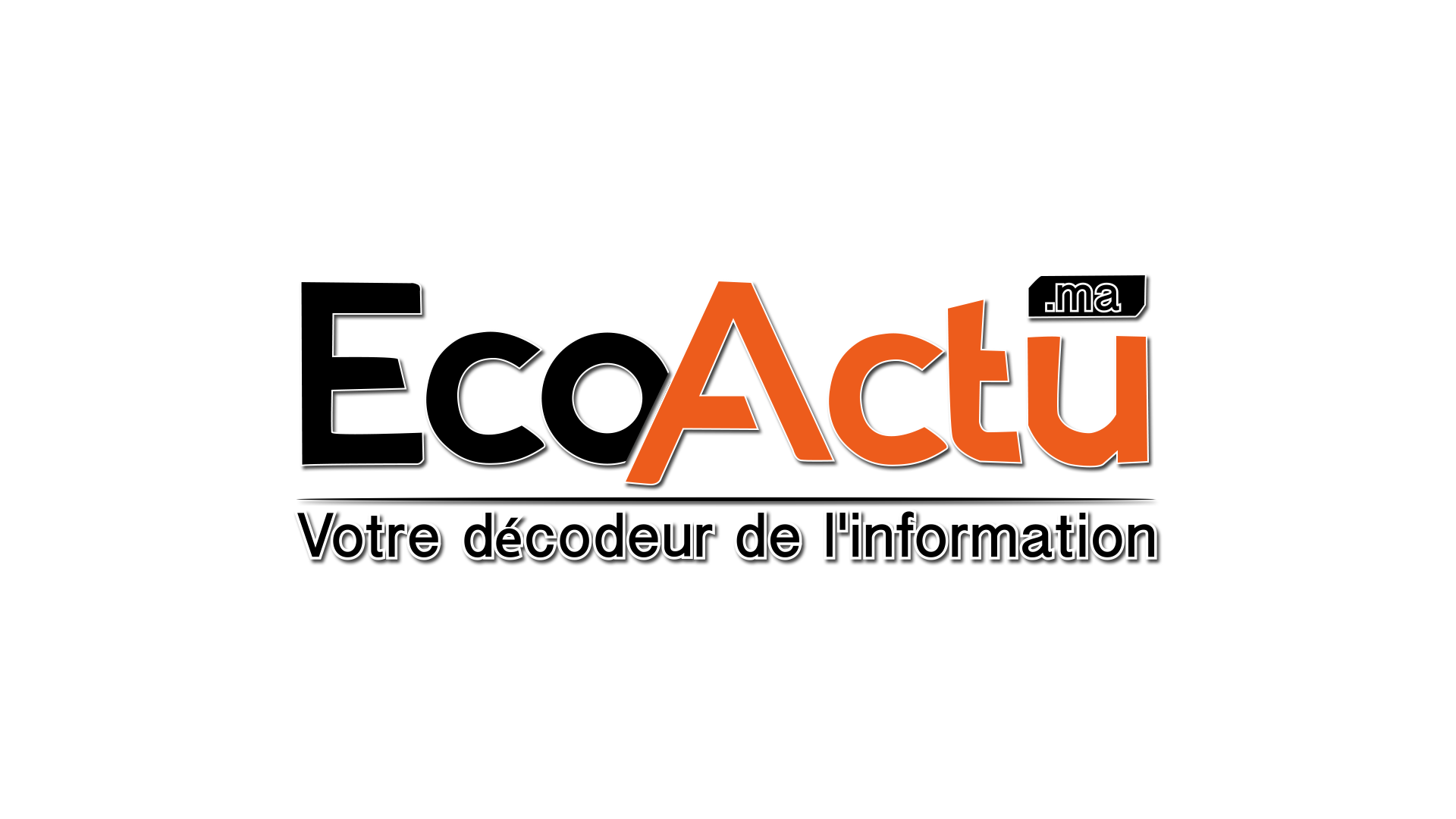Ecrit par Imane Bouhrara I
Cachet authentique du Maroc, le douar, comme premier noyau d’habitation et d’auto gestion de la population, a été graduellement dépossédé de son rôle et sa fonction au point d’être invisibilisé. Il est quasiment éclipsé dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. Pourtant, il peut être un important relais de développement économique, social et patrimonial. OTED a réuni les experts pour explorer les voies d’une valorisation et de modernisation des douars.
L’initiative citoyenne OTED poursuit un travail minutieux et scientifique en relevant les questions liés aux territoires et leur place institutionnelle. Ce 10 octobre, s’est tenue une nouvelle édition de Parlons Territoires sous le thème : « Les douars entre patrimoine socioculturel et dilution institutionnelle », donnant ainsi la parole aux experts pour mieux éluder le sujet.
D’emblée, Sanae Alami Afilal d’OTED, plante le décor. L’objectif est d’appréhender le douar en tant qu’unité de base de l’organisation sociale, économique et territoriales dans les zones rurales et périurbaines. Et surtout la possibilité d’une reconnaissance institutionnelle.
Le sujet est poignant dans la mesure où le Maroc compte environ 42.000 douars où vivent la moitié des citoyens du monde rural pourtant le douar ne dispose pas d’une reconnaissance institutionnelle clairement définie.
Comment dès lors revitaliser le rôle du douar comme espace et vecteur de développement sociaux économique, avec comme levier la protection du patrimoine.
Dans son intervention, Samira Mizbar, Socio-économiste, docteur en dynamiques comparées des sociétés en développement, précise qu’elle inclue dans son propos les Ksours, qui bien qu’ils soient des agglomérations humaines dans le désert mais dans des espaces ruraux. Et par conséquence subissent le même sort que les douars.
Elle rappelle également un autre élément que le protectorats français et espagnole ont imposé une grille de lecture de l’espace marocain qui ne correspond en rien à la philosophie de l’occupation de l’espace par sa population.
« Donc nous avons une grille de lecture motivée par la volonté de contrôler à la fois espace et population… cette grille de lecture s’était matérialisée par une découpage territoriale, dont la logique continue de perdurer… », explique-t-elle.
Elle évoque également le fait que beaucoup d’agglomérations humaines sont complétement invisibilisées et effacées même du système de gouvernance ; mais également perçues négativement. D’où le risque de déclin.
Pour autant, la politique des centres émergents a été mise en place pour réorganiser ces douars, il y a une quinzaine d’année… explique Samira Mizbar. Mais s’est posé dès lors la problématiques des critères et des indicateurs de mesure comme la population, le niveau d’éducation.
Pour S. Mizbar, à tout cela manquait les aspects patrimonial et culturel, qui eux, ne peuvent pas être mesurés, ce qui constitue en soi des limites de la grille de lecture post-coloniale du douars.
Pour sa part, Mohamed Tozy, Professeur des universités Directeur délégué à la recherche à Science Po Aix, rappelle qu’historiquement le douar est lié au pastoralisme, avec des formes d’autogestion par les populations.
Au-delà d’un lieu d’habitation, le douar est un lieu de vie et de développement durable. C’est une forme d’organisation qu’on peut qualifier de politique avec des caractéristiques communes qu’on retrouve partout lorsqu’on visite le Maroc notamment une mosquée, un cimetière des lieu plus au moins sédentarisé, plus au moins groupé.
Mais, quelques faits marquants vont éclipser graduellement le douar. À l’indépendance c’est le processus de construction de la nation de façon assez violente liée d’ailleurs au nationalisme une sorte de neutralisation de toutes les entités intermédiaires à la nation, notamment la tribu.
Le fait est dans la réalité on a opté pour la commune comme premier niveau de représentation politique, dixit le Dour désormais invisibilisé, sur le plan politique mais aussi administratif.
Deuxième temps qui illustre comment le douar a été « dépossédé » de cette autogestion, le déploiement de la scolarisation qui s’est illustrée dans ces espaces de vie parce que Tozy appelé les classes isolées faire intervenir les populations concernées.
Idem pour le recensement de la population, où on a abandonné le douar comme unité de recensement au profit du district de recensement qui regroupe plusieurs douars.
Et enfin, le déploiement du programme d’électrification, qui a considéré le douar comme unité d’électrification au lieu de la commune.
Pour qu’enfin, le NMD vient remettre le douar sous les feux des projecteurs et défendre son importance dans la mise en place des politiques publiques que ce soit pour la dimension patrimoniale et territoriale.
Il en est de même de la participation collective à la vie politique à repenser à travers la démocratie participative, soit à travers des mécanismes de représentation ou à travers les associations locales comme parties prenantes dans la définition des politiques territoriales.
Ce qui implique de prendre en considération aussi bien es caractéristiques communes des douars que les points de différence.
Dans ce sens, Mohamed Mehdi, professeur de Sociologie rurale et membre de l’association Targa Aide et du CRESC, rappelle que les douars sont différents les uns des autres, du point de vue de ce que les agronomes appellent les écosystèmes agricoles ( Montagnes, oasis, plaines, le Sahara…). Deux douars d’une même région peuvent être différents sous l’effet des facteurs climatiques de différenciation, ou de déterminants historiques.
Dans un tel contexte il est difficile d’éluder les dynamiques sociales, économiques et culturelles au sein des douars et si une étude ou monographie est réalisée, ses résultats n’ont qu’une validité locale qui ne peut être généralisée à l’ensemble des douars.
Pour illustrer cette différence, dans les douars du versant sud du Haut Atlas que Mohamed Mahdi connaît puisqu’il en est issu et suit de près, de nouvelles dynamiques prennent forme pour ne citer que l‘immigration amorcé depuis les années soixante par Félix Mora, un recruteur pour les charbonnages de France (donc des jeunes qui quitte le douar). Un phénomène qui va opérer une transformation progressive au sein des douars concernés qui vont plus vivre des transferts des émigrés que de la production agricole. Aussi insolite que cela puisse paraitre, mais cette fois dans le versant nord, dans la tribu Rherhaya à Imlil, l’immigration internationale était quasi absente, les paysans continuent de vivre de l’activité agricole la développement d’une production de subsistance à une production tournée vers le marché.
Reconstruction d’Al Haouz, le Douar encore une fois éludé ?
Les tristes événements du 8 septembre 2023 ont dévoilé la réalité d’évolution des douars comme espace de vie dans le Haouz, générant une mobilisation tous azimuts pour venir en aide aux populations sinistrés. Depuis, l’État a déployé un programme de reconstruction. Mais dans quelle mesure ce programme sort-il des ornières qui ont de tout temps dictés les politiques publiques vers les douars ? Surtout qu’il est pensé et imposé sur le modèle de la ville ?
Mohamed Mehdi explique qu’à ce sujet il y a des narratifs très contrastés. D’un côté, un narratif officiel assurant se baser sur des données statistiques, mais de l’autre, un narratif des représentants de la société civile et d’experts plus sensibles aux aspects sociologiques de ces lieux de vie que sont les Douars. Notamment un patrimoine, des traditions un mode de construction, un mode d’activité agricole ou pastorale, une histoire et une mémoire collective que ce programme peinerait à reproduire à l’identique.
Il faut se résoudre à croire que cette reconnaissance institutionnelle du Douar est conditionnée par plusieurs éléments.
Pour Mohamed Tozy, il faut connaître pour reconnaître. la première chose à faire, serait donc de résorber le déficit de connaissances sur le douar dans sa diversité et son pluralisme. Notamment une dissociation entre le douar comme unité de production agricole et le douar comme lieu de vie, pour reconnaître la contribution de ces « gardien du paysage » comme les appellent Tozy, à la richesse nationale et à la collectivité nationale. Il soulève dans ce sens un élément important de cette reconnaissance, la révision des concepts notamment la productivité ( se résume-t-elle au nombre de quintaux produits ou à l’apport à durabilité) et par ricochet la contribution au PIB. Ce qui favoriserait une équité dans le partage des ressources (l’accès à certains services publics est plus cher dans les douars qu’il ne l’est dans les villes par exemple).
Mohamed Mehdi préconise pour sa part une reconnaissance tout court et non institutionnelle qui apporterait une couche de plus à une organisation qui a plus besoin de l’épanouissement du facteur humain, notamment les initiatives émanant du local vers le général dans un cadre administratif moins sclérosé que celui de la commune, qui peut parfois bloquer certaines dynamiques positives au sein des douars et portées par les gens du douar. Qu’elles soient culturelle, économique ou patrimoniale assurant une vie dans ces espaces.
Dans le même sillage, Samira Mizbar insiste pour dire que ces sont les habitants des douars qui savent ce qu’ils veulent et par conséquent toute reconnaissance qui va à l’encontre de cette volonté ne peut être que contre-productive. Elle cite particulièrement une catégorie qui doit avoir voix au chapitre, la diaspora du Douar à l’étranger puisqu’elle est source de financement, de développement et de modernisation des douars.
L’idée n’est certainement pas de prendre la place de l’État. Elle regrette néanmoins que pour les questions sociales en général, il y a des interpénétrations voire même des conflits dans les missions des institutions, ce qui est dommage.
Sur le plan économique, les expériences de certaines coopératives sont réussies, ce qui est la preuve qu’il y a des moyens de fédérer pourvu que ces coopératives soient bien accompagnées.
Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.