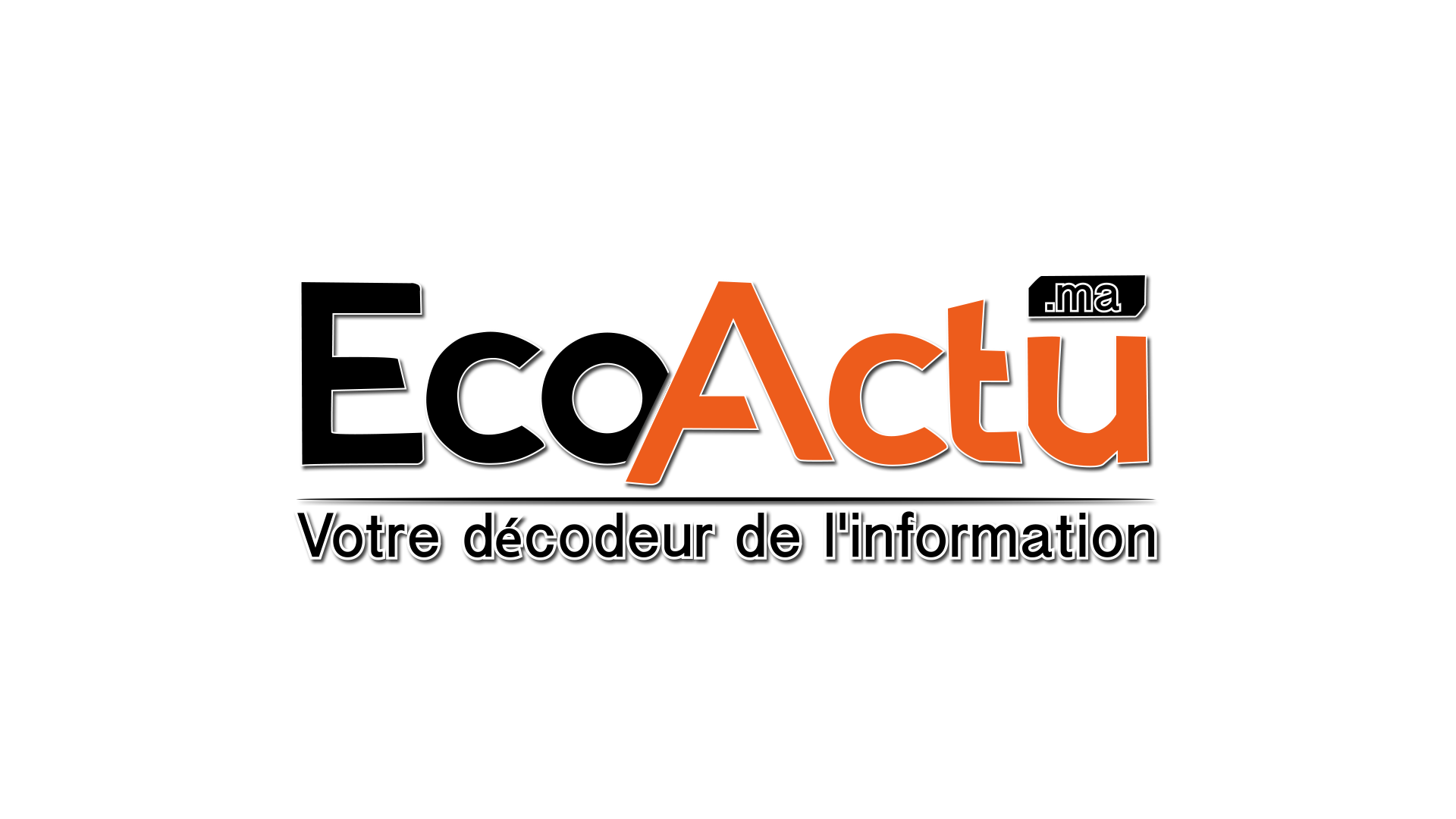Dans les économies en développement, l’informel représente une part essentielle mais encore largement exclue des politiques publiques. Ce texte explore les leviers permettant d’inciter les acteurs économiques de l’informel à rejoindre progressivement le secteur formel, sans briser leurs dynamiques propres ni altérer les équilibres socio-économiques. L’analyse met en évidence les facteurs d’attachement à l’informel — flexibilité, méfiance institutionnelle, attractivité des prix pour les consommateurs — et identifie des stratégies de transition fondées sur la valeur ajoutée immédiate, la simplification administrative, la fiscalité adaptée et l’accompagnement post-formalisation.
Une attention particulière est portée à la problématique de la TVA pour les petits commerçants nouvellement formalisés, ainsi qu’à la mise en œuvre parallèle de réformes sociales telles que la santé, l’éducation et la sécurité sociale universelle. À travers des exemples réels issus du Maroc, du Rwanda, du Brésil ou encore du Sénégal, l’étude propose une approche progressive, inclusive et hybride de la formalisation. L’objectif n’est pas d’imposer un modèle unique, mais de construire un écosystème de confiance où le formel devient une opportunité crédible et désirable.
Introduction : L’informel au cœur des fractures économiques contemporaines
L’économie informelle est loin d’être un phénomène marginal. Selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT, 2018), plus de 60 % de la population active mondiale est engagée dans des activités informelles, dont une proportion significative dans les pays en développement. Ce secteur constitue à la fois une réponse à la rigidité du formel et un facteur de vulnérabilité institutionnelle.
Au Maroc, l’informel contribue à plus de 11 % du PIB selon le Conseil économique, social et environnemental (CESE, 2022), tout en maintenant une population active de plusieurs millions de travailleurs en dehors de la protection sociale, des filets de sécurité sanitaire, et de la fiscalité nationale. Pour autant, cette économie parallèle ne peut être simplement supprimée : elle doit être comprise, accompagnée, puis transformée.
La question centrale devient donc : Comment convaincre les acteurs de l’informel que le formel peut devenir un atout, et non une menace ?
- Comprendre les raisons de l’attachement à l’informel
L’économie informelle attire non seulement une masse importante de travailleurs, mais également une part non négligeable des consommateurs. Ces derniers y trouvent souvent des biens et services à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans le formel. Cela s’explique par l’absence de charges sociales, de fiscalité déclarée, ou encore par une moindre exigence réglementaire.
L’informel constitue ainsi une réponse pragmatique à une réalité économique contraignante, tant du côté de l’offre que de la demande.
Pour les acteurs économiques, les raisons de demeurer dans l’informalité sont multiples : complexité administrative, coût élevé de la conformité réglementaire, manque de visibilité sur les avantages à intégrer le formel, mais aussi défiance vis-à-vis des institutions.
L’informel est ainsi perçu comme un espace de liberté économique, de flexibilité organisationnelle, et souvent de survie immédiate. De nombreux travailleurs informels ne se sentent pas concernés par les dispositifs étatiques, ni même protégés par ceux-ci.
Cette réalité montre que la formalisation ne peut s’opérer sans un changement profond de paradigme. Il ne s’agit pas d’imposer une régularisation à marche forcée, mais de comprendre que le choix de l’informel résulte d’une rationalité économique fondée sur des coûts perçus et des risques anticipés. Par conséquent, tout effort de transition vers le formel doit intégrer cette rationalité et la dépasser par des incitations tangibles.
- Offrir une valeur ajoutée tangible dès l’entrée dans le formel
La formalisation ne peut être envisagée comme un simple acte administratif. Elle doit générer, dès les premières démarches, une valeur ajoutée perceptible : accès à la couverture sociale, à des financements bancaires, aux marchés publics, à la sécurité juridique et à la reconnaissance professionnelle.
Comme je l’ai souligné dans ma tribune publiée sur EcoActu (2025), « la souveraineté fiscale repose sur une intégration volontaire et stratégique de l’économie informelle, et non sur une répression unilatérale ». Une telle approche implique que l’État soit perçu non seulement comme un collecteur d’impôts, mais avant tout comme un garant de droits fondamentaux et de services publics accessibles.
Des pays comme le Brésil, la Tunisie ou le Maroc ont mis en œuvre des mécanismes incitatifs – fiscalité allégée, accès à l’assurance sociale, procédures numériques simplifiées – pour accompagner les acteurs de l’économie informelle vers la formalité. Le régime marocain de l’auto‑entrepreneur (Loi n° 114‑13) et le programme Ahmini en Tunisie sont des illustrations concrètes de cette approche. Ces politiques s’inscrivent dans un cadre global où la Banque mondiale recommande des interventions progressives, combinant simplification administrative, soutien social et incitations fiscales afin de transformer l’informel en catalyseur de croissance économique et de résilience post‑pandémie. (The long Shadow of informality Word Nank Group 2022).
De plus, l’instauration d’une sécurité sociale généralisée, comme l’a amorcé le Maroc depuis 2021, constitue un levier fondamental. Elle rassure les populations et crée un cadre de confiance, en garantissant un socle de protection contre les aléas de la vie économique et sanitaire. Associée à une fiscalité incitative et des démarches simples, elle donne au passage au formel une dimension de dignité retrouvée.
Ce changement de perspective transforme la formalisation en levier d’opportunité, plutôt qu’en contrainte bureaucratique.
Enfin, les grandes réformes structurelles dans les domaines de la santé et de l’éducation constituent des piliers complémentaires à cette dynamique. En assurant un accès équitable et universel à des soins de qualité et à une éducation inclusive, l’État renforce les incitations à la formalisation : les populations voient concrètement ce que leurs contributions fiscales permettent de financer. Une école publique efficace et un système de santé protecteur crédibilisent l’engagement dans le système formel, en donnant un sens tangible à la solidarité nationale.
Un bon exemple est fourni par le Rwanda, qui a instauré un régime de fiscalité présomptive (presumptive tax) adapté aux micro-entreprises (Fiscal impacts of a presumptive tax for microentreprises in Rwanda juillet. IGC 2017), permettant une montée progressive vers le formel.
- La sécurité sociale généralisée : pilier de la transition
Un des leviers les plus puissants pour convaincre les acteurs informels d’intégrer le formel réside dans la protection sociale universelle. En garantissant une couverture en cas de maladie, de maternité, d’accident ou de vieillesse, l’État offre une contrepartie concrète et mesurable à la contribution fiscale.
Depuis 2021, le Maroc a engagé une réforme ambitieuse visant à généraliser l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) à toutes les catégories professionnelles, y compris les travailleurs non-salariés. (Le matin 30/04/2025) À la fin de l’année 2024, plus de 23 millions de personnes ont été intégrées, portant le taux global de couverture à 68 % de la population (soit 25 millions de bénéficiaires sur 36,8 millions d’habitants) (FNH 3/2025).
Cette extension progressive constitue un signal fort de l’engagement de l’État envers les populations économiquement vulnérables. Elle permet de transformer l’adhésion au formel en investissement dans la sécurité, plutôt qu’en simple obligation légale. Par ailleurs, en élargissant l’assiette des cotisants, le système devient plus viable et solidaire.
L’expérience montre également que Lorsqu’elle est perçue comme digne et accessible, la couverture sociale peut générer une adhésion volontaire. Ainsi, l’intégration de la sécurité sociale dans la stratégie de formalisation ne relève pas uniquement d’un choix technique, mais d’un contrat social renouvelé entre l’État et ses citoyens.
- Réformes sectorielles et confiance publique : santé, éducation et inclusion
La formalisation durable de l’économie informelle ne peut réussir sans une amélioration globale de la qualité des services publics. Deux secteurs en particulier jouent un rôle fondamental : la santé et l’éducation.
Une école publique inclusive, gratuite et de qualité est souvent l’un des premiers critères évalués par les familles pour justifier une contribution fiscale. Lorsqu’un parent constate que ses enfants bénéficient d’un enseignement sérieux, de manuels accessibles et d’un encadrement pédagogique suivi, il est plus enclin à se sentir lié au pacte républicain et à participer à l’effort fiscal. L’éducation, tout comme la santé, devient une composante du contrat social, rendant visible la valeur de l’engagement dans le formel.
De même, un système de santé universel, équitable et digne renforce le sentiment d’appartenance à une communauté protégée. La pandémie de Covid-19 a révélé les inégalités d’accès aux soins entre les secteurs formel et informel. Elle a aussi mis en lumière l’urgence de construire un socle sanitaire protecteur pour tous. L’intégration au formel apparaît alors comme une stratégie de survie collective, plutôt qu’un luxe administratif.
Enfin, ces réformes doivent être articulées avec une politique active d’inclusion financière, notamment par l’accès facilité au crédit, à l’épargne et à l’assurance. Des instruments comme les coopératives, les mutuelles ou les microfinancements permettent de créer des ponts entre les économies populaires et les institutions économiques formelles.
En résumé, formalisation et réforme sociale doivent avancer de concert : c’est dans cette cohérence structurelle que réside la crédibilité du projet.
- Simplification administrative et innovation numérique : rendre le formel accessible
L’un des freins majeurs à la formalisation reste la complexité administrative. Pour de nombreux petits acteurs économiques, les démarches de déclaration, d’enregistrement ou de paiement sont vécues comme des parcours d’obstacles chronophages, coûteux, et souvent peu compréhensibles.
Or, la simplification ne peut être réduite à un allégement ponctuel : elle doit être pensée comme un processus structurel de confiance. Cela suppose une refonte des interfaces, une réduction des intermédiaires, et une logique de service public centré sur l’utilisateur.
Plusieurs pays ont démontré l’efficacité d’approches innovantes :
- Le Rwanda a mis en place un système de guichet unique en ligne, accessible depuis des téléphones basiques, permettant l’enregistrement d’activités économiques en moins de 30 minutes (RRA, 2022).
- Le Brésil, à travers le programme Simples National, a unifié les obligations fiscales en un seul formulaire mensuel numérique pour les micro-entrepreneurs. (EDICOM 05/2025).
- Le Maroc a lancé un portail dédié aux auto-entrepreneurs (OIT. Rapport d’étude), avec des procédures entièrement dématérialisées, et un régime fiscal proportionnel très simplifié.
Ces initiatives illustrent le rôle que peut jouer le numérique dans l’élargissement de l’accès au formel, à condition de combler la fracture technologique à condition que l’accès aux technologies soit lui-même généralisé.
Le développement de guichets mobiles, d’interfaces vocales en langues locales, et de médiateurs numériques de proximité constitue une réponse concrète aux disparités territoriales et sociolinguistiques.
La formalisation ne doit plus être un acte administratif vertical, mais un processus participatif, lisible et guidé.
- L’action territorialisée : un levier de confiance de proximité
La réussite d’une politique de formalisation (OIT rapport d’étude) repose en grande partie sur sa capacité d’adaptation aux réalités locales. Or, c’est souvent à l’échelle des territoires que se joue la crédibilité des réformes économiques. Les collectivités territoriales peuvent agir comme des catalyseurs de confiance, à condition d’être dotées de moyens, de compétences et d’une légitimité suffisante. (Questions de management 2021/3 n°33).
Au Maroc, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a démontré la capacité des collectivités locales à encadrer, financer et accompagner des projets économiques de très petite taille. Sans se substituer à l’État, ces entités peuvent contextualiser les dispositifs d’appui, faciliter le dialogue avec les acteurs de terrain, et adapter les incitations fiscales ou sociales aux contraintes locales (INDH, 2019).
Des initiatives prometteuses émergent :
- Des guichets territoriaux de formalisation, en lien avec les chambres de commerce et les coopératives locales, peuvent offrir un accompagnement individualisé aux micro-acteurs.
- Des unités mobiles permettent d’atteindre les zones rurales éloignées ou les quartiers périurbains, souvent exclus des services administratifs classiques.
- Des partenariats public-privé territoriaux (PPP locaux) favorisent le portage conjoint d’incubateurs, de dispositifs de microcrédit ou d’actions de sensibilisation. (AMC Juin 2023.316-336).
Le territoire devient ainsi une échelle de médiation entre l’informel et le formel, où les acteurs sont moins perçus comme des contribuables abstraits, mais comme des membres d’une communauté économique à part entière.
- Leçons du Nord : l’informel existe aussi dans les pays développés
Contrairement aux idées reçues, l’économie informelle n’est pas l’apanage des pays en développement. Elle revêt des formes variées et persistantes dans les États les plus avancés économiquement. Ce constat relativise la stigmatisation de l’informel comme « retard de développement » et souligne l’universalité du phénomène.
En France, l’INSEE estime que l’économie non déclarée représente environ 7 % du PIB (INSEE, 2020). Il s’agit principalement de travail dissimulé dans les services à la personne, les rénovations de logement, ou les petits commerces de proximité.
En Allemagne, certaines politiques fiscales incitatives, telles que les crédits d’impôt pour les particuliers employeurs dans les services domestiques, ont été expérimentées. Ces dispositifs visaient à encourager la déclaration des emplois à domicile, notamment dans le secteur des services à la personne. Toutefois, les effets sur la formalisation (ISSM.1/2019) restent difficiles à quantifier de manière homogène, les résultats variant selon les territoires et les profils des ménages.
Aux États-Unis et au Mexique, les formes d’informalité sont intégrées dans l’économie des plateformes (Open Editions Journal 3/2017), notamment via le statut de « gig worker« (travailleur à la tâche). Bien que certains services soient déclarés, une part significative d’activités numériques échappe encore aux régulations classiques.
Ces expériences démontrent deux choses :
- L’informel est une constante des économies libérales, réagissant à la rigidité ou à l’obsolescence de certains cadres réglementaires.
- Les politiques hybrides, combinant incitations, reconnaissance juridique et accompagnement, peuvent canaliser l’informel sans provoquer de ruptures sociales.
Le Maroc, en phase de réforme structurelle, peut donc s’inspirer de ces exemples pour bâtir une stratégie contextualisée, inclusive et évolutive.
- Pour une fiscalité de la confiance : sortir de la logique punitive
L’un des obstacles majeurs à la formalisation réside dans la perception négative de la fiscalité, souvent assimilée à une sanction plutôt qu’à un mécanisme de solidarité. Pour de nombreux acteurs de l’économie informelle, l’entrée dans le circuit formel est synonyme d’un impôt opaque, disproportionné et peu utile.
Ce ressenti est renforcé par l’absence d’une logique d’échange clair entre contributions et services : accès limité à la protection sociale, faible soutien au crédit, ou encore insuffisance des infrastructures publiques.
Comme le développe un article publié sur Eco Actu (2025), « la souveraineté fiscale passe par une intégration volontariste de l’informel, non par une répression verticale ». Cette approche repose sur une fiscalité compréhensible, modulable et prévisible, apte à établir une relation de confiance entre l’État et les citoyens économiques.
Des expériences internationales convergentes illustrent les effets vertueux de cette démarche. Plusieurs pays ont adopté des régimes fiscaux simplifiés ou évolutifs, en lien avec le chiffre d’affaires réel et la taille de l’activité.
Ces dispositifs incluent souvent des exonérations temporaires, une imposition ultra-allégée à l’entrée dans le formel, et un accès simultané à des prestations sociales minimales. Ce couplage entre fiscalité réduite et protection sociale constitue un puissant levier d’adhésion.
Au Maroc, par exemple, le régime de l’auto-entrepreneur offre une fiscalité ultra-simplifiée associée à une couverture sociale minimale (Régime fiscal de l’auto-entrepreneur. Édition 2021).
Pourtant, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir la transparence sur l’utilisation des contributions, renforcer l’accompagnement, et simplifier encore davantage les démarches administratives. La digitalisation du processus constitue un progrès, mais son accessibilité demeure inégale selon les territoires.
En définitive, une fiscalité moderne ne peut être un dispositif purement comptable ; elle doit devenir un vecteur de légitimité, un langage d’appartenance et de solidarité. Pour y parvenir, elle doit être adossée à des services publics tangibles, à une communication pédagogique constante, et à des outils numériques d’accompagnement.
- Vers un contrat économique national et intelligent : coconstruire la transition
La transition vers le formel ne doit pas être conçue comme une opération descendante de normalisation, mais comme un pacte économique national, fondé sur la confiance mutuelle, la visibilité des droits et des devoirs, et la co-responsabilité.
Pour réussir cette mutation structurelle, il est impératif d’instaurer un contrat tripartite entre :
- L’État, garant des droits sociaux, des services publics de qualité et de l’accès équitable aux mécanismes de protection ;
- Le citoyen-entrepreneur, acteur économique responsable, libre mais conscient de son rôle fiscal et social ;
- Les intermédiaires de terrain (collectivités locales, coopératives, chambres professionnelles, ONG), en charge de l’accompagnement, de la formation et de la médiation.
Ce contrat intelligent suppose :
- Un cadre juridique souple mais clair, avec des passerelles entre informel, pré-formel et formel (statuts intermédiaires, exonérations temporaires, fiscalité graduée) ;
- Des engagements réciproques, à savoir une contribution juste contre une protection effective (assurance maladie, retraite, maternité, soutien en cas de crise) ;
- Un processus de transition modulaire, respectueux des rythmes économiques locaux, incluant des phases expérimentales territorialisées.
Comme le souligne le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE, 2023), « la crédibilité de toute réforme dépend de sa lisibilité, de son équité et de la réalité de son accompagnement ».
Ce contrat ne doit pas être un simple document de politique publique, mais un outil dynamique de réconciliation entre les logiques populaires et les normes étatiques, entre l’économie de la débrouille et celle de la contribution structurée.
Conclusion
L’économie informelle n’est pas un résidu archaïque à éradiquer, mais une réalité complexe qui exprime à la fois la vitalité populaire, les limites des systèmes institutionnels, et les adaptations sociales à la précarité. Chercher à la formaliser ne doit pas signifier l’uniformiser ou la domestiquer par la contrainte. Cela implique, au contraire, de reconnaître ses logiques propres. Il s’agit d’intégrer progressivement des mécanismes juridiques et sociaux adaptés, permettant une reconnaissance légale sans dislocation des équilibres économiques locaux.
Les expériences nationales et internationales montrent que la réussite d’un processus de formalisation repose sur trois piliers complémentaires :
- Une fiscalité de confiance, claire, progressive et équitable, adossée à des contreparties visibles pour les acteurs (El Kadiri Boutchich, 2024 ; OECD, 2021) ;
- Un cadre juridique hybride, incluant des statuts passerelles, une temporalité graduelle et des incitations adaptées aux réalités sectorielles ;
- Un engagement public renouvelé, à travers la réforme de l’éducation, de la santé, et de la protection sociale, pour faire du formel un espace de sécurité et de dignité (Banque mondiale, 2020).
Recommandations stratégiques :
- Créer un “statut d’activité économique de transition”, entre informel et auto-entrepreneur, avec un taux fiscal ultra-allégé et un accès partiel à la couverture sociale pendant trois ans.
- Déployer des guichets territoriaux mixtes (collectivités, chambres, société civile) pour l’accompagnement de proximité, la médiation administrative et la pédagogie fiscale.
- Instaurer une fiscalité comportementale, où l’impôt est modulé selon l’engagement volontaire à rejoindre un plan de formalisation graduelle.
- Renforcer la communication publique ciblée, en utilisant les radios locales, les réseaux sociaux et les leaders communautaires pour sensibiliser à la valeur du formel.
- Associer les politiques de formalisation à la réforme sociale globale, notamment à la généralisation de l’AMO (assurance maladie obligatoire), à la retraite minimale et à la scolarisation universelle.
- Évaluer en continu les dispositifs grâce à des observatoires locaux de la transition économique, intégrant des indicateurs qualitatifs (confiance, satisfaction, niveau de compréhension des droits).
En définitive, la formalisation ne doit pas être un saut dans l’inconnu imposé aux plus vulnérables, mais une voie nationale vers une souveraineté inclusive, où chaque citoyen peut exister légalement, contribuer équitablement, et bénéficier dignement des fruits de la croissance.
Par
Me Abdelhakim El Kadiri Boutchich
Juge à la Cour internationale de règlement des différends – Londres,
Arbitre et médiateur international accréditée.
Expert international en audit, droit et évaluation – Genève
Bibliographie.
- ILO (2018). Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture (3rd edition). Geneva: International Labour Organization. https://www.ilo.org/publications/women-and-men-informal-economy-statistical-picture-third-edition
- CESE (2022). Rapport sur l’économie informelle au Maroc. Conseil Économique, Social et Environnemental. Rabat. https://www.cese.ma/docs/une-approche-integree-pour-resorber-leconomie-informelle-au-maroc
- CESE (2022). La Confiance au cœur de la réforme publique. Conseil Économique, Social et Environnemental. Rabat. https://www.cese.ma/media/2023/11/RA-22-VF-final-web.pdf
- Loeprick, J. Small Business Taxation Reform to Encourage Formality and Firm Growth. Investment Climate In Practice – World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/538351468158062534/pdf/483130BRI0SMEt10Box338894B01PUBLIC1.pdf
- Me Abdelhakim El Kadiri Boutchich, A. (2025). « Fiscalité, puissance et souveraineté : le Maroc face à la reconfiguration stratégique de l’ordre fiscal mondial ». EcoActu. https://ecoactu.ma/vers-une-simplification-fiscale-analyse-taux-unique
- Ohnsorge, F., & Yu, S. (2022). The Long Shadow of Informality. World Bank Group. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36209
- Eissa, N., Murray, S., & Zeitlin, A. (2017). Fiscal Impacts of a Presumptive Tax for Microenterprises in Rwanda. International Growth Centre and Georgetown University. https://www.theigc.org/sites/default/files/2017/10/Eissa-et-al-Final-report_cover.pdf
- Le Matin (30/04/2025). « AMO : Quel avenir pour les assurances santé privées au Maroc ? ». https://lematin.ma/societe/amo-quel-avenir-pour-les-assurances-sante-privees-au-maroc/276855
- Finances News Hebdo (01/03/2025). « Protection sociale : AMO Maroc – Généralisation ». https://fnh.ma/article/actualite-economique/protection-sociale-amo-maroc-generalisation
- Rwanda Revenue Authority. Guichet unique électronique pour faciliter les affaires au Rwanda. https://www.rra.gov.rw/fr/services-des-douanes/guichet-unique-electronique
- EDICOM (21/05/2025). Réforme fiscale au Brésil : simplification en vue. https://edicomgroup.fr/blog/reforme-fiscale-bresil
- OIT (2023). Rapport d’étude sur la formalisation des entreprises informelles, pp. 57, 67 et 68. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_seed/documents/publication/wcms_890278.pdf
- Questions de Management (2021/3, n°33). Intégrer la dimension territoriale dans l’action managériale, pp. 89–134. https://shs.cairn.info/revue-questions-de-management-2021-3-page-89
- Alternatives Managériales et Économiques – AMC (Juin 2023). « Partenariats territoriaux pour l’inclusion économique », pp. 316–336. [document local]
- Bennour, L. (2019). Résistances économiques et sociales dans les Suds : problématique de transition du secteur informel au 3e secteur. International Social Sciences & Management Journal – ISSM.1/2019. [document local]
- Sánchez-Castañeda, A.. « L’emploi informel au Mexique et en Amérique centrale : un phénomène complexe ». Open Editions Journal, Chap. II-B. https://journals.openedition.org/rdctss/364?lang=en
- Me Abdelhakim El Kadiri Boutchich, A. (2025). « Vers une simplification fiscale : analyse de l’impact et des enjeux d’un taux unique ». Hespress. https://fr.hespress.com/406241-vers-une-simplification-fiscale-analyse-de-limpact-et-des-enjeux-dun-taux-unique.html
- Maroc PME (2021). Régime fiscal de l’auto-entrepreneur : Guide pratique. https://marocpme.gov.ma/wp-content/uploads/2021/12/MEFRA_Guide-fiscal-Auto-entrepreneur_2020.pdf
- INSEE (2020). Travail dissimulé : une estimation pour la France. Institut national de la statistique et des études économiques.
- INDH (2019). Bilan de la phase III de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. Coordination nationale, Rabat. https://www.indh.gov.ma/fr/bilan-phase-iii
- OECD (2021). Taxing the Informal Economy: Challenges and Opportunities. Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/tax/taxing-the-informal-economy-challenges-and-opportunities-4f18e75e-en.htm
Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.