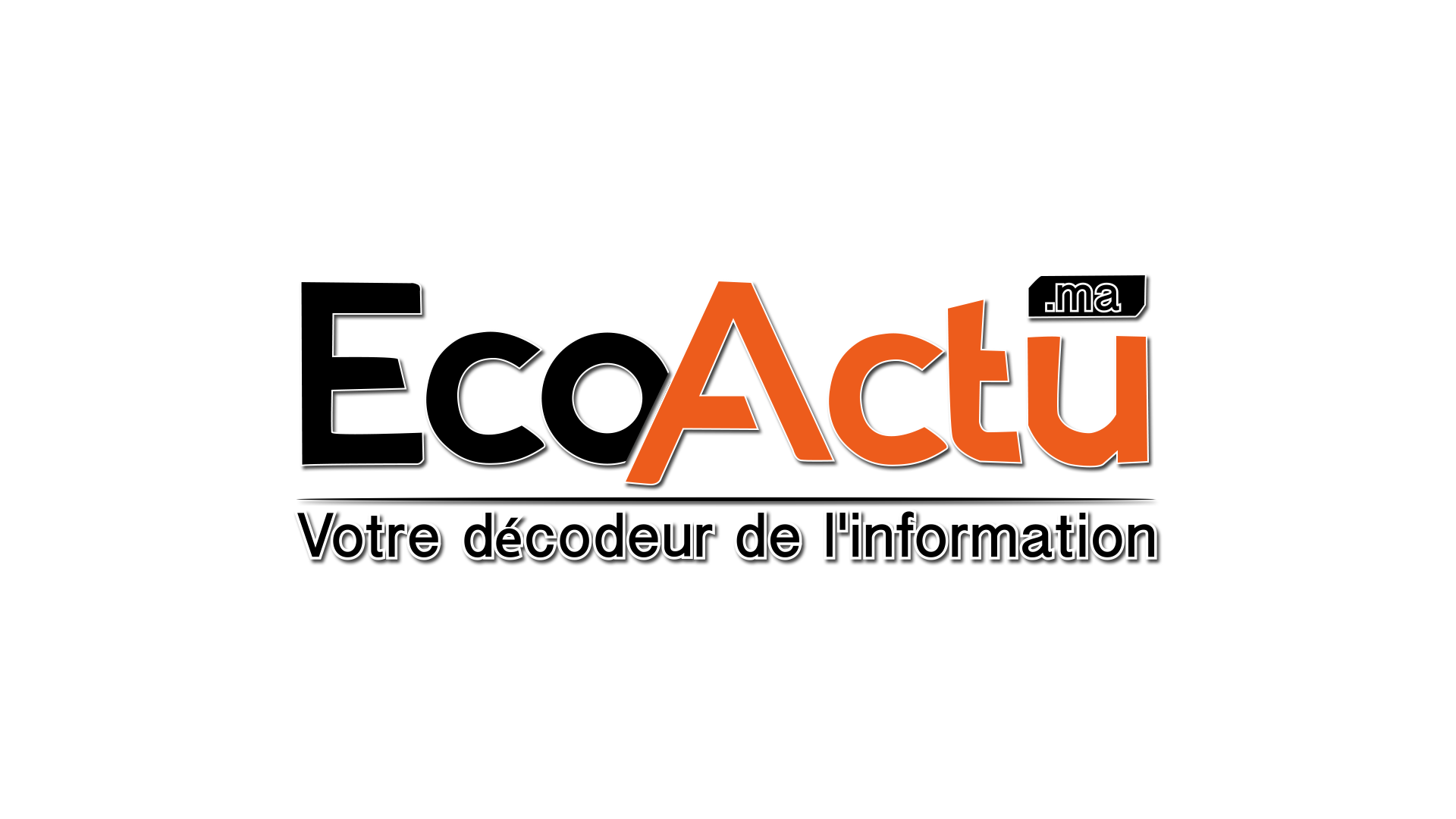L’avenir du Maroc est influencé par des facteurs géopolitiques, économiques et diplomatiques, notamment les crises au Maghreb, en Ukraine et à Gaza. Les tensions avec l’Algérie, exacerbées par le soutien algérien au Polisario, ainsi que l’instabilité en Tunisie et en Libye, compliquent la situation régionale. Le Maroc adopte une position de neutralité et de médiation, renforçant ses relations avec les pays occidentaux et arabes, et pourrait renforcer ses partenariats énergétiques.
Les crises internationales perturbent les chaînes d’approvisionnement, nécessitant des adaptations commerciales. Pour renforcer le Maroc économiquement et politiquement, il est recommandé de diversifier l’économie, améliorer les infrastructures, renforcer le capital humain, améliorer le climat des affaires et promouvoir l’investissement étranger. La crise régionale présente des défis et des opportunités pour le Maroc, qui pourrait en tirer parti pour renforcer ses alliances diplomatiques et diversifier ses partenariats économiques.
L’avenir du Maroc est façonné par divers facteurs géopolitiques, économiques et diplomatiques, notamment les crises politiques au Maghreb, en Ukraine et à Gaza. Ces dynamiques complexes déterminent le contexte régional et international dans lequel le Maroc évolue. Voici une analyse des implications pour le Maroc.
L’Algérie prévoit de remettre la question du sahara marocain à l’ordre du jour des Nations Unies et de faire pression pour une réforme du Conseil de sécurité. Elle soutient le Polisario et la République arabe sahraouie démocratique (RASD) sous le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, mais avec des objectifs stratégiques cachés, tels que l’accès à l’océan Atlantique et l’affaiblissement du Maroc.
Bien que l’Algérie tente de contrer la stratégie marocaine, il est difficile de renverser le statu quo établi par le Maroc au sahara marocain. La transition démocratique en Tunisie reste fragile, menacée par des tensions politiques internes et des défis de gouvernance. Le taux de chômage élevé, la dette publique croissante et l’incertitude économique dissuadent les investissements étrangers. La menace terroriste et les défis sécuritaires posés par la proximité avec la Libye affectent également la stabilité de la Tunisie.
Les tensions avec les voisins et les flux migratoires compliquent la coopération régionale. La gestion des ressources en eau et la dégradation environnementale sont des défis cruciaux pour la stabilité sociale et économique. Les inégalités sociales et les besoins de réformes dans les systèmes éducatif et de santé nécessitent une attention particulière.
La Libye est devenue un terrain fertile pour les groupes armés et les milices, entraînant une propagation de l’instabilité et des menaces terroristes dans la région. Elle est un point de transit majeur pour les migrants cherchant à atteindre l’Europe, créant une crise humanitaire et des défis sécuritaires. L’instabilité en Libye perturbe les échanges commerciaux et les investissements, affectant les marchés mondiaux de l’énergie. L’intervention de puissances étrangères en Libye complique les efforts de paix et prolonge le conflit.
En somme, l’avenir du Maroc est étroitement lié à la stabilité régionale au Maghreb, aux dynamiques géopolitiques en Ukraine et à Gaza, ainsi qu’à sa capacité à naviguer dans un environnement diplomatique complexe.
Dans cette série de chroniques, Me Abdelhakim El Kadiri Boutchich, juge et président de la haute unité judiciaire spéciale des relations Africo-Européennes et Arabes auprès de la Cour internationale de résolutions des différends « Incodir » à Londres, adopte la méthode descriptive pour décrire l’investissement et les risques qui le menacent, ainsi que les lois qui régissent les contrats et les accords d’investissement et les instances pouvant trancher leurs litiges.
Il a également suivi l’approche analytique pour analyser les lois et les moyens de règlement des différends ainsi que leurs types. À travers cette étude, je vais essayer de répondre à la problématique suivante :
Comment les crises politiques au Maghreb, en Ukraine et à Gaza influencent-elles l’avenir géopolitique, économique et diplomatique du Maroc, et quelles stratégies le pays peut-il adopter pour naviguer dans ce contexte complexe et incertain, notamment face aux tensions avec l’Algérie, à l’instabilité en Tunisie et en Libye, et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, tout en utilisant sa position de neutralité et de médiation pour renforcer ses relations internationales et ses partenariats énergétiques ?
Me Abdelhakim El Kadiri Boutchich a traité cette problématique en 6 axes :
- Contexte Géopolitique.
- Position du Maroc
- La Fragmentation Politique et Sociale
- Impacts de la Crise Locale et Régionale sur le Maroc: Défis Diplomatiques et Économiques
- La Place du Maroc dans la Crise Régionale et Internationale
- Recommandations pour Renforcer Économiquement et Politiquement le Maroc
L’avenir du Maroc est influencé par plusieurs facteurs géopolitiques, économiques et diplomatiques, notamment dans le contexte des crises politiques au Maghreb, en Ukraine et à Gaza.
Contexte Géopolitique
Le Maroc, à la croisée de l’Afrique du Nord et de l’Europe, bénéficie d’une position géostratégique unique. Bordé par l’océan Atlantique, la mer Méditerranée, l’Algérie et le Sahara occidental, il joue un rôle crucial dans les dynamiques régionales[1]. Sa stabilité politique et ses efforts diplomatiques en font un acteur clé en matière de sécurité, de migration et de développement en Afrique et dans le bassin méditerranéen.
Crise au Maghreb
Le Maghreb, comprenant des pays comme l’Algérie, la Tunisie et la Libye, traverse des périodes de turbulences politiques et économiques qui ont des incidences sur la stratégie du Maroc sur tous les plans :
- Relations Maroc-Algérie :
L’Algérie et le Maroc jouent un rôle géostratégique crucial dans la région du Maghreb. Lorsque leurs relations se détériorent, c’est toute la région qui en pâtit, tandis qu’un rapprochement entre Alger et Rabat dynamise les autres capitales maghrébines. Depuis les années 1960, leurs relations[2] sont marquées par des malentendus, des brouilles, des ruptures et des réconciliations temporaires, souvent accompagnées de tensions et de confrontations armées, comme la guerre des sables en 1963 et la bataille d’Amgala en 1976. Les contentieux frontaliers et le conflit du sahara marocain, qui a éclaté en 1975, alimentent une « guerre froide » persistante entre les deux pays. Cette rivalité se manifeste par divers moyens, y compris des campagnes médiatiques virulentes, des refoulements de délégations et une bataille diplomatique intense, souvent marquée par un manque de bienséance.
Les tensions croissantes entre l’Algérie[3] et le Maroc résultent de plusieurs facteurs convergents, exacerbant une situation déjà complexe et délicate, notamment autour de la question du sahara marocain, représentent une source majeure d’instabilité régionale. La rivalité entre les deux pays pourrait influencer leurs politiques étrangères et économiques, impactant ainsi la stabilité de la région. Malheureusement l’Algérie persiste avec rigueur sur sa position vis-à-vis du Sahara marocain et son soutien permanant au front Polisario ce qui complique tous les moyens d’entente et de paix[4]. De son côté le Maroc propose une solution adéquate pour l’autonomie du Sahara.
- Renforcement militaire et tensions exacerbées
Le renforcement militaire des deux côtés continue d’exacerber les tensions[5]. L’Algérie, grâce à une affirmation diplomatique accrue, joue désormais un rôle plus influent sur la scène internationale.
- Escalade potentielle sur le terrain
Sur le terrain, l’utilisation de drones par le Maroc pour cibler le Front Polisario pourrait entraîner une escalade du conflit. Francisco Serrano, dans une tribune pour le Middle East Institute,[6] explique qu’une Algérie plus active posera de nouveaux défis au Maroc dans les mois à venir. Récemment, des incidents frontaliers et des ruptures diplomatiques ont intensifié les tensions entre les deux pays. Les enjeux économiques, notamment les ressources naturelles, ajoutent une dimension stratégique à cette situation. Une escalade pourrait déstabiliser le Maghreb, provoquer des déplacements de populations et nuire aux économies des deux pays. La médiation internationale et le dialogue direct sont essentiels pour éviter un conflit ouvert. Par exemple, la Cour internationale de règlement des différends (INCODIR) [7]à Londres, qui travaille sous l’égide de l’ONU, possède une expérience significative dans ce domaine.
- Amélioration des positions algériennes
Le régime algérien, longtemps freiné par des faiblesses internes, a récemment amélioré ses positions internes et externes. Cette amélioration est due notamment à la répression et aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19, qui ont permis de contenir la dissidence[8].
- Initiatives diplomatiques d’Alger
Alger prévoit de remettre la question du sahara marocain à l’ordre du jour des Nations Unies. De plus, elle souhaite faire pression pour une réforme du Conseil de sécurité afin d’augmenter le poids des États africains et des pays du Sud. [9]
Néanmoins, les tentatives diplomatiques de l’Algérie n’ont pas donné de résultats positifs. Cette situation est exacerbée par des incidents frontaliers et des déclarations diplomatiques qui ont parfois envenimé les relations, comme la rupture des relations diplomatiques par l’Algérie en 2021. La méfiance mutuelle et les divergences sur la question du Sahara marocain continuent de poser des obstacles majeurs à une résolution pacifique du conflit. Toutefois, cette division ne sert pas réellement les intérêts de l’Algérie, qui seraient mieux réalisés dans le cadre de l’union du Maghreb arabe.
- La Position de l’Algérie : Principes et Réalités
L’Algérie justifie son soutien au Polisario et à la République arabe sahraouie démocratique (RASD) par le principe du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».[10] Cependant, ce discours de principe masque des objectifs plus pragmatiques, tant territoriaux que stratégiques, liés à la lutte pour le leadership régional. Par ailleurs, l’implication des États-Unis revêt une importance capitale, notamment en matière de sécurité, où l’appui américain pourrait s’avérer crucial. L’engagement des États-Unis dans le Maghreb est désormais perçu comme un facteur déterminant, capable de redéfinir l’équilibre géopolitique de la région. De plus, la neutralité diplomatique du Maroc avec les grandes nations joue un rôle essentiel dans la stabilité locale et régionale.
- Objectifs Cachés
En soutenant le Polisario, l’Algérie cherche en réalité à atteindre deux objectifs majeurs :
Accès à l’océan Atlantique
L’Algérie cherche à s’ouvrir sur un débouché stratégique sur l’Atlantique par le biais du soutien fabriqué du Polisario, ce qui renforcerait sa position géopolitique et économique.
Affaiblissement du Maroc
L’Algérie cherche à empêcher le Maroc de redevenir une puissance influente, tant sur le plan océanique que saharien, en limitant son expansion et son influence dans la région. Le Maroc, pour sa part, considère le Sahara marocain comme une question d’intégrité territoriale[11]. Fort de son bilan favorable en matière de droits de l’homme, le Maroc s’efforce de contrer toutes les intrigues contre le Sahara marocain. Des rapports internationaux soulignent les progrès réalisés par le pays dans ce domaine, renforçant ainsi sa position sur la scène mondiale. En 2013, le Maroc a réussi à rejeter une proposition d’élargir le mandat de la MINURSO pour inclure une observation des droits de l’homme, démontrant sa capacité à gérer les pressions diplomatiques. En outre, le Maroc investit massivement en lobbying pour promouvoir son plan d’autonomie et consolider son contrôle sur le Sahara marocain. Ces efforts visent à solidifier son influence régionale et à contrer les initiatives adverses[12].
Une Politique Stratégique Déguisée en Principes d’Autodétermination
Ces objectifs cachés révèlent une dimension plus complexe et stratégique de la politique algérienne, au-delà des principes affichés de soutien à l’autodétermination des peuples.[13]
Difficile renversement du statu quo
Cependant, il est estimé qu’il sera difficile pour l’Algérie de renverser le statu quo établi par le Maroc au sahara marocain. Néanmoins, ces tentatives augmenteront les frictions entre les deux voisins.
Tensions Algéro-Marocaines : Stratégies de Souveraineté et Risques de Confrontation
L’Algérie cherchera à contrer la stratégie marocaine, retardant une résolution politique et renforçant le soutien international à ses revendications de souveraineté. Bien que la possibilité d’un conflit ouvert soit faible, une confrontation affaiblirait la position de chaque régime auprès de sa propre population.[14]
Transition en Tunisie
La Tunisie, en tant que pays de la région maghrébine, fait face à plusieurs risques qui peuvent affecter sa stabilité et son développement.[15] Voici quelques-uns de ces risques :
Instabilité Politique
La Tunisie, autrefois modèle de transition démocratique post-Printemps arabe, traverse actuellement une période d’instabilité politique. Les défis économiques, les tensions sociales et les divergences politiques ont affaibli ses institutions démocratiques, soulevant des inquiétudes sur sa stabilité à long terme.
Transition Démocratique
La Tunisie est souvent citée comme un exemple de transition démocratique réussie dans le monde arabe. Cependant, cette transition reste fragile et peut être menacée par des tensions politiques internes, des conflits entre partis et des manifestations populaires.
Gouvernance
Les défis liés à la gouvernance, y compris la corruption et la bureaucratie inefficace, peuvent nuire à la stabilité politique et à la confiance des citoyens dans les institutions. Cependant, la corruption, souvent comparée à un virus, résulte principalement d’une défaillance morale au sein des nations.
Problèmes Économiques[16]
La Tunisie est confrontée à de nombreux problèmes économiques, notamment un taux de chômage élevé, une dette publique croissante et une inflation persistante. Le chômage, en particulier, est en grande partie dû à l’incompatibilité des profils professionnels avec les exigences de la nouvelle économie.
Les déséquilibres budgétaires et un secteur informel important compliquent également la mise en œuvre des réformes nécessaires pour stimuler la croissance et attirer les investissements étrangers. Il est toutefois nécessaire d’adopter une réforme fiscale et sociale structurée pour relancer le développement économique et réduire le fléau du commerce informel.
Chômage
le taux de chômage élevé, en particulier parmi les jeunes et les diplômés, est un défi majeur pour la Tunisie. Cependant, avec des réformes appropriées et une volonté politique forte, il est possible de créer un environnement propice à la création d’emplois et de réduire la frustration sociale. La jeunesse tunisienne, avec son potentiel et ses compétences, peut devenir un moteur de croissance et de développement pour le pays.
Dette Publique
La dette publique croissante et les déficits budgétaires limitent la capacité du gouvernement à investir et à fournir des services publics de qualité, freinant ainsi la croissance économique et exacerbant les inégalités sociales.
Pour y remédier, il est crucial de diagnostiquer les causes, telles qu’une gestion inefficace des finances publiques, une faible mobilisation des ressources fiscales, et une dépendance excessive aux financements extérieurs.
En adressant ces problèmes, le gouvernement pourra mettre en œuvre des réformes structurelles pour stabiliser les finances publiques et favoriser le développement économique et social.
Investissements Étrangers
L’incertitude politique et économique peut dissuader les investissements étrangers, essentiels pour la croissance économique.
Sécurité et Terrorisme
En Tunisie, la sécurité et la lutte contre le terrorisme sont cruciales pour la stabilité. Depuis 2011, plusieurs attaques ont révélé la nécessité de renforcer la sécurité.
Le gouvernement a adopté diverses mesures, telles que la coopération internationale, l’amélioration des forces de sécurité et l’instauration de lois plus strictes, pour renforcer la sécurité nationale.
Cependant, cette militarisation accrue suscite des inquiétudes quant à une possible instabilité sécuritaire régionale. Parallèlement, des initiatives éducatives et communautaires ont été mises en place pour prévenir la radicalisation et promouvoir la cohésion sociale.
Malgré ces efforts, des défis demeurent en raison de la proximité des zones de conflit, des réseaux transnationaux et des problèmes socio-économiques. La Tunisie collabore avec ses partenaires pour renforcer sa résilience.
Terrorisme
La menace terroriste reste présente, avec des groupes extrémistes opérant dans la région. Des attaques terroristes peuvent déstabiliser le pays et nuire à son image internationale.
Frontières
La proximité avec des zones de conflit, notamment en Libye, pose des défis sécuritaires importants et peut entraîner des flux de réfugiés ainsi que des activités illicites transfrontalières.
Relations Régionales
Les relations régionales de la Tunisie sont essentielles pour sa politique étrangère et son développement économique, favorisant la coopération en sécurité, commerce et développement durable avec ses voisins maghrébins, ainsi qu’avec les pays européens et arabes.
Relations avec les Voisins
Les tensions avec les pays voisins, notamment en raison de différends politiques ou économiques, peuvent affecter la stabilité régionale. La coopération au sein de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) reste limitée.
Flux Migratoires
La Tunisie est un point de transit pour les migrants cherchant à rejoindre l’Europe. La gestion de ces flux migratoires pose des défis humanitaires et sécuritaires. Pour faire face à ces défis, il est crucial de former une coalition entre les pays du Maghreb et de conclure des partenariats de coopération avec les grandes puissances internationales. Ces efforts visent à contrôler les flux migratoires et à prévenir l’immigration illégale.
Changements Climatiques et Ressources Naturelles
Les changements climatiques affectent la disponibilité et la qualité des ressources naturelles, comme l’eau, les sols et la biodiversité. Répondre à ces défis est crucial pour garantir un développement durable et la résilience des écosystèmes.
Stress Hydrique
La Tunisie fait face à des pénuries d’eau, exacerbées par les changements climatiques. La gestion des ressources en eau est cruciale pour l’agriculture et la stabilité sociale.
Dégradation Environnementale
La désertification et la dégradation des terres peuvent affecter la production agricole et la sécurité alimentaire. En Tunisie, cela se traduit par une pénurie de terres urbaines vierges pour répondre aux besoins croissants en logements résidentiels et en infrastructures industrielles.
Défis Sociaux
Inégalités Sociales
Les disparités économiques et sociales entre les régions urbaines et rurales peuvent alimenter les tensions et les mouvements de protestation.
Éducation et Santé
Les systèmes éducatifs et de santé nécessitent des réformes pour répondre aux besoins de la population et améliorer la qualité de vie.
Instabilité en Libye
La crise en Libye, qui a débuté en 2011 avec la chute de Mouammar Kadhafi[17], a eu des répercussions profondes et durables sur la stabilité du Maghreb et de l’Afrique du Nord, y compris au Maroc.
La situation en Libye reste volatile avec des conflits internes et une absence de gouvernement central fort. La stabilité de la Libye est cruciale pour la sécurité régionale et les flux migratoires dans le Maghreb.
Impact sur la Sécurité Régionale
En Lybie, les changements climatiques affectent la sécurité régionale en exacerbant les tensions autour des ressources, telles que l’eau, et en influençant les migrations et la stabilité socio-économique.
Propagation de l’Instabilité
La Libye est devenue un terreau fertile pour les groupes armés et les milices[18], favorisant une propagation de l’instabilité dans toute la région. Les frontières poreuses ont facilité la circulation des armes et des combattants vers les pays voisins, exacerbant ainsi les tensions et les conflits. En août 2023, des affrontements à Tripoli ont causé la mort de 27 personnes et blessé plus de 100 autres. La situation est aggravée par la corruption, le trafic d’êtres humains et l’instabilité régionale, avec le contrôle des vastes réserves pétrolières comme enjeu central.[19]
Terrorisme
La présence de groupes terroristes comme l’État islamique (Daech) en Libye[20] a posé une menace directe pour la sécurité des pays du Maghreb, y compris le Maroc. Ces groupes ont profité du chaos pour s’implanter et lancer des attaques dans la région.
Flux Migratoires[21]
Les flux migratoires en Libye sont un enjeu majeur, résultant de conflits internes, de la recherche de meilleures opportunités économiques et des routes migratoires vers l’Europe. Ces mouvements de population ont des répercussions importantes sur la stabilité régionale et les relations internationales.
Crise des Réfugiés
La Libye est devenue un point de transit majeur pour les migrants cherchant à atteindre l’Europe. Cette situation a entraîné une crise humanitaire et des défis sécuritaires pour les pays de la région ainsi que pour l’Europe.
Trafic Humain
Le vide sécuritaire en Libye a permis aux réseaux de trafic humain de prospérer, exacerbant la crise migratoire et les violations des droits de l’homme.
Conséquences Économiques
Les conséquences économiques en Libye, suite aux conflits et à l’instabilité politique, sont profondes. Elles incluent la dégradation des infrastructures, la diminution des investissements étrangers, et la perturbation des secteurs clés tels que le pétrole. Cela a conduit à une baisse significative de la croissance économique et à une détérioration des conditions de vie pour la population.
Perturbations Commerciales
L’instabilité en Libye a perturbé les échanges commerciaux et les investissements dans la région. Les infrastructures endommagées et les risques sécuritaires ont dissuadé les investisseurs étrangers.
Pétrole et Gaz
La Libye, riche en ressources pétrolières et gazières, [22]a vu sa production affectée par le conflit. Cela a eu des répercussions sur les marchés mondiaux de l’énergie et sur les économies des pays voisins qui dépendent des importations de ces ressources.
Diplomatie et Relations Internationales
Interventions Étrangères
La crise libyenne a attiré l’intervention de plusieurs puissances étrangères, chacune soutenant différentes factions. Cela a compliqué les efforts de paix et a prolongé le conflit.
Rôle de l’Union Africaine et de la Ligue Arabe
Ces organisations régionales ont tenté de jouer un rôle dans la médiation et la résolution du conflit, mais avec des succès limités en raison des intérêts divergents des parties prenantes.[23]
Implications pour le Maroc
Les implications pour le Maroc dans la crise régionale libyenne sont significatives. En tant qu’acteur diplomatique, le Maroc joue un rôle clé dans les efforts de médiation et de stabilisation. Il a réussi à réduire les divergences idéologiques entre les parties et a contribué de manière significative à la diminution du conflit interne.
La crise affecte également les dynamiques sécuritaires et économiques régionales, influençant les politiques marocaines en matière de migration, de sécurité et de coopération régionale.
Sécurité Frontalière
Le Maroc a dû renforcer la sécurité à ses frontières pour prévenir l’infiltration de groupes armés et de terroristes. Les autorités marocaines ont intensifié les mesures de surveillance et de contrôle pour maintenir la stabilité intérieure. Parallèlement, elles ont pris des mesures pour réduire le trafic commercial informel, en proposant des incitations fiscales, des mesures sociales et des subventions d’investissement appropriées.
Diplomatie Régionale
Le Maroc a joué un rôle actif dans les efforts de médiation pour résoudre la crise libyenne,[24] cherchant à promouvoir la stabilité régionale par le dialogue et la coopération. Le Royaume a accueilli plusieurs réunions et négociations entre les factions libyennes pour encourager une solution politique inclusive.[25]
Impact Économique
Bien que le Maroc ne soit pas directement dépendant des ressources libyennes, l’instabilité régionale a des répercussions sur les échanges commerciaux et les investissements. Pour atténuer les impacts de la crise libyenne, le Maroc continue de diversifier ses partenaires économiques. [26] De plus, le pays doit se concentrer sur la création d’une autosuffisance agricole en développant une industrie agroalimentaire indépendante, afin de réduire sa dépendance aux importations.
Crise en Ukraine
La crise en Ukraine, marquée par l’invasion russe, a des implications géopolitiques et économiques mondiales.
Sanctions et Relations Commerciales
Les sanctions imposées contre la Russie perturbent les relations commerciales et économiques à l’échelle mondiale[27]. Pour le Maroc, cela pourrait représenter une opportunité de renforcer ses relations commerciales avec l’Europe et les États-Unis, tout en diversifiant ses partenaires économiques.
Sécurité Énergétique
La crise a mis en lumière la dépendance de l’Europe au gaz russe, ce qui pourrait influencer les marchés énergétiques mondiaux. Le Maroc pourrait jouer un rôle stratégique en tant que fournisseur potentiel d’énergie renouvelable à l’Europe,[28] En effet, les conditions climatiques favorables du Maroc renforcent sa stratégie de développement des énergies renouvelables, ce qui constitue une valeur ajoutée
Augmentation des Prix de l’Énergie
La crise en Ukraine a des répercussions sur la sécurité énergétique du Maroc, qui a entrepris des efforts pour diversifier ses sources d’énergie, notamment en investissant dans les énergies renouvelables[29]. La crise pourrait accélérer ces efforts et positionner le Maroc comme un leader régional en matière de transition énergétique. Comme beaucoup d’autres pays, le Maroc a ressenti la montée des prix de l’énergie. La Russie étant un grand exportateur de gaz et de pétrole, les perturbations causées par la crise ont entraîné une hausse des coûts énergétiques.
Inflation
L’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières a contribué à une inflation plus élevée, affectant le coût de la vie des Marocains.[30]
Crise à Gaza
Le conflit israélo-palestinien,[31] particulièrement les tensions à Gaza, continue d’être une source d’instabilité au Moyen-Orient :
Relations Diplomatiques
Les relations entre les pays arabes et Israël, ainsi que le soutien à la cause palestinienne, sont des éléments clés de la politique étrangère de nombreux pays de la région.[32] Le Maroc pourrait utiliser sa position diplomatique pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région.
Impact Humanitaire
La crise humanitaire à Gaza a des répercussions sur les politiques d’aide et de soutien humanitaire des pays de la région. Le Maroc pourrait jouer un rôle actif dans les efforts humanitaires, renforçant ainsi son image internationale.[33]
A suivre…
[1] Youssra ABOURABII. Les relations internationales du Maroc : Le Maroc à la recherche d’une identité stratégique. Paragraphe 2.3. https://books.openedition.org/cjb/1086?lang=fr.
[2] Kamal KAJJA. Maroc, Algérie : nouvelles tensions sur fond de rivalités de pouvoir entre les deux voisins.Herodote 2021 .page 72.
[3] https://www.bladi.net/avenir-incertain-relation-maroc-algerie,105167.html.
[4] Mohamed Loulichki, Senior Fellow,VI.Le Maroc dans un environnement global de mutation .page 28. https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2023-05/Activity%20Report%20PCNS%202022%20%28FR%29%20Web.pdf.
[5] Une « nouvelle intensification » entre l’Algérie et le Maroc. https://adf-magazine.com/fr/2024/04/une-nouvelle-intensification-entre-lalgerie-et-le-maroc/
[6] Francisco Serrano est journaliste, écrivain et analyste. https://www.bladi.net/avenir-incertain-relation-maroc-algerie,105167.html.
[7] https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=INCODIR.
[8] Kassim BOUHOU. L’Algérie des réformes économiques : un goût d’inachevé .Edition Institut francais des relations internationales (2009/2 été). https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2009-2-page-323.html.Page 327 à 330.
[9] https://diplomatie.ma/fr/onu-la-r%C3%A9solution-2548-consacre-%C3%A0-nouveau-lalg%C3%A9rie-comme-partie-principale-au-diff%C3%A9rend-r%C3%A9gional-sur-le-sahara-marocain.
[10] Luis MARTINEZ. Algérie et Maroc : rivaux ou ennemis ? AFKAR/IDEES, automne/hiver 2021. https://www.iemed.org/publication/algerie-et-maroc-rivaux-ou-ennemis/?lang=fr.
[11] Youssra ABOURABI. Les relations internationales du Maroc : Le Maroc à la recherche d’une identité stratégique. Paragraphe 8. https://books.openedition.org/cjb/1086#anchor-fulltext.
[12] Même référence. Paragraphe 9.
[13] Même référence. Paragraphe 3.
[14] Jean Pierre Filiu. Le risque en 2022 d’une guerre entre l’Algérie et le Maroc.Lemonde.fr.26 décembre 2021.
[15] https://www.jeuneafrique.com/1431860/economie-entreprises/vers-leffondrement-economique-de-la-tunisie-cinq-questions-pour-comprendre-la-crise/.
[16] En Tunisie, des milliers de personnes ont manifesté contre la crise socio-économique qui touche le pays.lemonde.fr.le 2/03/2024.
[17] https://en-m-wikipedia-.org.translate.goog/wiki/Libyan_Crisis_(2011%E2%80%93present)?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=rq
[18] Karim MEZRAN Katharina PRUEGEL. Une dernière chance pour la Libye. OUVRE TERRE 2015/3(n°44).page 119.
[19] Roberto Paglialonga. Libye: un pays dans une instabilité permanente.7/03/2024. https://www.osservatoreromano.va/fr/news/2024-03/fra-010/libye-un-pays-dans-une-instabilite-permanente.html.
[20] Karim MEZRAN Katharina PRUEGEL. Une dernière chance pour la Libye. OUVRE TERRE 2015/3(n°44).page 120 .
[21] Ali BENSAAD. L’immigration en Libye : une ressource et la diversité de ses usages. Politique Africaine .2012/1 (n°125).page 84.
[22] Même références page 122.
[23] Chapitre 2. Une impossibilité quasi–ontologique des Organisations internationales ? https://books.openedition.org/dice/7942?lang=fr
[24] https://diplomatie.ma/fr/l%E2%80%99onu-met-en-exergue-le-r%C3%B4le-du-maroc-pour-la-r%C3%A9solution-du-conflit-libyen.
[25] https://medias24.com/2023/12/08/le-president-du-haut-conseil-detat-libyen-salue-la-position-du-maroc-co.
[26] Le Maroc Vers une intégration régionale et internationale réussie. Page 51. https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/maroc-integration-internationale-reussie-french.pdf.
[27] Boran TOBELEM. Guerre en Ukraine : quelles sanctions de l’Union européenne contre la Russie ?Toute l’europe.19/03/2024. https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-quelles-sanctions-de-l-ue-contre-la-russie/.
[28] Jonathan Josephs. Journaliste économique. BBC News Rabat Le Maroc peut-il résoudre la crise énergétique de l’Europe ?BBC NEWS AFRIQUE.10 mai 2023.
[29] Rim BERAHAB Tendances et perspectives énergétiques à l’horizon 2023 : survivre à la crise énergétique tout en construisant un avenir plus vert. Policy Brief – N° 04/23 – Janvier 2023.
[30] Me Abdelhakim El kadiri Boutchich. Gestion de l’Inflation et de la Déflation au Maroc : Stratégies pour une Stabilité Économique Durable » du 08/06/2024.
[31] Rhéa Fanneau de la Horie .Gaspard Béquet. Le conflit israélo-palestinien : une instabilité endémique aux portes de la Méditerranée orientale. Revue défense nationale.2021.HSR (hors-série).page 31 à 38.
[32] Israël face au monde arabe : La Palestine entre la guerre et la paix. https://books.openedition.org/septentrion/48752?lang=fr
[33] Khalid Mejdoub. Le Maroc appelle à une action urgente pour acheminer l’aide et mettre fin à la tragédie humanitaire à Gaza.11/06/2024. ppelle-à-une-action-urgente-pour-acheminer-laide-et-mettre-fin-à-la-tragédie-humanitaire-à-gaza/3246868.
Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.