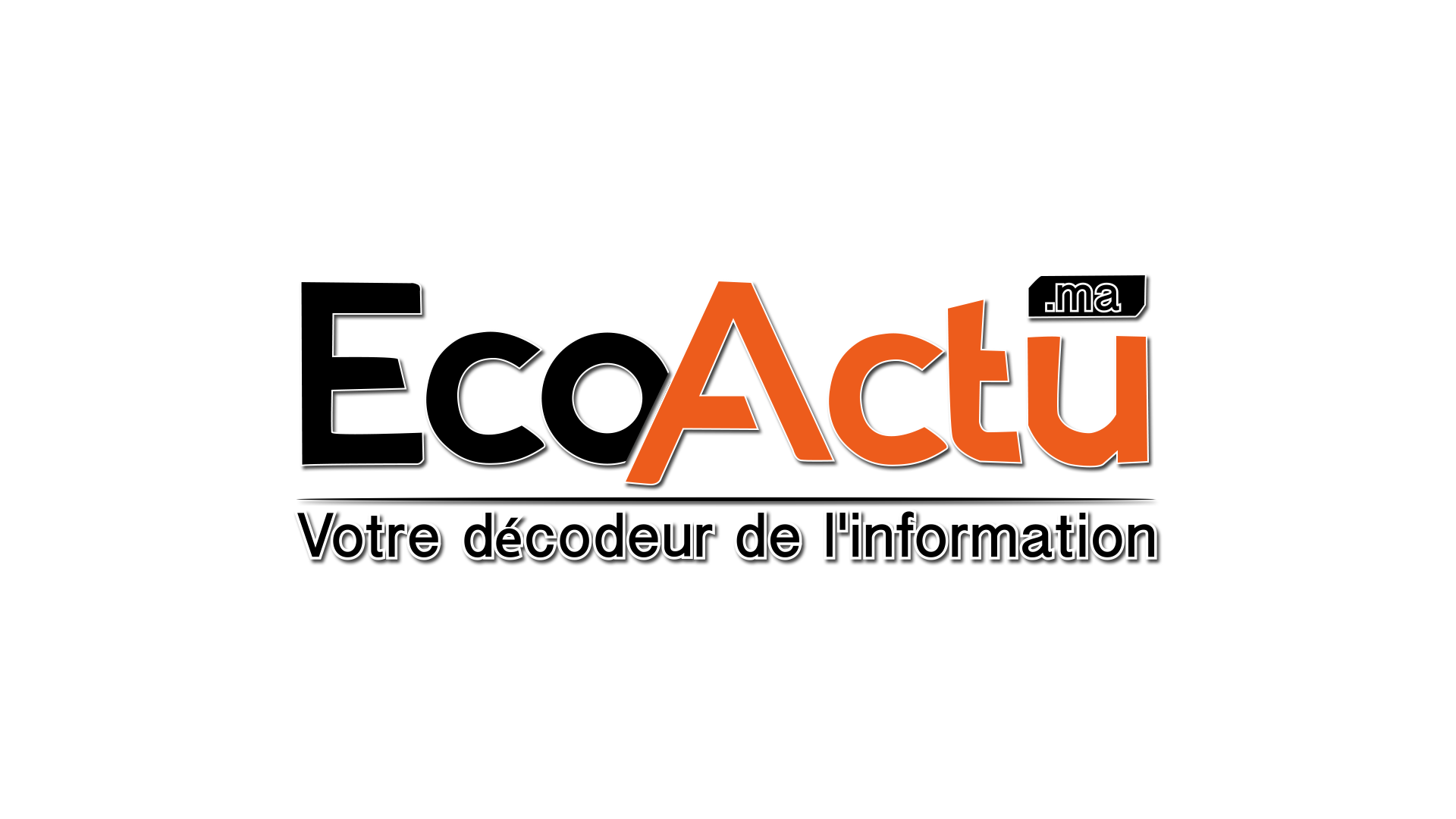Ecrit par Imane Bouhrara I
Pour le développement des ressources en eau non-conventionnelles dans ce contexte de stress hydrique, le Maroc prône le dessalement de l’eau de mer comme l’un des trois piliers de la politique de l’eau pour renforcer l’approvisionnement en eau potable des villes côtières permettant ainsi un équilibre de répartition des ressources en eau pour les zones intérieures et pour l’irrigation des périmètres agricoles aménagés. Sans oublier, la réutilisation des eaux usées pour l’arrosage des espaces verts et pour des fins industrielles. Un choix économiquement et techniquement soutenable ?
Doté d’importantes infrastructures hydrauliques dont 153 grands barrages, 141 petits barrages et lacs collinaires, des milliers de forages et puits pour l’exploitation des eaux souterraines et de 17 systèmes de transferts d’eau dont l’interconnexion des bassins de Sebou et de Bouregreg d’un linéaire de 67 km, le Maroc est en course contre la montre pour développer des infrastructures mobilisant les ressources en eau non conventionnelles à travers la réalisation de 15 stations de dessalement d’eau de mer et 158 stations de traitement des eaux usées.
L’objectif étant de généraliser l’approvisionnement en eau potable, tout en accompagnant le développement industriel et touristique, et assurant l’irrigation de plus de 2 Millions d’hectares irrigués et la production hydroélectrique avec une puissance installée de 2120 mégawatts…
A noter que ces projets de développement des ressources en eau non-conventionnelles par le dessalement de l’eau de mer vont recourir aux énergies renouvelables.
Le coût d’investissement et d’exploitation, la disponibilité des technologies, l’impact environnemental de ces projets sont autant de questions qui peuvent se poser ainsi que la compétitivité de l’offre.
Autant de questions auxquelles Azzedine El Midaoui, Directeur de l’Institut International de Recherche sur l’Eau à l’UM6P, a répondu lors des Mastreclasses de l’eau tout en insistant sur l’importance de bien réussir un montage financier d’une station de dessalement d’eau.
D’emblée il souligne qu’aujourd’hui 2 milliards d’habitants n’ont pas accès à l’eau et vivent une situation de pénurie. « Cela a transformé le regard sur cette problématique, l’eau qui était un bien public gratuit devient une valeur économique et sociale extrêmement importante. A cette fin la réponse est multiple à travers le Programme National d’Approvisionnement en Eau potable et d’Irrigation (PNAEI 2022-2027) ».
Actuellement, le dessalement d’eau est une question qui se répète partout, pourtant il existe bien des projets nationaux qui permettent de juger les choix qui s’adaptent au Maroc, mais aussi des défis que posent ce type de projets.
Si les technologies de dessalement sont multiples à différents niveaux de maturité technologique et de recherches scientifique, deux technologies se distinguent au niveau mondial, la technologie thermique basée sur la chaleur et la technologie membranaire basée sur l’électricité et donc consommatrices d’énergie.
Pour les utilisations des 140 millions de m3 par jour d’eau désalinisée, l’eau potable s’accapare presque à 70% couvrant à peine 5% de la consommation, 30% de la production est destinée pour les industries et une très faible proportion pour l’eau d’irrigation sauf pour les cultures de forte valeur ajoutée parce que c’est une eau très chère, explique Azzedine El Midaoui.
Au Maroc, on produit 300.000 m3 par jour avec l’objectif d’atteindre 1,1 million à 1,2 million m3 par jour en 2030.
« Le Maroc a fait le bon choix technique puisque dans le monde vous avez 63% d’eau désalinisée en osmose inverse, pour seulement 23% pour le thermique. Au niveau national, le dessalement représente 1% de la production nationale, contre 65% pour les autres surfaces et 34% pour les eaux souterraines », soutient-il.
Avant d’explorer le défi économique d’une station de dessalement d’eau, il a commencé par expliquer la composition d’une installation de dessalement en osmose inverse et comment chaque élément impacte le coût d’investissement, de fonctionnement et d’exploitation de la station.
« D’abord la prise d’eau (10 à 20 de l’OPEX) pour alimenter la station, un faux choix peut-être fatal. Il faut au minimum un an pour étudier l’écosystème pour avoir une prise d’eau sans bouleverser cet écosystème. Le prétraitement est aussi très important. Pour la membrane, le cœur de la station, beaucoup de progrès ont été réalisés à ce niveau car deux facteurs, la perméabilité et la sélectivité sont importantes pour éviter des rejets trop importants. Dans ce sens les membranes biologiques sont quasi parfaites. L’énergie est également un facteur clé qui peut peser jusqu’à 60% du coût du mètre cube d’eau en fonctionnement d’où l’importance de passer vers des énergies vertes. Le post traitement est aussi important, l’eau est très corrosive après dessalement et donc il faut la traiter. L’autre facteur à ne pas négliger est la saumure, le rejet qui se posera avec la station de Casablanca, la 2e plus grande station de dessalement après celle de l’Arabie Saoudite avec plus de 850.000 m3 par jour d’eau saumâtre ce qui pose la question de la recherche pour la valorisation de la saumure et en extraire plus d’eau. L’impact environnemental est également important avec une émission de 0,7 gramme de CO2 pour un m3 d’eau produite », explique Azzedine El Midaoui.
En matière des challenges économiques, il cite trois grandes composantes : le capital, le coût de fonctionnement et l’énergie.
En ce qui concerne le coût d’investissement, cela dépend du choix de la technologie (thermique ou membranaire) qui doit être porté par des chercheurs et des ingénieurs pour opter pour la technologie la plus adaptée.
Il y a également la dimension de la station, petit moyenne ou grande. Cela dépend aussi de la qualité de l’eau : de mer, saumâtre ou usée.
La prise d’eau qui représente jusqu’à 25% de l’investissement, les pré-traitements et post traitement à bien choisir (conventionnel, non conventionnel ou mixte). Le consommable dont le remplacement des membranes dont la durée de vie est de trois à cinq ans est également un paramètre influençant le coût du dessalement.
La maintenance, la main d’œuvre, le rejet de saumure, le stockage d’eau, la distribution, les taux de conversion, le coûts de l’énergie renouvelable ou pas, la période d’amortissement et le mode de financement, l’inflation, le taux de change, les taux d’intérêt, le type de contrat (BOT, BOOT ou PPP), le coût de vente de l’eau et la compétitivité de l’offre… sont autant d’éléments qui doivent être pris en considération du business plan.
Il cite par ailleurs le coût de dessalement d’eau de mer en Osmose inverse qui varie entre 1.500 et 2.000 dollars par jour pour une petite station produisant moins de 20.000 m3 par jour, de 1.000 à 1.500 dollars pour une moyenne station d’une production de 20.000 à 80.000 m3 par jour et de 700 à 1.200 dollars pour une grade station produisant plus de 100.000 m3 par jour.
Pour l’eau saumâtre le coût est moindre, soit 200 à 400 dollars par m3 par jour en NF (nanofiltration), 200 à 400 dollars le m3 par jour en ED (électrodialyse) et entre 250 et 1.000 dollars le m3 par jour en osmose OI (osmose inversée).
Le coût de fonctionnement aussi se réduit plus la taille de la station est grande, pour autant avant de recourir à l’eau de mer, Azzedine El Midaoui privilégie nettement le traitement des eaux usées étant plus compétitif et peut aller même vers la production en eau potable comme cela a été réalisé ailleurs, mais aussi permet de réduire l’impact de pollution de 1 Md de m3 d’eaux usées sans traitement rejetées au Maroc.
Et en conclusion, Azzedine El Midaoui a insisté que la maîtrise des technologies à l’échelle mondiale et nationale avec une grande technicité, et une grande expertise des universités marocaines en termes de recherche sur le sujet, dont l’Institut international de recherche en eau (IWRI) de l’UM6P.
Il a également relevé que le coût du dessalement reste élevé et que les contrats avec le privé sont recommandés en vue de diminuer le prix du m3 d’autant que la production devrait progresser à 1,2 million de m3 par jour.