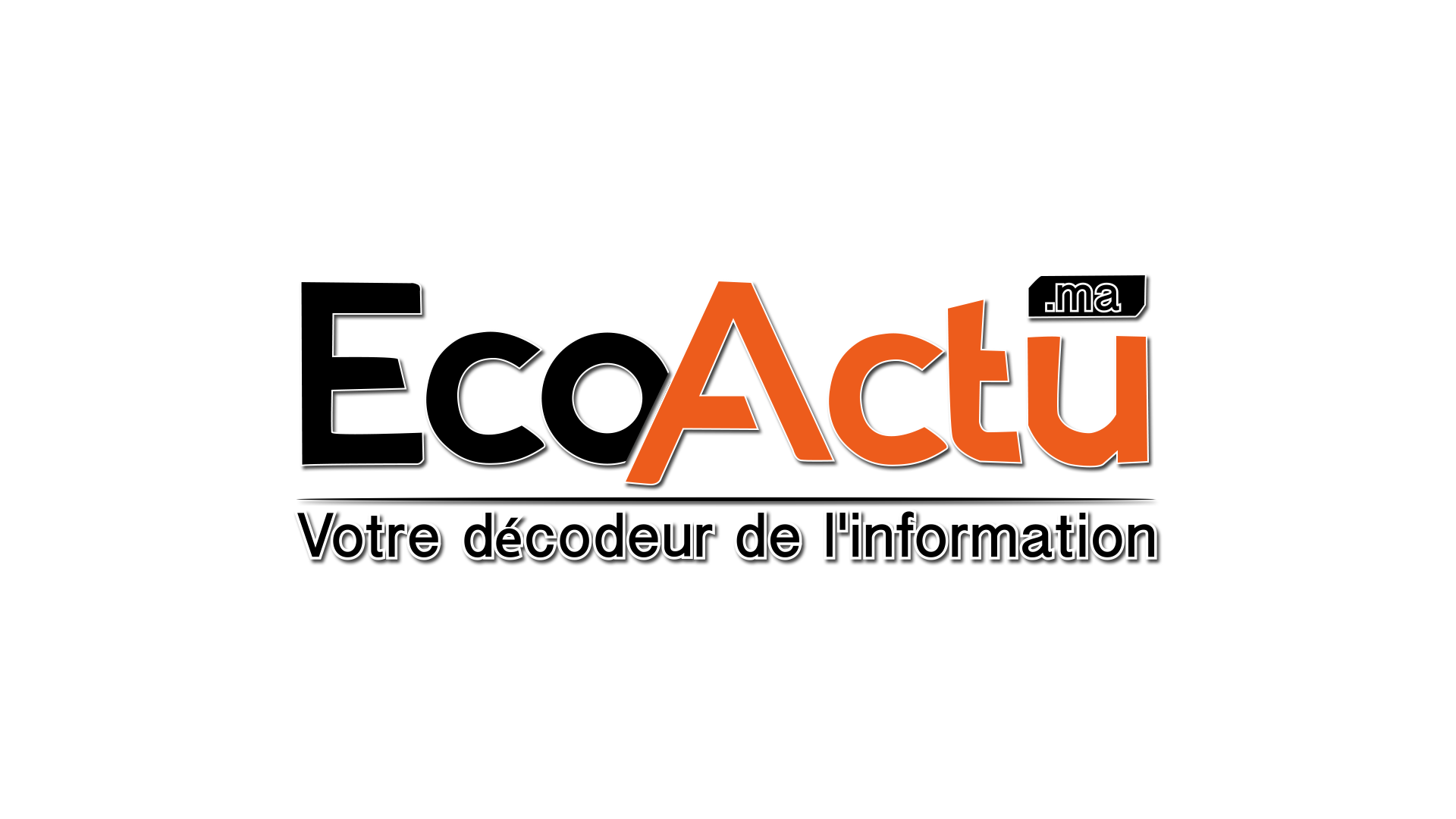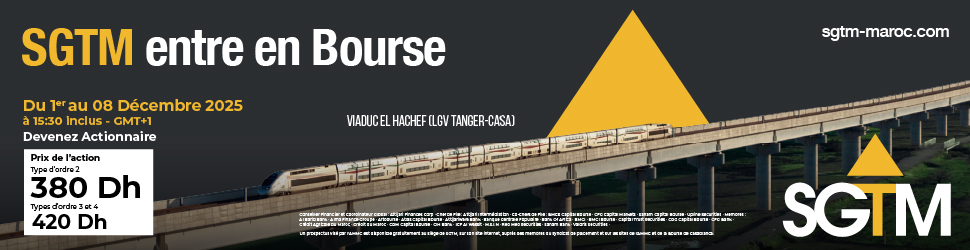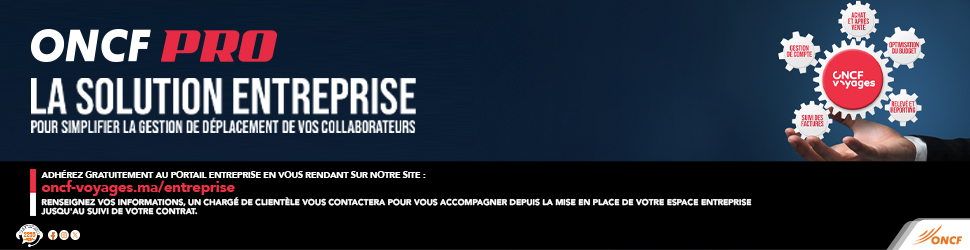Alors que le monde s’efforce de contenir les crises multiples du XXIe siècle, une nouvelle ligne rouge semble avoir été franchie en Asie du Sud. Ce samedi 10 mai 2025, l’armée pakistanaise a lancé une opération militaire contre l’Inde, en réponse à des frappes de missiles indiens sur ses bases aériennes. Cette escalade, alimentée par les tensions persistantes au Cachemire et un attentat meurtrier du 22 avril, marque le plus grave affrontement entre les deux puissances nucléaires depuis la guerre de Kargil en 1999.
Des explosions ont été signalées à Srinagar, Lahore, Rawalpindi, Peshawar et même aux abords d’Islamabad. L’ombre du nucléaire n’a jamais semblé aussi proche. Le Pakistan a convoqué son Autorité du commandement national, responsable de l’arsenal nucléaire. Le G7 appelle à la désescalade. Mais pour l’Afrique, que signifie ce conflit ?
L’Afrique ne peut pas se contenter d’observer passivement les soubresauts d’un monde de plus en plus instable. Le conflit entre l’Inde et le Pakistan ne concerne pas seulement deux voisins aux contentieux historiques. Il reflète une réalité plus large : celle d’un monde post-occidental, traversé par des rivalités régionales explosives, où les normes multilatérales s’érodent et où l’arme nucléaire redevient un levier de puissance dans les calculs géopolitiques.
Or, ces deux pays ont des intérêts croissants en Afrique. L’Inde est l’un des plus grands investisseurs dans les infrastructures africaines, de Djibouti à Maputo, et ambitionne de rivaliser avec la Chine sur le continent. Sa forte diaspora implantée dans des pays comme le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, l’Afrique du Sud ou Maurice est un levier d’influence économique et culturelle non négligeable. De son côté, le Pakistan développe une diplomatie économique plus discrète mais stratégique, notamment avec les pays arabes du Golfe, où réside une importante communauté pakistanaise et où ses alliances religieuses et géopolitiques trouvent un terreau favorable.
Ce conflit doit pousser les capitales africaines à s’interroger : quelles alliances demain ? quelles vulnérabilités aujourd’hui ? Car en cas de déflagration régionale, les routes maritimes de l’océan Indien seraient affectées, notamment les corridors énergétiques entre le Golfe, l’Afrique de l’Est et l’Asie. Le Mozambique, le Kenya, la Tanzanie et l’Égypte pourraient voir leur commerce maritime perturbé.
Au-delà de l’économie, l’Afrique doit rester vigilante face aux risques de polarisation diplomatique. Déjà, les rivalités sino-américaines ou russo-occidentales infiltrent les forums africains. Si le conflit Inde–Pakistan s’aggrave, certains pays pourraient être tentés de se positionner selon leurs affinités stratégiques ou leurs dettes bilatérales.
L’Union africaine, les Communautés économiques régionales (CER), et des puissances telles que le Nigéria, l’Égypte, l’Afrique du Sud ou le Maroc doivent faire entendre une voix africaine ferme en faveur de la désescalade, du dialogue, et du respect du droit international. Le continent, victime collatérale de tant de conflits mondiaux, ne peut rester passif.
Ce conflit nous rappelle crûment que la sécurité collective est un bien mondial, et que l’Afrique doit peser dans sa gouvernance. Il est temps pour les États africains de renforcer leurs capacités diplomatiques, leur résilience stratégique, et surtout de promouvoir une architecture de paix africaine qui ne soit pas tributaire des seules puissances extérieures.
La guerre ne fait pas que des morts là où elle éclate. Elle fragilise les équilibres globaux, redessine les alliances, et impose des choix. L’Afrique, souvent réduite à un théâtre d’influence, doit devenir un acteur géopolitique conscient et souverain. Le conflit indo-pakistanais n’est pas le sien, mais ses répliques pourraient l’atteindre. À elle de transformer cette crise en opportunité de leadership.
Origine historique du conflit indo-pakistanais
Le conflit entre l’Inde et le Pakistan autour du Cachemire remonte à la partition sanglante de l’Empire britannique des Indes en 1947. À l’indépendance, le Cachemire – un État princier à majorité musulmane dirigé par un maharaja hindou – devait choisir entre rejoindre l’Inde ou le Pakistan. Le maharaja opta pour l’Inde, provoquant une première guerre indo-pakistanaise (1947–1948).
Depuis, les deux pays se sont affrontés à trois reprises directement au sujet du Cachemire (1947–48, 1965, 1999), sans parvenir à une résolution. La région est aujourd’hui divisée entre le Jammu-et-Cachemire indien et l’Azad Cachemire contrôlé par le Pakistan, séparés par une ligne de contrôle très militarisée.
La révocation unilatérale en 2019 par l’Inde de l’autonomie constitutionnelle du Jammu-et-Cachemire a ravivé les tensions, tout comme les accusations mutuelles de soutien au terrorisme. L’attentat du 22 avril 2025 contre des forces de sécurité indiennes au Cachemire a été le déclencheur immédiat de l’escalade militaire actuelle, mais il s’inscrit dans un contentieux historique plus profond, nourri par le nationalisme, la méfiance mutuelle et la rivalité stratégique entre deux puissances nucléaires.
Toutes les tentatives de médiation – qu’elles viennent des Nations Unies, des grandes puissances, ou des pays musulmans – n’ont jusqu’ici pas permis de briser ce cycle de violence. La situation actuelle démontre à quel point la paix au Cachemire reste l’un des conflits gelés les plus dangereux au monde.
Actions internationales en faveur de la désescalade
L’escalade entre l’Inde et le Pakistan a suscité une mobilisation diplomatique mondiale. Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a exprimé sa vive inquiétude et a exhorté les deux parties à faire preuve de retenue, tandis que le Conseil de sécurité a tenu une session d’urgence pour appeler au dialogue.
Les États-Unis, par la voix de leur Secrétaire d’État Marco Rubio, ont engagé des discussions avec les autorités militaires pakistanaises, proposant une médiation américaine pour éviter une guerre ouverte.
La Chine, traditionnellement proche du Pakistan mais soucieuse de la stabilité régionale, a appelé à la retenue mutuelle et à la désescalade immédiate. La Russie, tout en restant prudente, a exprimé sa préoccupation et recommandé à ses ressortissants d’éviter la zone de conflit, insistant sur l’importance de maintenir la paix en Asie du Sud.
Du côté arabe, l’Arabie Saoudite et plusieurs États du Golfe ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences régionales d’un conflit prolongé, notamment sur les routes énergétiques et la sécurité maritime. Des canaux de médiation bilatéraux ont été activés pour tenter un rapprochement diplomatique.
L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a affiché sa solidarité avec le Pakistan, tout en appelant à une solution pacifique et à la protection des civils. Enfin, l’Iran, préoccupé par une nouvelle instabilité à ses frontières orientales, a proposé un rôle de facilitateur pour engager un dialogue entre New Delhi et Islamabad.
Malgré ces nombreuses démarches diplomatiques, aucune de ces initiatives n’a, à ce jour, permis d’enrayer la spirale de confrontation, révélant la profondeur de la crise et la complexité des rivalités historiques entre les deux puissances nucléaires.
Dans ce contexte tendu, les États-Unis ont toutefois joué un rôle décisif. Selon la chaîne CNN, le vice-président américain J.D. Vance a personnellement contacté le Premier ministre indien Narendra Modi pour l’exhorter à engager un dialogue direct avec le Pakistan. Appuyée par des informations sensibles et des échanges diplomatiques menés en urgence, cette initiative américaine a permis de rétablir un canal de communication entre les deux pays. Un cessez-le-feu est désormais en vigueur, témoignant de l’impact que peuvent encore avoir certaines médiations discrètes sur les équilibres géostratégiques les plus fragiles.
Ecrit par Par Mohamed H’MIDOUCHE, Chercheur, Analyste géopolitique et Vice-Président de l’IMRI