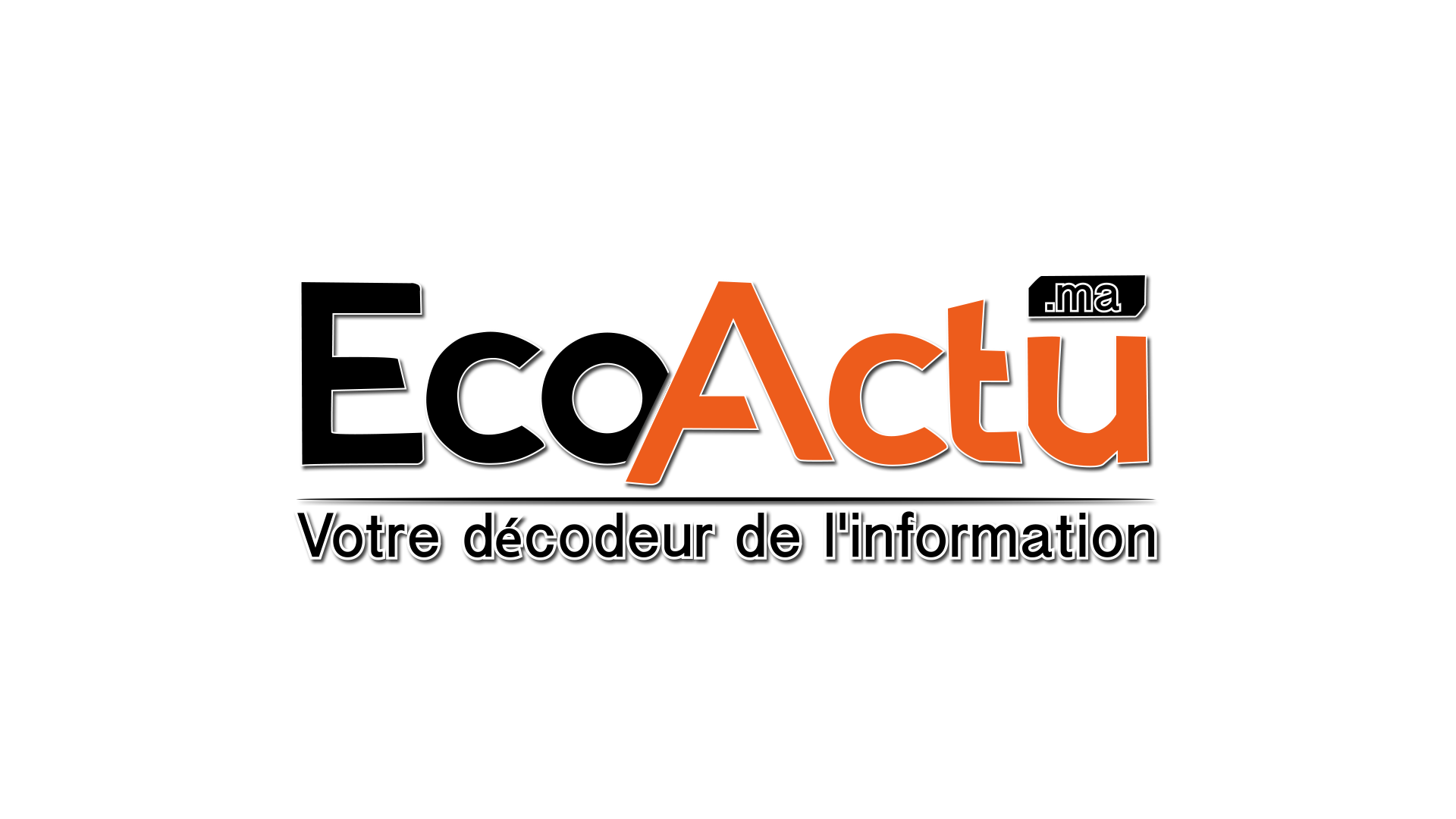La réforme de la Moudawana en 2004 a été un tournant crucial pour le Maroc. Elle a marqué une étape importante dans l’évolution des droits de la famille, en particulier pour les femmes, en introduisant des changements significatifs dans la législation marocaine. Ce développement explore les aspects clés de cette réforme, son impact sur la société marocaine, ainsi que les défis persistants.
Je me suis basé sur cette étude sur les différents textes de la charia, du coran, ainsi que sur la documentation publiée à ce sujet.
Je me suis axé pour traiter cette problématique sur les axes suivants :
- Contexte Historique et Objectifs de la Réforme.
- Principales Modifications Apportées par la Nouvelle Moudawana.
- Impacts Sociaux et Économiques.
- Défis et Résistances.
- Perspectives d’Avenir.
- Vers une Société Plus Juste.1. Contexte Historique et Objectifs de la RéformeAvant la réforme, le Code de la famille marocain était largement influencé par des interprétations traditionnelles du droit islamique, qui limitaient souvent les droits des femmes. Les pressions pour réformer ce code ont émergé des mouvements féministes, des organisations de la société civile et des changements sociaux globaux. L’objectif principal de la réforme était de promouvoir l’égalité des sexes et de moderniser le cadre juridique pour mieux refléter les valeurs contemporaines de justice et d’égalité.
2. Principales Modifications Apportées par la Nouvelle Moudawana
Les réformes ont introduit plusieurs changements clés :
2.1. Mariage
2.1.1. Âge légal du mariage :
L’une des réformes majeures a été l’élévation de l’âge légal du mariage à 18 ans pour les deux sexes. Cette décision visait à protéger les jeunes filles contre les mariages précoces, qui peuvent avoir des conséquences négatives sur leur santé, leur éducation et leur développement personnel.
2.1.2. Consentement mutuel :
La réforme de la Moudawana a considérablement renforcé l’importance du consentement dans le mariage. Il est désormais impératif que les deux parties expriment clairement leur accord, une mesure visant à prévenir les mariages forcés. Cette avancée a été saluée comme un pas important vers l’autonomisation des femmes, leur offrant un plus grand contrôle sur leur vie personnelle.
Dans l’islam, le consentement est un principe fondamental. Le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a souligné son importance, notamment pour les femmes. Un hadith rapporté par Ibn Abbas stipule : Une veuve ou une femme divorcée ne doit pas être mariée sans qu’on lui demande son avis, et une vierge ne doit pas être mariée sans son consentement. (Sahih al-Bukhari, Livre 67, Hadith 42). Cette référence met en lumière un principe essentiel, désormais renforcé par les réformes de la Moudawana, alignant ainsi la législation avec les enseignements islamiques.
2.1.3. Rôle des Oulémas :
Les Oulémas ont joué un rôle crucial dans l’acceptation de ces réformes, en veillant à ce qu’elles soient conformes aux principes islamiques tout en répondant aux besoins contemporains de la société marocaine. Leur approbation a contribué à légitimer ces changements aux yeux de la population, en montrant que l’islam et les droits modernes peuvent coexister harmonieusement.
2.1.3.1. Mesures contre les mariages forcés* :
Des procédures judiciaires plus strictes ont été mises en place pour vérifier le consentement des deux parties. Les juges ont le pouvoir d’enquêter sur les cas suspects de mariage forcé, ajoutant une couche de protection supplémentaire. En cas de non-respect, des sanctions peuvent être appliquées, allant de l’annulation du mariage à des peines pénales pour les responsables. Ces mesures visent à garantir que le mariage soit un acte volontaire et conscient, en ligne avec les principes fondamentaux de l’islam.
Dans l’islam, le consentement est un principe essentiel. Le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a souligné son importance, notamment pour les femmes. Un hadith rapporté par Ibn Abbas stipule : Une veuve ou une femme divorcée ne doit pas être mariée sans qu’on lui demande son avis, et une vierge ne doit pas être mariée sans son consentement. (Sahih al-Bukhari, Livre 67, Hadith 42). Cette référence met en lumière un principe central, désormais renforcé par les réformes de la Moudawana, alignant ainsi la législation avec les enseignements islamiques.
2.1.3.2. Sensibilisation et éducation :
En parallèle avec les changements législatifs, des campagnes de sensibilisation ont été déployées pour éduquer la population sur les droits des femmes et l’importance du consentement dans le mariage. Ces initiatives ont été essentielles pour transformer les mentalités et réduire les pratiques traditionnelles qui ne respectent pas ces principes. Les campagnes ont pris diverses formes, allant des séminaires et ateliers communautaires aux programmes éducatifs dans les écoles et les médias.
Les organisations non gouvernementales, ainsi que des institutions gouvernementales, ont joué un rôle crucial dans la mise en œuvre de ces campagnes. Par exemple, des groupes comme l’Union de l’Action Féminine au Maroc ont été actifs dans la promotion des droits des femmes et l’éducation des communautés locales sur les réformes du Code de la Famille. Ces efforts visent à créer une prise de conscience généralisée sur les droits légaux et à encourager un changement culturel durable.
Des études, telles que celles publiées dans les revues académiques comme Feminist Review ou des rapports de l’ONU Femmes, soulignent l’impact positif de ces campagnes. Elles montrent que l’éducation et la sensibilisation sont des outils puissants pour lutter contre les pratiques discriminatoires et pour promouvoir l’égalité des sexes. Ces ressources offrent une perspective approfondie sur la manière dont l’éducation peut servir de catalyseur pour le changement social, en complément des réformes législatives.
Ces réformes, soutenues par le Conseil des Oulémas, ont contribué à moderniser le cadre légal du mariage au Maroc, tout en respectant les valeurs culturelles et religieuses du pays. Elles représentent un effort pour équilibrer tradition et modernité, et pour promouvoir une société plus juste et équitable.
2.2. Divorce :
2.2.1. Égalité et justice :
Le Coran insiste sur l’équité et la justice dans les relations familiales. Par exemple, le verset 4 :1 du Coran appelle à la piété et au respect mutuel entre les hommes et les femmes.
2.2.2 Traitement équitable des épouses :
Le verset 4 :19 du Coran exhorte les hommes à bien traiter leurs épouses, ce qui est interprété comme une base pour protéger les droits des femmes dans le mariage.
2.2.3. Divorce :
Le Coran reconnaît le divorce comme un recours légitime, mais il met l’accent sur le traitement juste et bienveillant des femmes. Le verset 2 :231 conseille de garder les femmes avec bienveillance ou de les libérer avec bonté.
2.1.3.1. Consentement mutuel :
Le concept de divorce par consentement mutuel peut être lié à l’esprit de coopération et de consentement mutuel encouragé dans le mariage, tel que mentionné dans le verset 4 :128.
2.1.3.2. Hadiths :
Plusieurs hadiths du Prophète Muhammad soulignent l’importance du respect et de la gentillesse envers les épouses. Par exemple, un hadith rapporté par Al-Tirmidhi dit : Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme.
2.1.4. Garde des enfants et héritage :
La question de la garde des enfants et des droits d’héritage dans le cadre de la charia est complexe et varie selon les interprétations et les contextes culturels. Voici quelques éléments clés basés sur le Coran, les hadiths, et les réformes modernes comme celles de la Moudawana :
2.1.4.1. Garde des enfants
2.1.4.1.1. Intérêt supérieur de l’enfant :
La charia met un accent sur le bien-être des enfants. Bien que le Coran ne traite pas directement de la garde des enfants après un divorce, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est généralement accepté. Les décisions concernant la garde sont souvent basées sur ce principe, en tenant compte de la capacité des parents à subvenir aux besoins émotionnels et matériels de l’enfant.
2.1.4.1.2. Réformes modernes :
La Moudawana, par exemple, a introduit des réformes qui permettent aux mères de conserver la garde des enfants jusqu’à un certain âge, sauf si cela est jugé contraire à l’intérêt de l’enfant. Cela reflète une interprétation plus flexible et moderne des principes islamiques.
2.1. 5.. Héritage
2.1.5.1. Dispositions coraniques :
Le Coran contient des versets spécifiques sur l’héritage, notamment dans la sourate An-Nisa (4 :11-12), qui établissent des parts précises pour les héritiers, en accordant généralement aux hommes une part plus importante qu’aux femmes. Cela est basé sur le contexte historique et social où les hommes avaient la responsabilité financière de la famille.
2.1.5.2. Réformes et interprétations modernes :
Bien que les règles traditionnelles de l’héritage soient encore largement appliquées, certaines réformes cherchent à atténuer les inégalités. Par exemple, des interprétations modernes encouragent l’utilisation de dons ou de testaments pour équilibrer les parts entre héritiers masculins et féminins, tout en respectant les prescriptions islamiques.
2.1.5.3. Hadiths et interprétations :
Les hadiths, bien qu’ils ne traitent pas directement des détails de l’héritage, encouragent la justice et l’équité dans les relations familiales. Par exemple, un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim insiste sur le fait de ne pas priver les héritiers de leurs droits.
Les réformes modernes, comme celles de la Moudawana, cherchent à harmoniser les principes de la charia avec les valeurs contemporaines de justice et d’égalité, en s’appuyant sur des interprétations progressistes des textes islamiques. Cela reflète une volonté d’adapter les lois familiales aux réalités actuelles tout en respectant les fondements religieux.
- 3. Impacts Sociaux et ÉconomiquesLa nouvelle Moudawana a eu plusieurs impacts positifs :1. Autonomisation des femmes :
En renforçant les droits des femmes dans le cadre familial, la réforme a contribué à leur autonomisation sociale et économique. Les femmes ont désormais un meilleur accès à l’éducation et à l’emploi.
3.1.1. Garde des enfants
3.1.1.1. Intérêt supérieur de l’enfant :
– Bien que le Coran ne traite pas spécifiquement de la garde des enfants après un divorce, l’accent est mis sur le bien-être et l’éducation des enfants. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est souvent dérivé de l’esprit général de la charia qui encourage la bienveillance et la protection des plus vulnérables.
– Un verset pertinent est le verset 2 :233 du Coran, qui parle de l’allaitement et de la responsabilité partagée des parents envers leurs enfants, soulignant l’importance de la coopération pour le bien de l’enfant.
3.1.1.2. Réformes modernes :
– La Moudawana au Maroc a introduit des réformes qui permettent aux mères de conserver la garde de leurs enfants jusqu’à un certain âge, généralement jusqu’à ce que l’enfant atteigne 15 ans, sauf si cela est jugé contraire à l’intérêt de l’enfant. Cette réforme s’aligne sur l’esprit de protection et de soin envers les enfants, tout en tenant compte des réalités sociales modernes.
3.2. Héritage
3.2.1. Dispositions coraniques :
– Les versets 4 :11-12 de la sourate An-Nisa établissent des règles détaillées concernant l’héritage, en définissant des parts spécifiques pour les héritiers. Ces versets attribuent généralement une part plus importante aux hommes, en raison de leur rôle traditionnel de soutien financier dans la famille.
– Par exemple, un fils reçoit une part équivalente à celle de deux filles, ce qui reflète les responsabilités financières accrues traditionnellement assumées par les hommes.
3.2.1.1. Réformes et interprétations modernes :
– Certaines réformes et interprétations modernes cherchent à atténuer les inégalités en utilisant des mécanismes comme les dons ou les testaments pour équilibrer les parts entre héritiers masculins et féminins. Cela permet de respecter les prescriptions islamiques tout en répondant aux appels contemporains à l’équité.
3.1.2.2. Hadiths et interprétations :
– Bien que les hadiths ne traitent pas directement des détails de l’héritage, ils encouragent la justice et l’équité. Un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim souligne l’importance de ne pas priver les héritiers de leurs droits, ce qui est interprété comme un appel à l’équité et à la justice dans la distribution des biens.
Les réformes modernes, telles que celles introduites par la Moudawana, illustrent une tentative d’harmoniser les principes de la charia avec les valeurs contemporaines de justice et d’égalité.
En s’appuyant sur des interprétations progressistes des textes islamiques, ces réformes visent à adapter les lois familiales aux réalités actuelles tout en respectant les fondements religieux. Cela montre une volonté d’évolution et d’adaptation des lois pour mieux répondre aux besoins et aux droits des individus dans le contexte moderne.
3.3. Participation économique :
La participation économique des femmes dans les sociétés musulmanes a évolué au fil du temps, influencée par les interprétations des textes religieux et les réformes sociales et légales. Voici une exploration de ce sujet avec des références coraniques et des principes de la charia :
3.3.1. Principes coraniques :
– Le Coran reconnaît le droit des femmes à posséder des biens et à gérer leurs affaires financières. Le verset 4 :32 de la sourate An-Nisa affirme : Ne convoitez pas ce par quoi Dieu a favorisé certains d’entre vous par rapport à d’autres. Les hommes recevront une part de ce qu’ils auront acquis, et les femmes recevront une part de ce qu’elles auront acquis.
– Ce verset souligne le droit individuel de chaque personne, homme ou femme, à bénéficier de ses efforts et de son travail.
3.3.2. Exemples historiques :
– Historiquement, les femmes musulmanes ont joué des rôles économiques importants. Khadija bint Khuwaylid, la première épouse du Prophète Muhammad, était une femme d’affaires prospère et respectée. Son exemple montre que la participation économique des femmes est en accord avec les principes islamiques.
3.3.3. Réformes et interprétations modernes :
– Dans de nombreux pays musulmans, des réformes ont été mises en place pour renforcer les droits économiques des femmes, leur permettant d’accéder plus facilement au marché du travail et de contribuer à la croissance économique.
– Par exemple, la Moudawana au Maroc a contribué à améliorer la situation juridique et économique des femmes, leur permettant de participer plus activement à la vie économique.
3.3.3.1. Charia et participation économique :
– La charia encourage le travail et le commerce équitable. Les femmes, comme les hommes, sont encouragées à travailler et à contribuer à la société, tant que cela respecte les valeurs islamiques de justice et d’équité.
– Les principes de la charia ne s’opposent pas à la participation économique des femmes, à condition que les normes sociales et religieuses soient respectées.
3.3.3.2. Impact sur la croissance économique :
– L’intégration des femmes dans le marché du travail a des effets positifs sur la croissance économique. En apportant des compétences diversifiées et en augmentant la main-d’œuvre disponible, les femmes contribuent à une économie plus dynamique et résiliente.
– Les études montrent que l’égalité économique et l’autonomisation des femmes peuvent mener à une augmentation significative du PIB dans de nombreux pays.
La participation économique des femmes est soutenue par les principes coraniques et peut être intégrée dans le cadre de la charia, à condition que les normes culturelles et religieuses soient respectées.
Les réformes modernes, inspirées par des interprétations progressistes des textes islamiques, permettent aux femmes de jouer un rôle actif dans l’économie, contribuant ainsi au développement et à la prospérité de leurs sociétés.
Ces efforts reflètent une volonté d’adapter les lois et les pratiques sociales aux réalités contemporaines tout en respectant les valeurs fondamentales de l’islam.
4. Défis et Résistances
La mise en œuvre de la Moudawana, qui représente une réforme significative du code de la famille au Maroc, a effectivement rencontré divers défis et résistances. Voici une analyse approfondie de ces obstacles, avec des références à la charia, au Coran et à d’autres éléments pertinents :
4.1. Défis et Résistances
4.1.1. Application inégale :
4.1.1.1. Normes culturelles traditionnelles :
Dans les régions rurales, les normes culturelles et les traditions jouent souvent un rôle plus important que les lois formelles. Cela peut entraîner une application inégale des réformes de la Moudawana.
4.1.1.2. Charia et coutumes locales :
Bien que la charia encourage la justice et l’équité, son interprétation peut varier en fonction des coutumes locales. Dans certains cas, les pratiques culturelles peuvent être en tension avec les réformes légales, ce qui complique leur mise en œuvre.
4.1.2. Résistances culturelles :
4.1.2.1. Traditions culturelles et religieuses :
Certaines communautés invoquent des traditions culturelles et religieuses pour résister aux changements introduits par la Moudawana. Cela peut inclure des perceptions traditionnelles des rôles de genre qui ne sont pas alignées avec les nouvelles lois.
4.1.2.2. Références coraniques :
Les résistances peuvent être basées sur des interprétations spécifiques des textes religieux. Cependant, il est important de noter que le Coran et la charia soutiennent des principes de justice et d’équité, même si les interprétations peuvent varier.
4.2. Rôle des institutions :
4.2.1. Institutions judiciaires :
Les tribunaux jouent un rôle crucial dans l’application des lois, mais ils peuvent être limités par un manque de ressources, de formation ou de sensibilisation aux nouvelles réformes.
4.2.2. Organisations de la société civile :
Ces organisations sont essentielles pour sensibiliser le public aux droits et aux réformes. Elles peuvent également aider à surmonter les résistances culturelles en promouvant une compréhension plus nuancée des principes islamiques qui soutiennent les réformes.
4.2.3. Formation et ressources :
Les défis en termes de formation et de ressources sont importants. Pour que les réformes soient efficaces, il est essentiel de renforcer les capacités des institutions judiciaires et des organisations de la société civile.
Bien que la Moudawana représente un pas important vers l’égalité et la justice dans le cadre du droit de la famille au Maroc, sa mise en œuvre rencontre des défis significatifs. Ces défis sont souvent liés à des résistances culturelles et à une application inégale des lois.
Cependant, en s’appuyant sur les principes de la charia et du Coran qui promeuvent la justice et l’équité, et en renforçant le rôle des institutions judiciaires et des organisations de la société civile, il est possible de progresser vers une application plus uniforme et acceptée des réformes.
Cela nécessite un engagement continu pour l’éducation, la sensibilisation et le dialogue entre les différentes parties prenantes.
- Perspectives d’Avenir5.1. Renforcer l’application des lois :5.1.1. Formation des juges et responsables :
Il est crucial de former les juges et les responsables à une application équitable et cohérente des lois. Cela inclut une meilleure compréhension des principes de la charia qui promeuvent la justice. Le Coran insiste sur l’importance de la justice, comme le souligne le verset 4 :58 : En vérité, Dieu vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec équité.
5.1.2. Application cohérente :
Une formation adéquate contribuera à réduire les disparités dans l’application des lois entre les régions urbaines et rurales, assurant ainsi que les réformes bénéficient à toutes les femmes.
5.2. Sensibilisation et éducation :
5.2.1. Droits des femmes et égalité des sexes :
Sensibiliser le public aux droits des femmes et à l’importance de l’égalité des sexes est essentiel. L’éducation peut s’appuyer sur des principes islamiques qui reconnaissent la dignité et les droits des femmes. Le verset 49 :13 du Coran affirme : Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux.
5.2.2. Rôle des institutions éducatives et religieuses :
Les institutions éducatives et religieuses peuvent jouer un rôle clé dans la diffusion de ces messages, en promouvant une compréhension équilibrée des textes religieux.
5.3. Réformes continues :
5.3.1. Évaluation régulière de la Moudawana :
Pour s’assurer que la Moudawana reste pertinente et efficace, il est important de l’évaluer régulièrement. Cela permettra d’identifier les domaines nécessitant des améliorations et de proposer des réformes supplémentaires.
5.3.2. Adaptation aux évolutions sociales :
Les réformes doivent prendre en compte les évolutions sociales et économiques, tout en respectant les principes fondamentaux de l’islam.
6. Vers une Société Plus Juste : Les Progrès et Défis de la Réforme de la Moudawana au Maroc
Il est vrai que certaines réformes de la Moudawana ont suscité des débats et des préoccupations, notamment en ce qui concerne leurs impacts sur le mariage et la sécurité des femmes. Voici quelques réflexions sur ces points :
6.1. Amour et Confiance dans le Mariage
6.1.1. Base du mariage :
Un mariage fondé sur l’amour et la confiance mutuelle est idéal et peut effectivement atténuer les craintes et les méfiances. Lorsque les deux partenaires s’engagent sincèrement l’un envers l’autre, ils sont plus enclins à surmonter ensemble les défis.
6.1.2. Communication et compréhension :
Encourager une communication ouverte et une compréhension mutuelle peut renforcer la relation et réduire les tensions qui pourraient découler des réformes légales.
6.2. Sécurité et Protection de la Femme
6.2.1. Protection légale :
Il est crucial que les lois protègent les droits des femmes, en particulier en cas de décès du conjoint ou de dissolution du mariage. Cela inclut des dispositions pour garantir que les femmes ne se retrouvent pas sans ressources.
6.2.2. Soutien social et économique :
En plus des protections légales, des systèmes de soutien social et économique peuvent aider les femmes à se sentir en sécurité. Cela pourrait inclure des programmes de formation professionnelle et des aides financières.
6.3. Réformes et Perceptions
6.3.1. Dialogue et sensibilisation :
Pour atténuer les polémiques, il est important de promouvoir le dialogue entre les différentes parties prenantes, y compris les jeunes, les couples mariés, et les leaders communautaires. Sensibiliser aux objectifs et aux bénéfices des réformes peut aider à dissiper les malentendus.
6.3.2. Adaptation et amélioration continue :
Les réformes doivent être évaluées régulièrement pour s’assurer qu’elles répondent aux besoins de la société. Cela peut inclure des ajustements basés sur les retours d’expérience des personnes concernées.
Conclusion
La réforme de la Moudawana a représenté une avancée significative vers l’égalité des sexes au Maroc. Malgré les défis persistants, il existe des opportunités pour renforcer ces progrès en s’appuyant sur les principes de justice et d’équité présents dans la charia et le Coran. En renforçant l’application des lois, en sensibilisant le public et en poursuivant les réformes, le Maroc peut continuer à évoluer vers une société plus juste et égalitaire.
Ces efforts nécessitent un engagement collectif et une volonté de dialogue et de collaboration entre les différentes parties prenantes, notamment les autorités religieuses, les institutions judiciaires et la société civile. L’objectif ultime des réformes devrait être de créer un cadre qui soutient des mariages sains et protège les droits de tous les membres de la famille, tout en respectant les valeurs culturelles et religieuses.
Par Me Abdelhakim EL KADIRI BOUTCHICH
Juge et président de la haute unité judiciaire spéciale des relations Africo-Européennes et Arabes auprès de la Cour internationale de résolutions des différends « Incodir » à Londres.
Arbitre international et Arbitre en ingénierie accrédité.
Expert consultant international en audit, droit des affaires, Arbitrage et réévaluation entrepreneuriale auprès de l’ordre mondial des experts internationaux « OMEI » à Genève.
Conférencier et poète.
BIBLIOGRAPHIE.
- Articles.
- The Reform of the Moudawana: The Role of Women’s Activism in Morocco – Cet article explore l’influence des mouvements féministes sur la réforme du Code de la famille.Family Law Reform in Morocco : The Moudawana and the Challenges of Implementation – Une analyse des défis rencontrés lors de la mise en œuvre des réformes.3. Gender Equality and Legal Reform in Morocco : The Moudawana in Practice – Cet article discute des effets pratiques des réformes sur l’égalité des sexes.
4. The Impact of the 2004 Family Code Reforms on Moroccan Women – Une étude empirique sur les changements vécus par les femmes après la réforme.
5. Legal Pluralism and Family Law in Morocco : Navigating Between Tradition and Modernity – Cet article examine comment la Moudawana intègre les valeurs traditionnelles et modernes.
6. Women’s Rights in the Maghreb : The Case of the Moroccan Family Code – Une comparaison des droits des femmes au sein des pays du Maghreb, avec un focus sur le Maroc.
- Ouvrages.
- La Moudawana : Le Code de la Famille du Maroc par Leïla Rhiwi – Ce livre offre une analyse détaillée des réformes apportées à la Moudawana et de leur impact sur la société marocaine.Gender and Justice in Family Law Disputes : Women, Mediation, and Religious Arbitration par Samia Bano – Bien que ce livre traite de plusieurs systèmes juridiques, il inclut une discussion sur les réformes de la Moudawana et leur effet sur les droits des femmes.3. Femmes, famille et changement social au Maroc : La Moudawana en question par Zakia Salime – Cet ouvrage examine les changements sociaux et juridiques introduits par la réforme de la Moudawana.
4. The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5, 2004 – Une version traduite et commentée du texte de loi, souvent accompagnée d’analyses juridiques.
- Coran.
6.Sahih Al Boukhari.Mohamed Ibnou Ismail Al Boukhari. 2018.Edition Ibnoukathir. Liban.
Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.