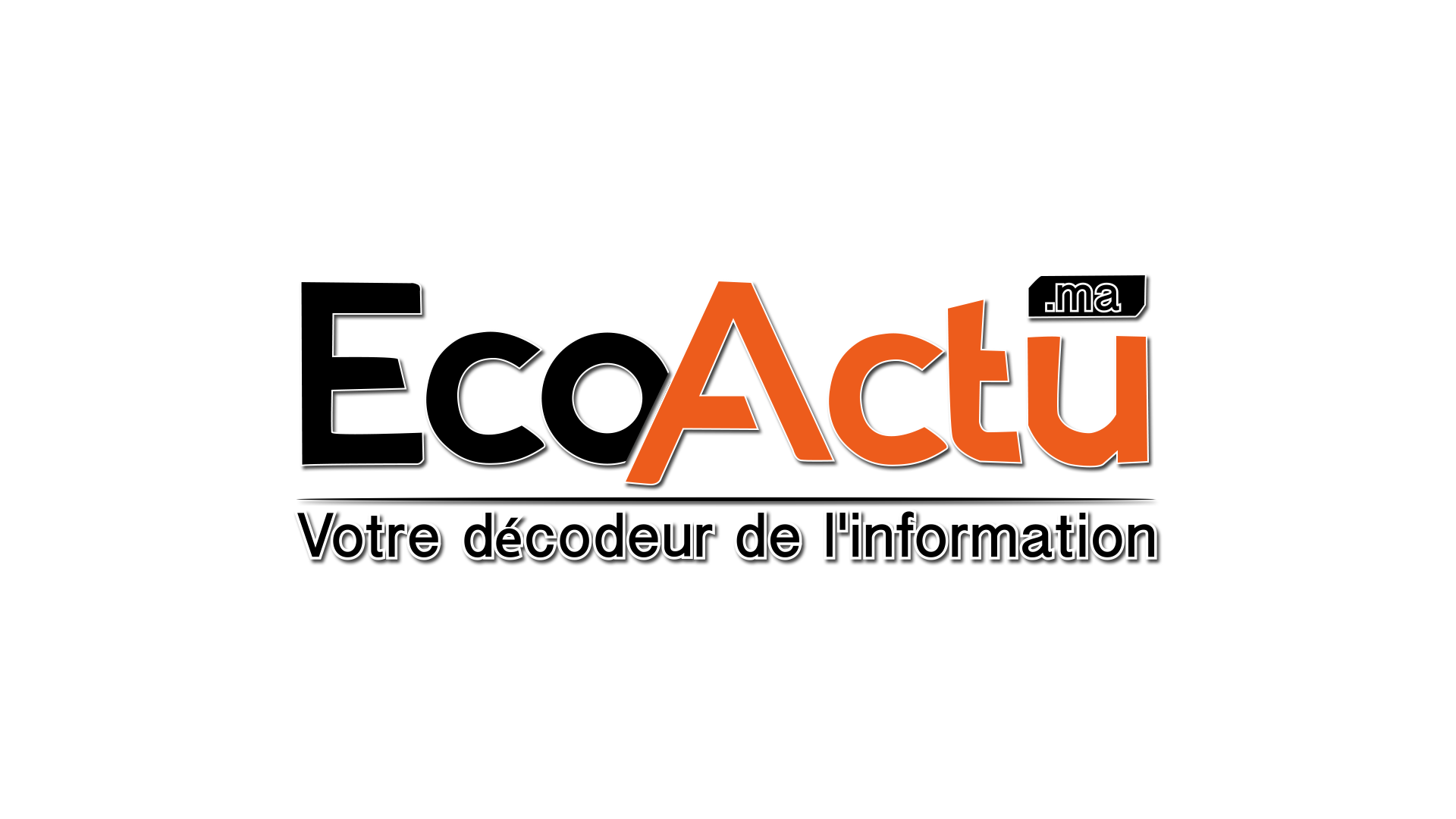Au Maroc, l’efficience de l’investissement public est estimée à 66%, ce qui correspond à une inefficience de près de 34%. Cette performance reste en dessous de la moyenne des pays à revenu intermédiaire.
En ligne avec les objectifs de son nouveau programme de recherche de Bank Al-Maghrib, ses activités durant l’année 2024 ont été marquées par la poursuite de la production scientifique. Trois documents de travail ont été publiés au cours de l’année, abordant des thématiques importantes pour l’économie tels que l’efficience de l’investissement public direct de son auteur Hicham Doghmi.
L’investissement public dans des infrastructures économiques et sociales de qualité joue un rôle crucial dans le processus de développement des nations et contribue significativement à une croissance économique soutenue et inclusive. Il améliore la prestation des services publics, la qualité de vie, les niveaux de qualification et la santé des citoyens. La mise en place d’infrastructures de transport soutient les activités du secteur privé en connectant les marchés, en réduisant les coûts et en facilitant la production et le commerce. De plus, l’investissement public stimule l’activité économique à court terme via la demande agrégée et peut également accroître la capacité de production de l’économie à long terme.
« Cette relation positive entre l’investissement public et la croissance économique est bien documentée dans la littérature empirique. Plusieurs études montrent que l’investissement public a des effets significatifs et durables sur la production. Néanmoins cet impact est généralement plus faible dans les pays en développement (PED) que dans les pays avancés », explique Hicham Doghmi auteur du document relatif à l’investissement public.
Si l’impact de l’investissement public sur la production est plus faible dans les PED, cela est attribuable principalement à la présence d’inefficience dans le processus d’investissement public. Cette inefficience se manifeste par la présence de lacunes dans la sélection des projets, la faiblesse de la mise en œuvre et du suivi, le gaspillage des ressources et la prévalence de la corruption, donnant lieu à des projets inefficacement exécutés. Dans de telles conditions, seule une fraction de l’investissement public se traduit en infrastructures productives.
L’objectif principal de ce papier est de quantifier l’efficience technique de l’investissement public au Maroc, de manière comparative avec les PED. Plus précisément, il s’agit de comparer le niveau du stock de capital (input) et le volume du stock d’infrastructures (output) des pays dans une fonction de production. L’idée sous-jacente est que si deux pays investissent le même montant, celui qui dispose du plus grand volume d’infrastructures sera considéré comme plus efficient. Le score d’efficience mesure la distance entre le stock d’infrastructure réel d’un pays et la frontière d’efficience potentielle. Cette analyse comparative est menée pour un panel de 70 PED – dont le Maroc – sur la période 2000-2019, en utilisant une approche de frontière stochastique.
« Les résultats montrent qu’il existe des marges de manœuvre pour accroître l’efficience de l’investissement public. En moyenne, près de 30% des ressources publiques investies sont perdues chaque année dans les PED. L’efficience s’améliore progressivement à mesure que le pays se développe : 55% pour les pays à faible revenu, 72% pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et 75% pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure », selon la même source..
Quid du Maroc ?
Concernant le Maroc, l’efficience est estimée à 66%, ce qui correspond à une inefficience de près de 34%. Cette performance du Maroc reste en dessous de la moyenne des pays à revenu intermédiaire.
Ces scores d’efficience traduiraient l’existence de faiblesses institutionnelles au niveau de la conception, de l’évaluation et de la sélection des projets, ainsi que la prévalence de la corruption. L’amélioration de la qualité des institutions est essentielle pour optimiser l’utilisation des ressources et améliorer les réalisations en matière d’infrastructures, notamment en renforçant l’efficacité de la gouvernance dans le secteur public.