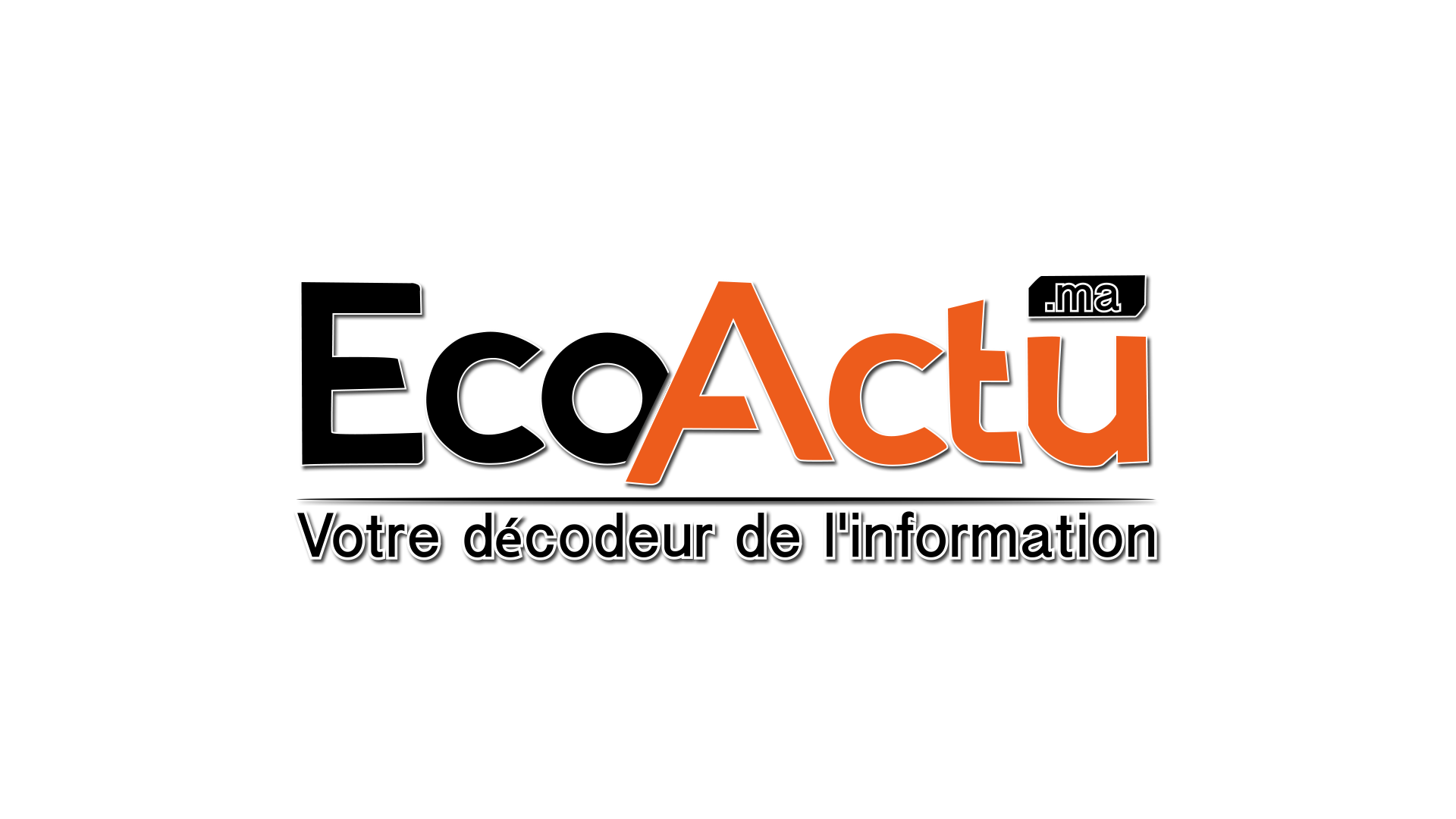Interviewé par Lamiae Boumahrou I
Malgré les dispositions de l’article 8 de la loi-cadre relative à la réforme fiscale, aucun rapport sur l’évaluation de l’impact socio-économique des incitations fiscales n’a été publié. Toutefois selon Rachid Lazrak, Conseil Juridique et Fiscal, à partir du moment où les incitations fiscales sont remplacées dans le cadre de la nouvelle Charte de l’investissement par des subventions publiques, le problème de l’évaluation se pose dans des termes différents.
EcoActu.ma : Les exonérations fiscales appelées « dépenses fiscales » continuent de peser sur le budget de l’Etat à un moment de raréfaction des ressources financières. Que pensez-vous de ce problème ?
Rachid Lazrak : Il est vrai que le Maroc continue de connaitre de très nombreuses dérogations fiscales, appelées « dépenses fiscales », qui concernent tous les secteurs d’activités et surtout toutes catégories d’impôts (IS, IR, TVA, Droits d’enregistrement, Impôts locaux, Droits de douane, TIC) et qui prennent des formes diverses (exonérations totales, exonérations partielles, réductions, abattements, taux préférentiels et même des régimes fiscaux dérogatoires comme l’exportation indirecte).
Cette situation résulte d’un processus historique qui date des années soixante où le gouvernement a mis en place des mesures incitatives pour encourager les investissements marocains et étrangers.
L’aboutissement de ce processus a été la promulgation de la Charte des investissements le 8 Novembre 1995 pour une période de dix ans. Les mesures incitatives étaient surtout à caractère fiscal et ont été, pour des raisons d’harmonisation, de simplification et de modernisation du système fiscal, intégrées dans la loi de finances transitoire pour l’année 1996 et par la suite dans le Code général des impôts, grâce à l’ancien directeur des impôts Noureddine Bensouda.
Avec le poids croissant des exonérations fiscales, et avec la raréfaction des ressources financières et malgré le développement économique et social que le Maroc a connu grâce, notamment, à la Charte de 1995, le gouvernement a commencé à réfléchir à quantifier les avantages fiscaux et à analyser leur impact réel.
Ce qui explique que la loi-cadre du 26 Juillet 2021 portant réforme fiscale a, dans son article 8, limité, de façon dramatique, l’octroi d’avantages fiscaux. Tout octroi doit faire l’objet préalablement d’une étude de la part du gouvernement et même en cas de besoin, remplacer l’avantage fiscal par une subvention publique.
Le même article demande au gouvernement de procéder à une évaluation régulière sur les effets économiques et sociaux des avantages fiscaux octroyés et ce, soit pour les conserver, soit pour les supprimer.
Tout cela s’explique par la prise de conscience du gouvernement du poids des « dépenses fiscales » sur le budget de l’Etat.
D’où une nouvelle Charte d’investissements de 2022 avec une nouvelle approche fondée, non sur des avantages fiscaux, mais sur l’octroi de primes aux investisseurs, à tel point que cette Charte pourrait être appelée « la Charte des primes de l’Etat à l’investissement ». Elle constitue un tournant dans la perception de l’Etat des mesures à prendre pour encourager les investissements.
L’article 8 de la loi-cadre relative à la réforme fiscale stipule que les incitations octroyées doivent faire l’objet d’une évaluation régulière notamment en ce qui concerne leur impact socio-économique. Ce qui n’a pas été fait à ce jour et les rapports élaborés sur cette évaluation n’ont pas été publiés. Pourquoi à votre avis ?
Vous avez raison de poser cette question car malgré les dispositions de l’article 8 de la loi relative à la réforme fiscale, aucun rapport sur l’évaluation de l’impact socio-économique n’a été publié. Cependant, il faut nuancer cette affirmation pour différentes raisons : D’abord, en Octobre 2006 la DGI a établi et présenté au parlement, comme annexe au projet de la loi de finances pour l’année budgétaire 2006, un rapport sur les dépenses fiscales.
En ce faisant, la DGI n’a fait que suivre l’exemple d’un certain nombre de pays comme les Etats Unis d’Amérique qui ont été les premiers à rédiger des rapports annuels sur les dépenses fiscales (tax expenditures) et ce, depuis 1968.
Les pays de l’OCDE ont suivi, notamment la France depuis 1980. Donc, au Maroc, tous les ans, le gouvernement publie un rapport sur les dépenses fiscales, annexé à chaque loi de finances.
Maintenant, si certains avantages sont faciles à quantifier et à évaluer (exonération d’IS ou d’IR pour certaines régions et certaines activités) d’autres sont beaucoup plus difficiles à évaluer : par exemple évaluer l’effet de réinvestissements de profits de cession d’actifs suppose une analyse de tous les bilans des entreprises.
Cela dit, aujourd’hui à partir du moment où les incitations fiscales sont remplacées par des subventions publiques, le problème de l’évaluation se pose dans des termes différents.
Quels sont à votre avis les moyens pour réduire le manque à gagner pour le budget de l’Etat, sachant qu’il équivaut à près de 2,5% du PIB, même si en 2023 le nombre d’incitations fiscales a baissé de 311 à 292 soit de 37.957 MDH à 35.434 MDH ?
S’agissant des moyens pour réduire le manque à gagner pour le budget de l’Etat, je pense que, avec la substitution des incitations fiscales par des subventions publiques, un grand pas a été déjà fait.
En effet, l’ancien Code de 1995 avait pour objectif d’établir un lien entre le développement de l’investissement et l’amélioration du climat des affaires. Pour cela, il avait trois caractères : la généralisation des avantages en ce sens que la Charte s’appliquait à tous les secteurs d’activité, sans aucune distinction, l’homogénéité dans la mesure où les mêmes avantages étaient accordés à toutes les entreprises industrielles, commerciales et de service et l’automaticité qui permettait d’accorder les avantages, de façon automatique sans agrément préalable. Aujourd’hui, tous ces caractères n’existent pas.
La nouvelle Charte a institué une nouvelle approche : celle de cibler l’entreprise qui doit bénéficier de subvention et non d’incitation fiscale selon des critères qui sont bien définis : des projets dont le montant est égal ou supérieur à 50.000.000 DH avec le nombre d’emplois stables à créer, des projets qui sont créés dans certaines régions (prime territoriale), les projets crées dans certains secteurs (industrie, tourisme, énergies renouvelables …) et les projets à caractère stratégique (2.000.000.000 DH). Enfin, les petites et moyennes entreprises et celles opérant à l’international.
Donc, on est loin de la généralisation des avantages. Les subventions qui ont remplacé les incitations fiscales, sont ciblées par entreprise, et cas par cas. Donc, c’est un moyen pour réduire les dépenses fiscales de façon progressive.
Les dépenses fiscales sont-elles inefficaces et sont-elles source d’inquiétude et d’instabilité du système fiscal marocain ?
Je rappelle que le premier Code des investissements a été mis en place par le Maroc en Décembre 1960, soit quatre ans depuis son accession à l’indépendance. Malgré ses limites, il a permis d’atteindre certains objectifs économiques et sociaux. Il a été suivi par la création de six Codes sectoriels pour encourager les investissements artisanaux, industriels, touristiques, miniers et les opérations d’exportation.
Les six Codes ont été complétés par un autre Code des investissements immobiliers en 1980. Comme précisé, ces Codes ont été remplacés par un seul Code en 1995 avec ses trois caractères. Dire que les incitations instituées par ces différents Codes ont été inefficaces n’est pas conforme à la réalité. Elles ont permis, avec d’autres mesures, notamment financières, de créer un tissu industriel, de développer des régions (Tanger), de résorber grandement le déficit en matière de logements, d’encourager la création d’unités touristiques, de procurer des devises au Maroc…
Et tout cela est lié au choix du modèle économique libéral pour lequel le Maroc a opté depuis son accession à l’indépendance. Pour s’en convaincre, regardez ce qui se passe chez notre voisin de l’est qui connait une crise du système économique Bref, tout en étant conscient du poids des « dépenses fiscales » sur le budget de l’Etat, il ne faut pas glisser vers une conception « populiste » de l’impôt, sachant que les avantages fiscaux existent dans tous les systèmes fiscaux du monde et que la mondialisation est aussi fiscale, car pourquoi un investisseur choisirait un pays comme le Maroc, si par ailleurs et dans les mêmes conditions, il peut bénéficier ailleurs d’un régime fiscal plus favorable ?
Cela dit, le fait de glisser d’un concept d’incitations fiscales vers celui de subventions publiques ciblées est très positif, mais sans oublier la petite et moyenne entreprise.